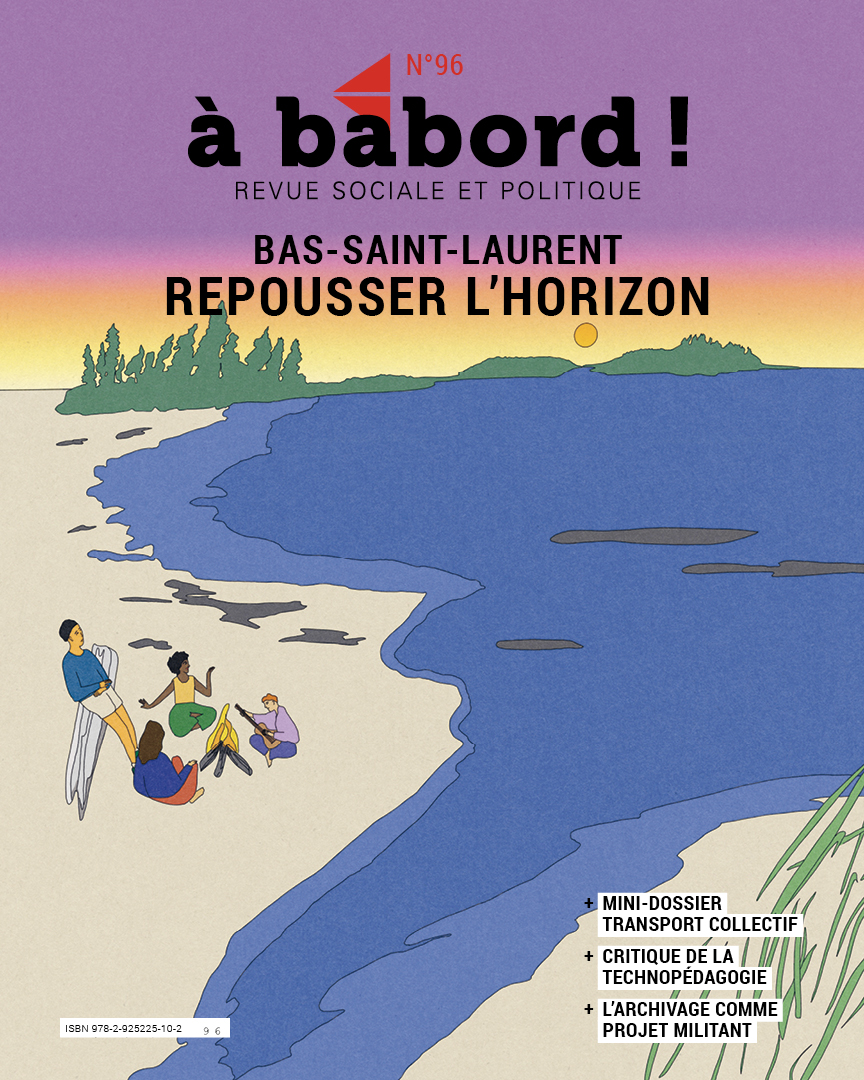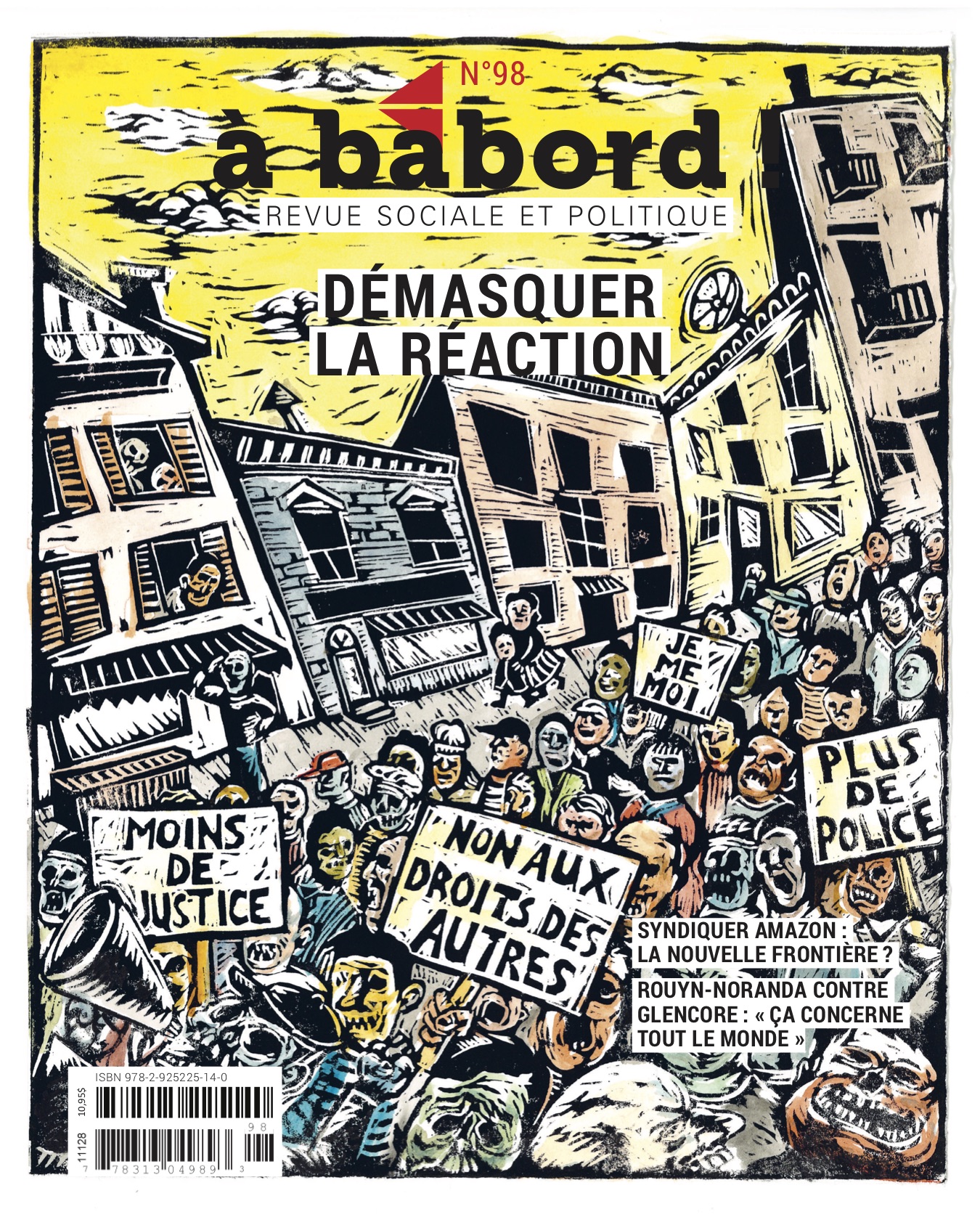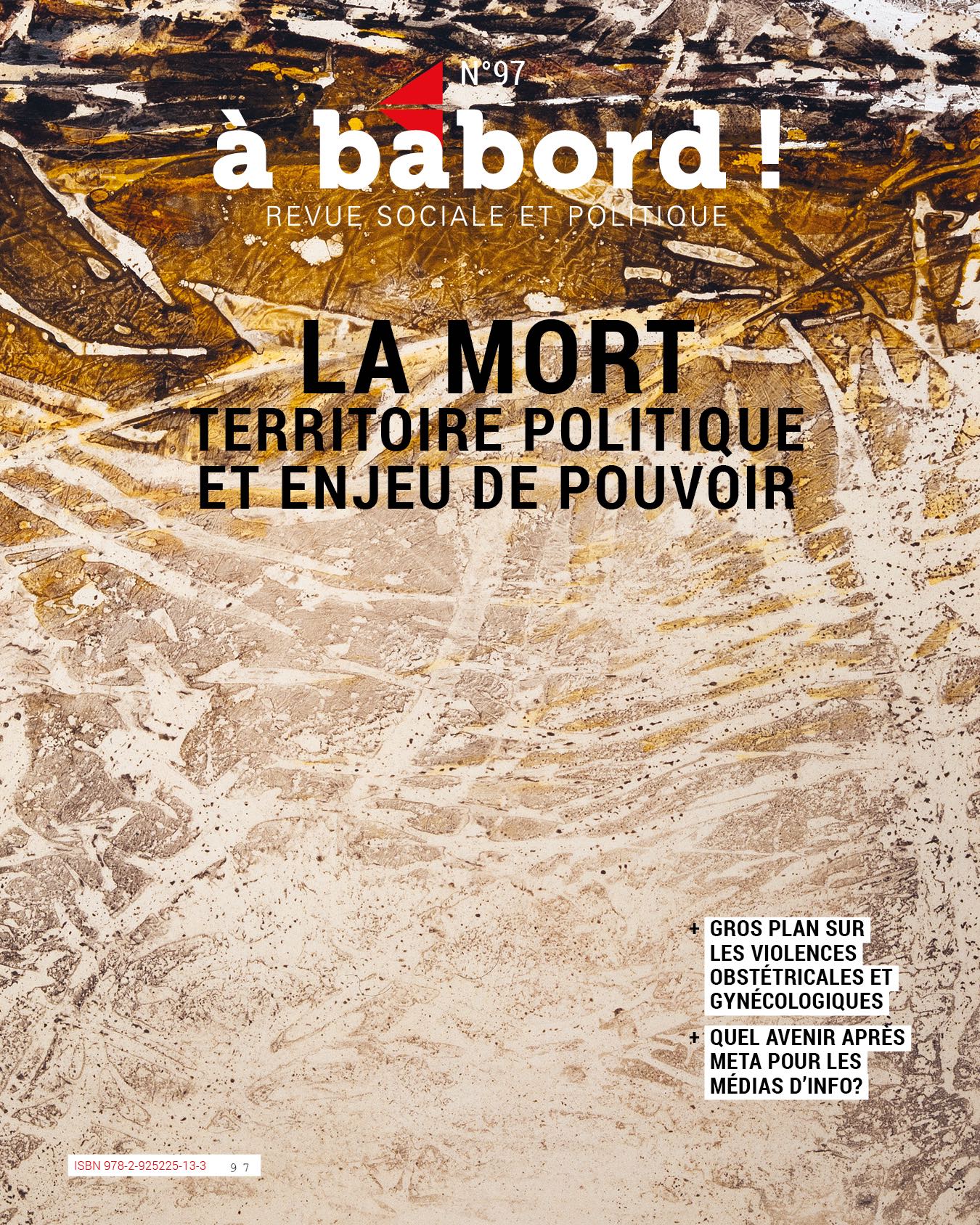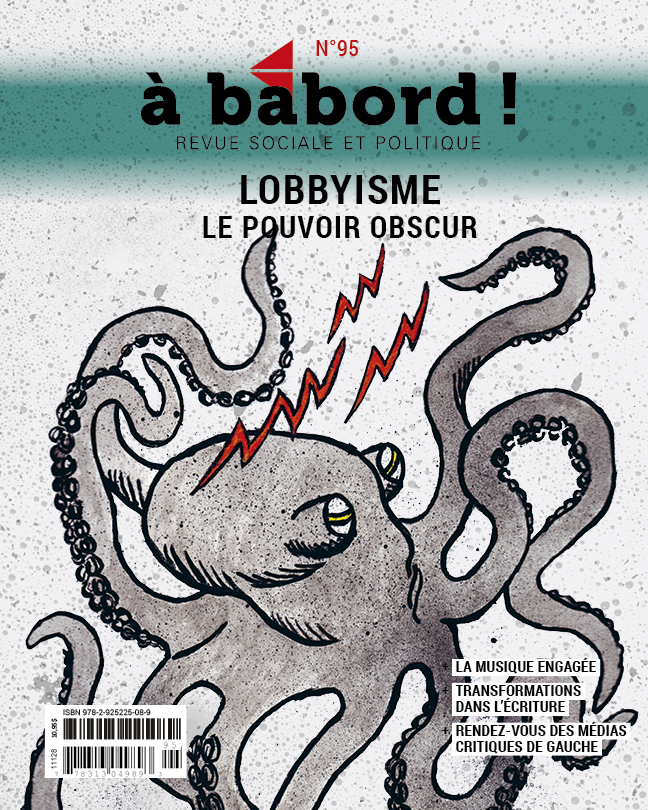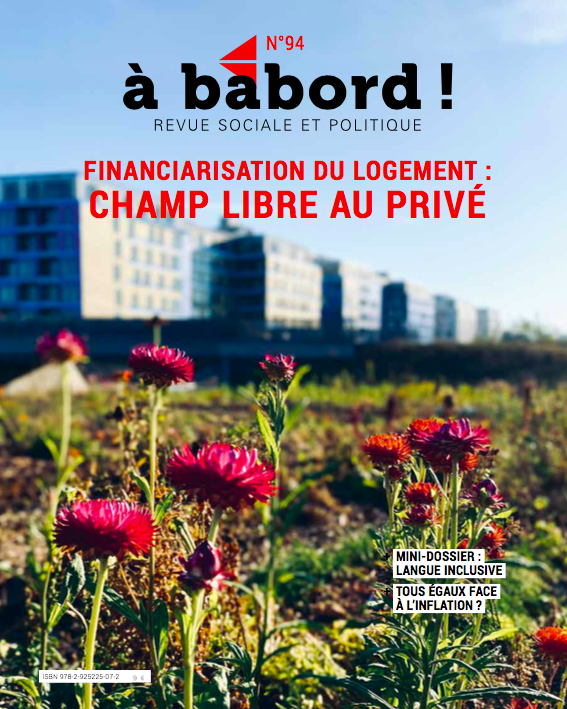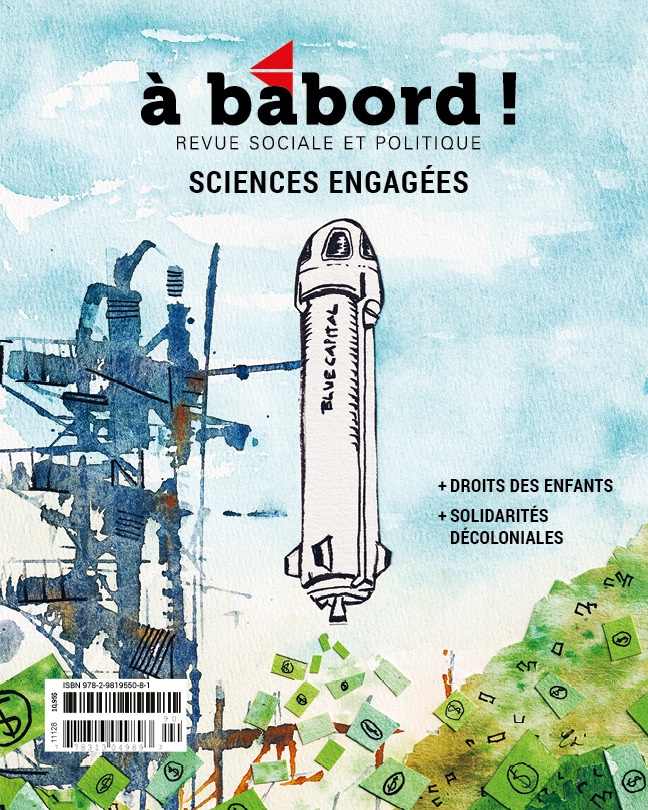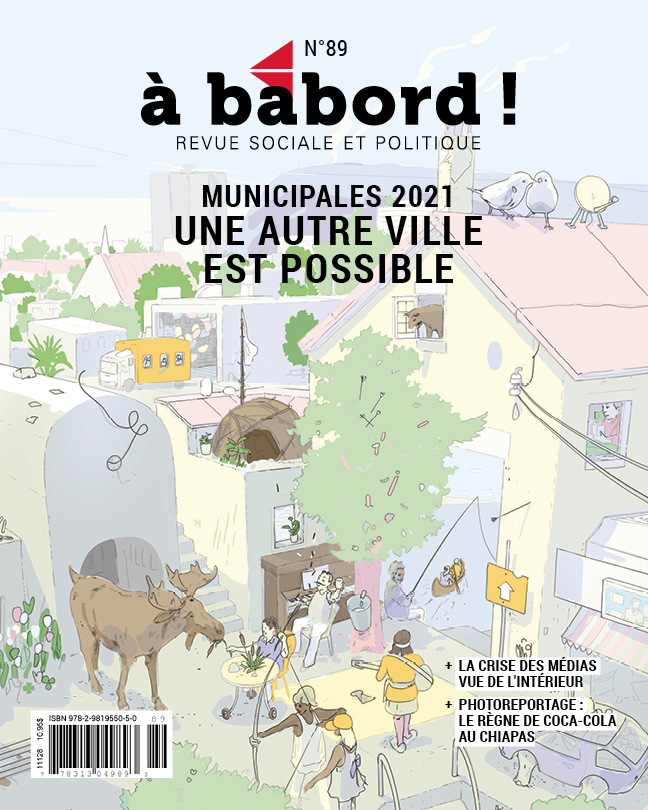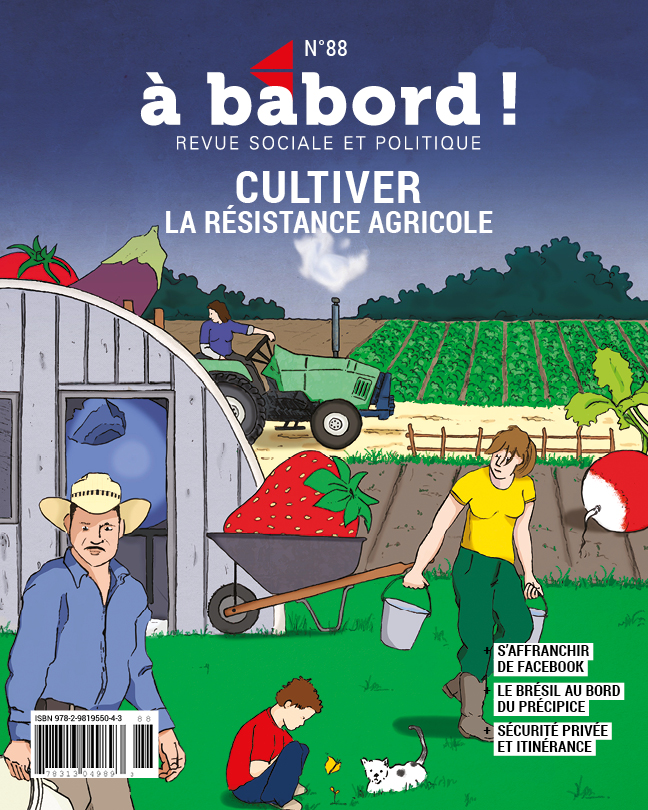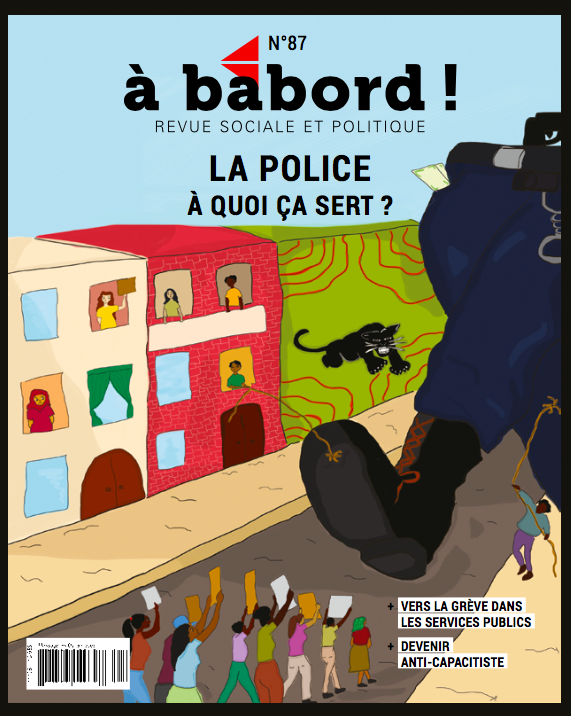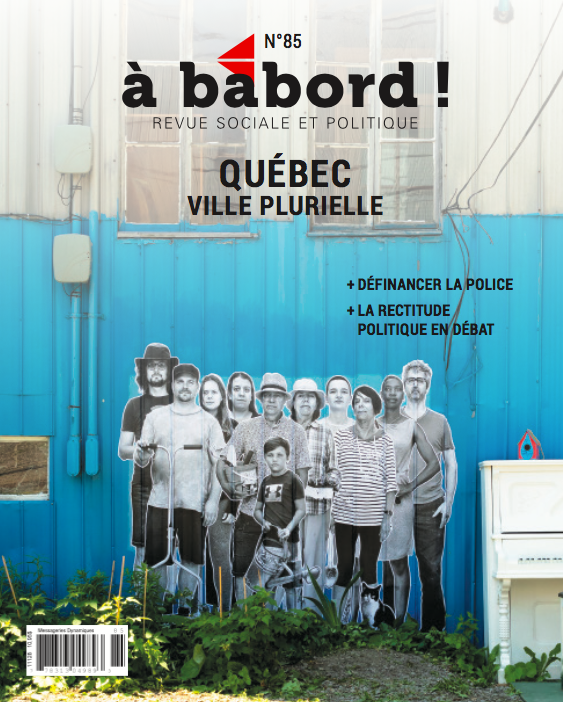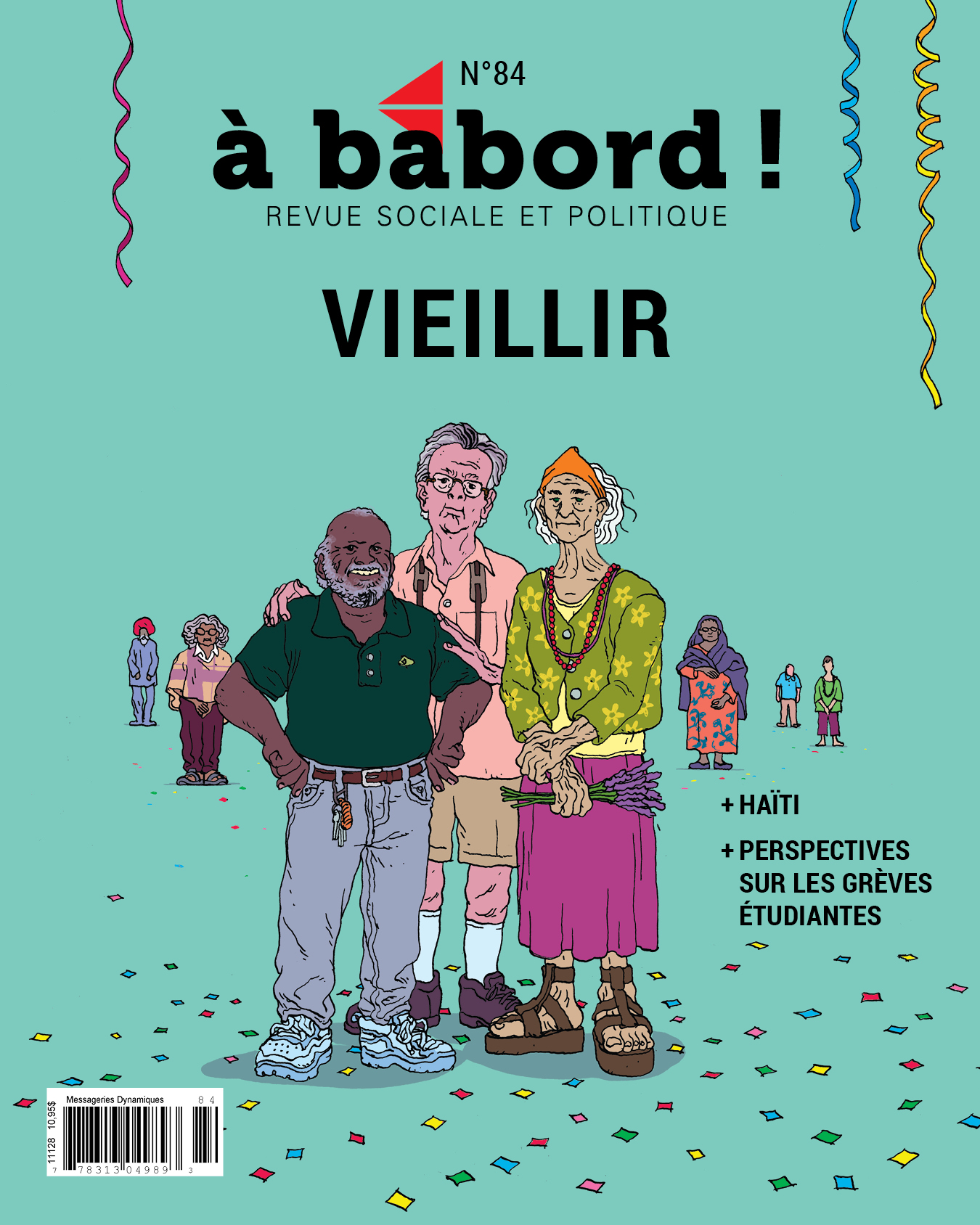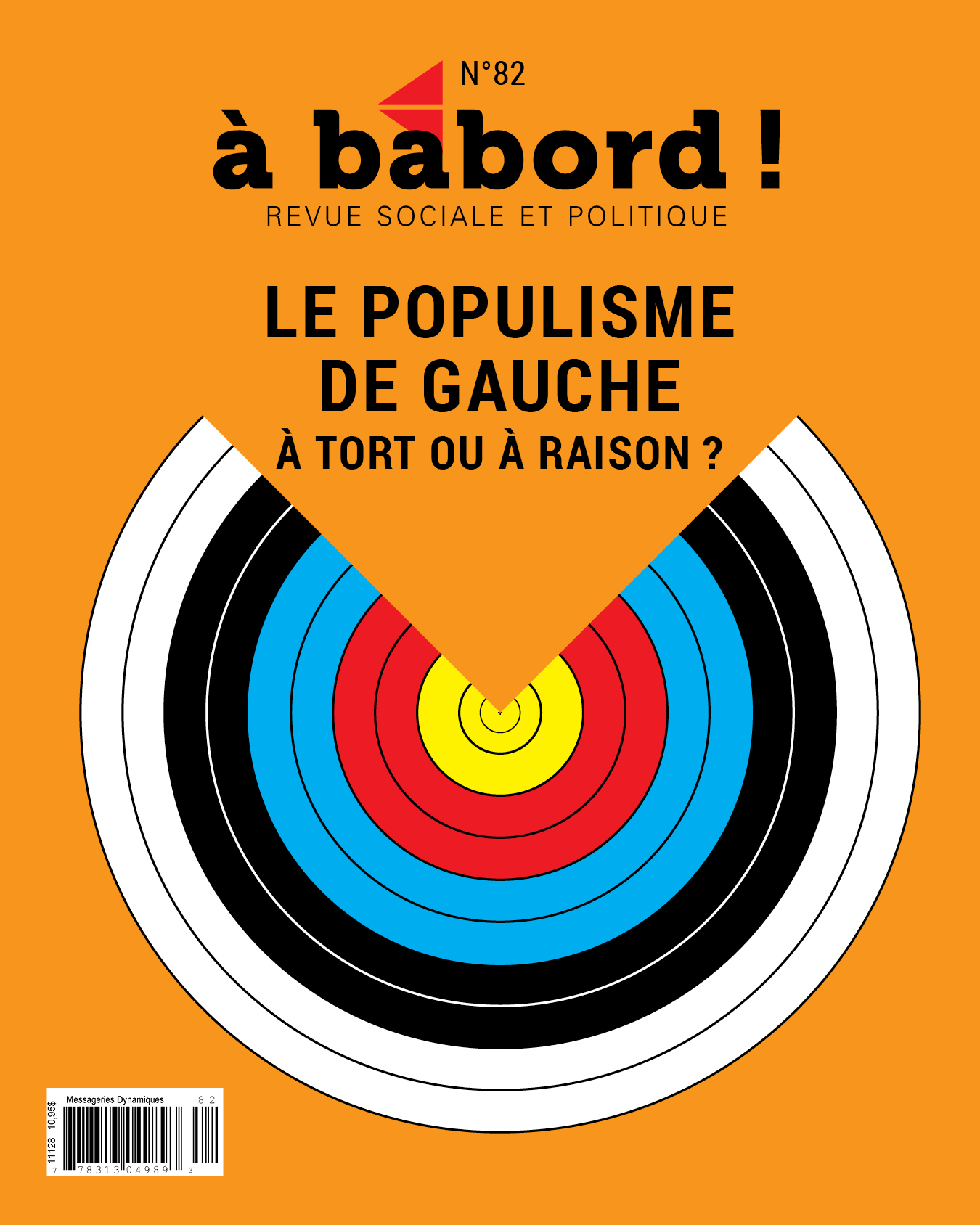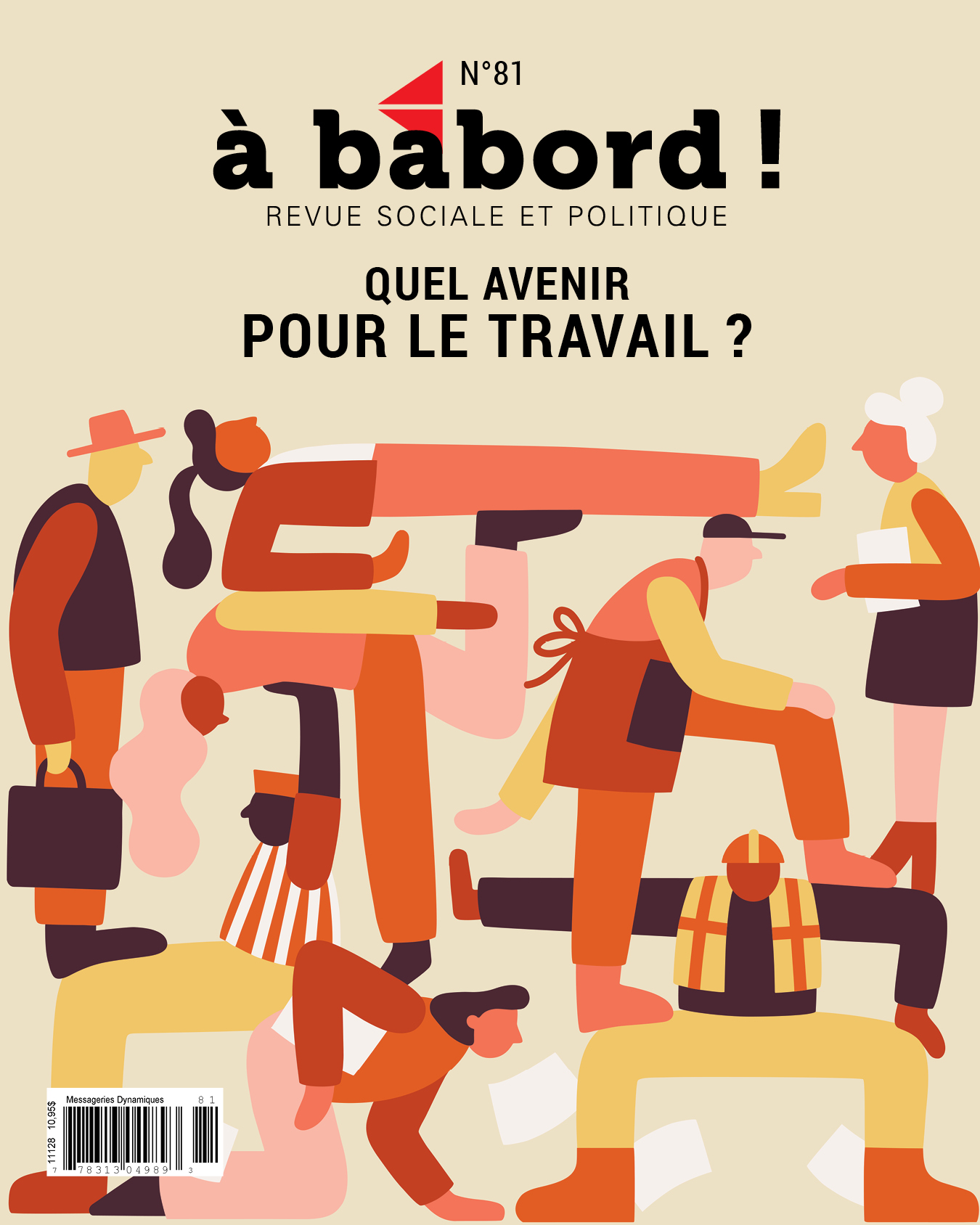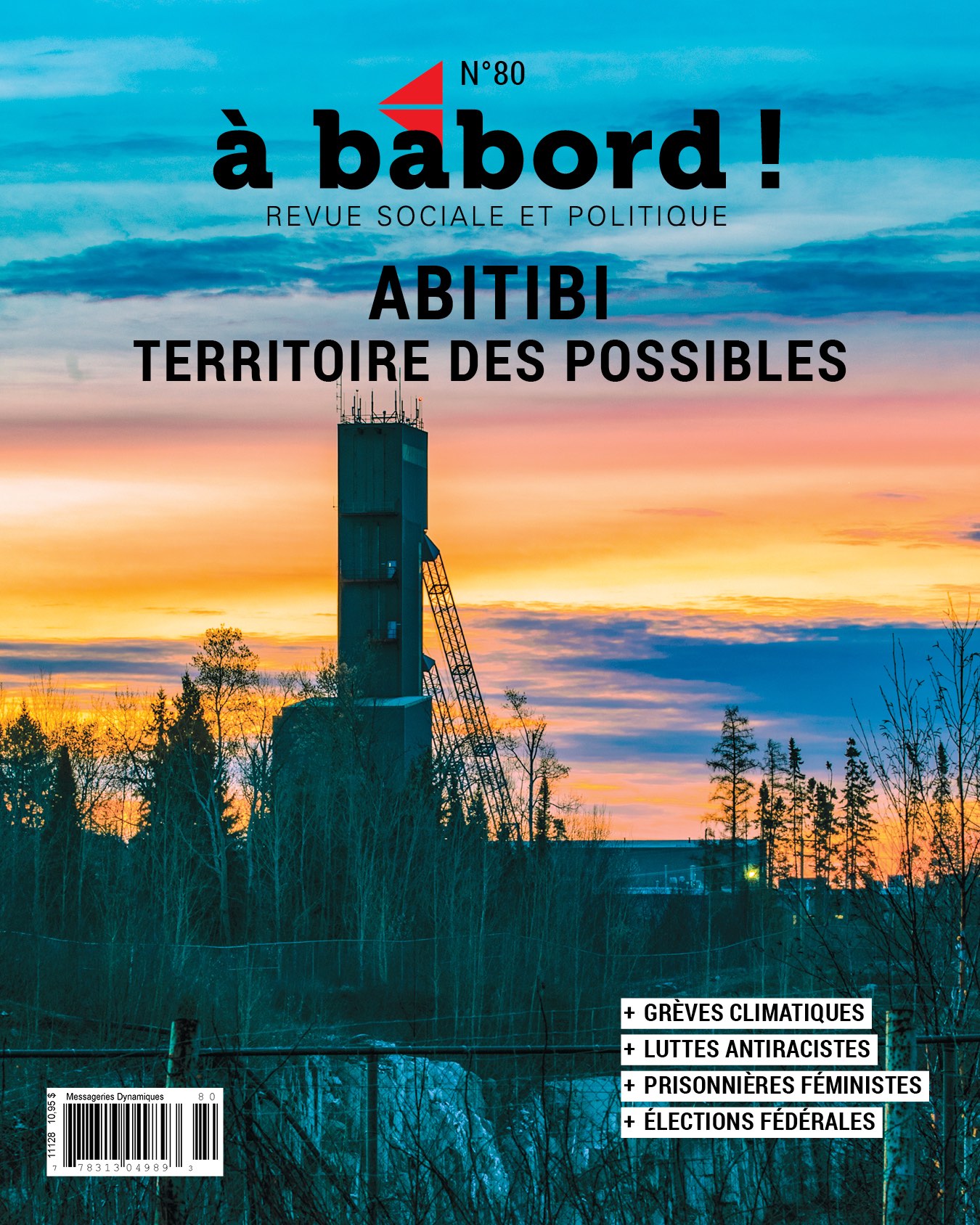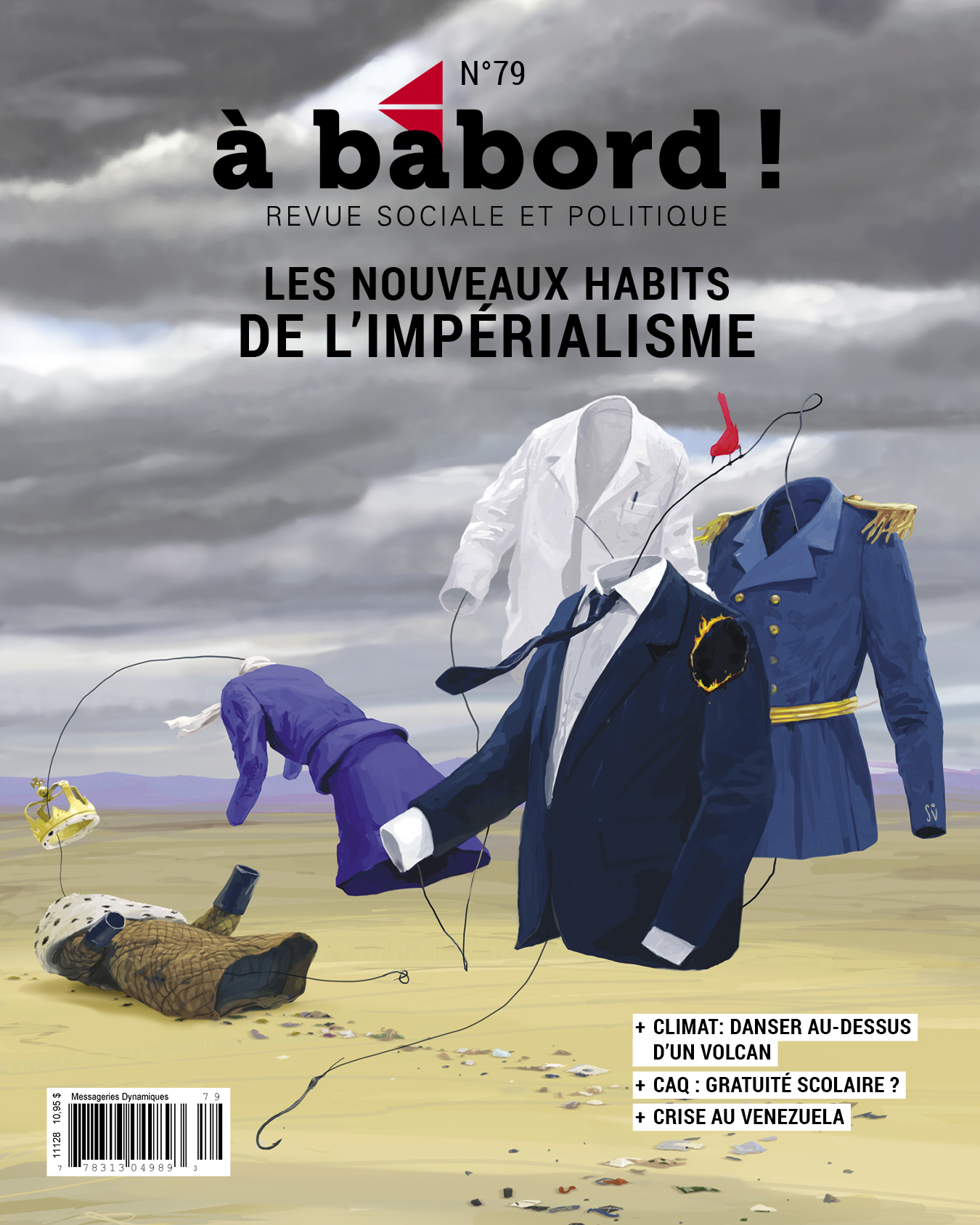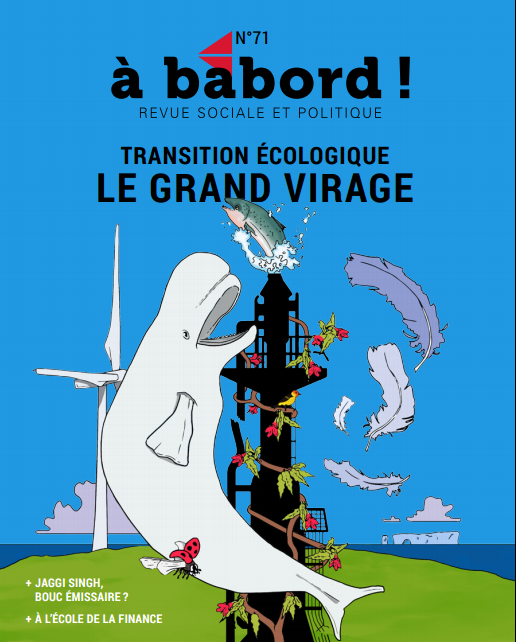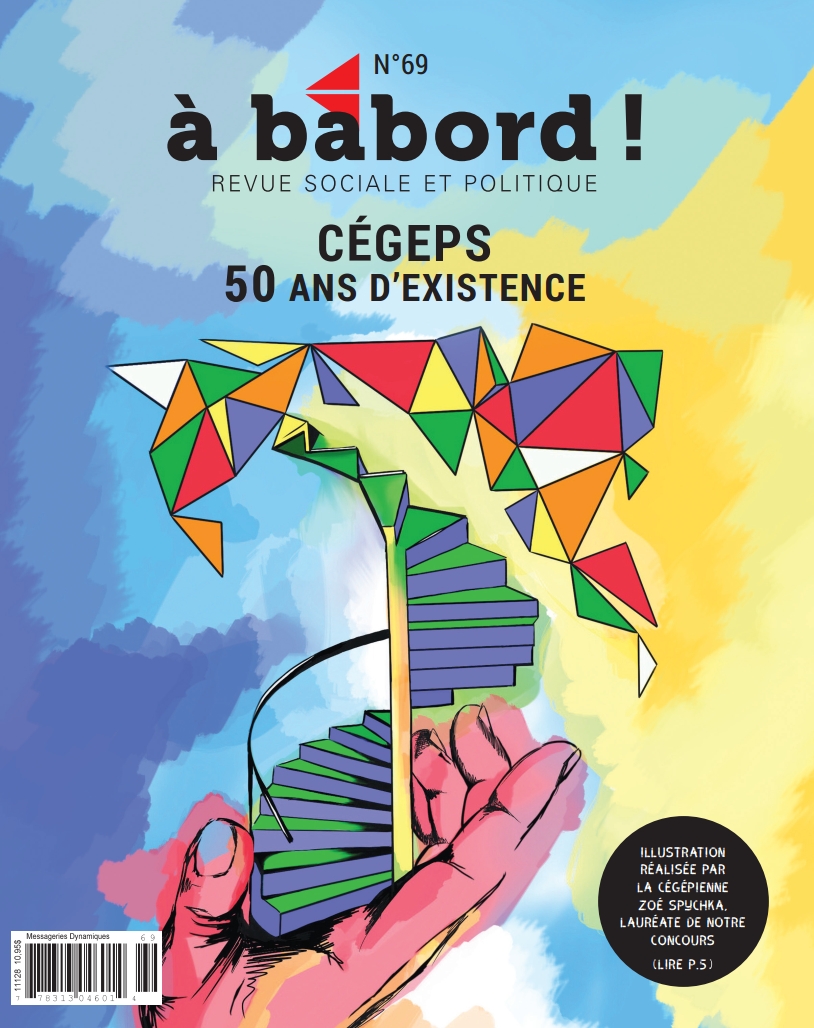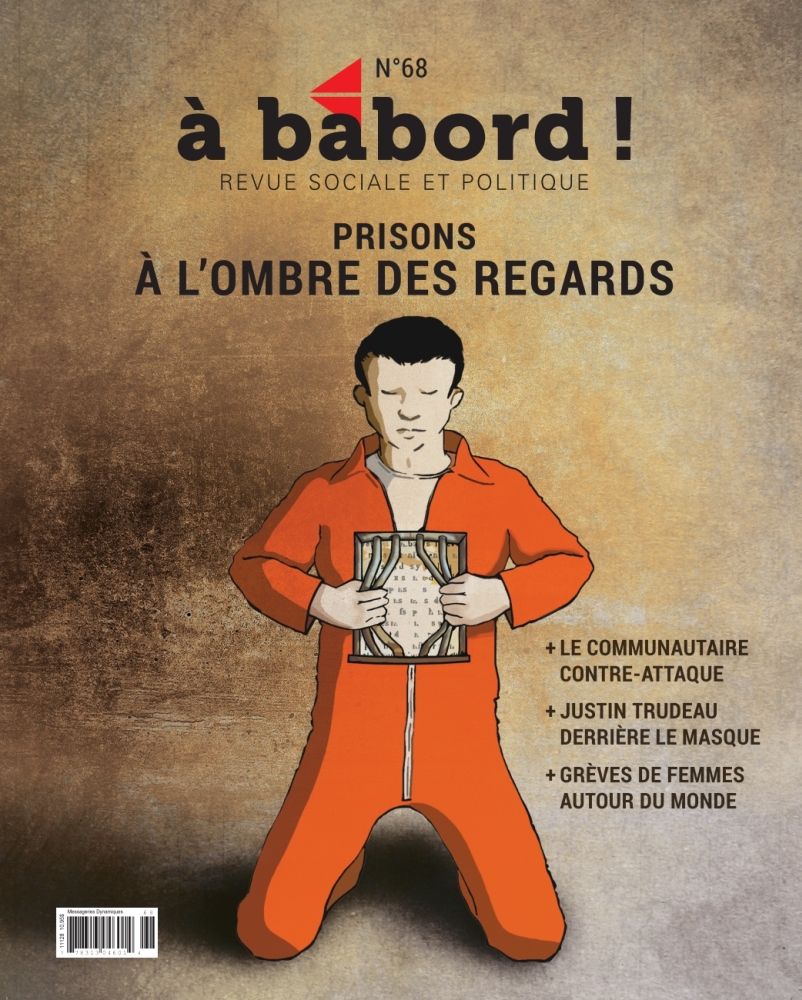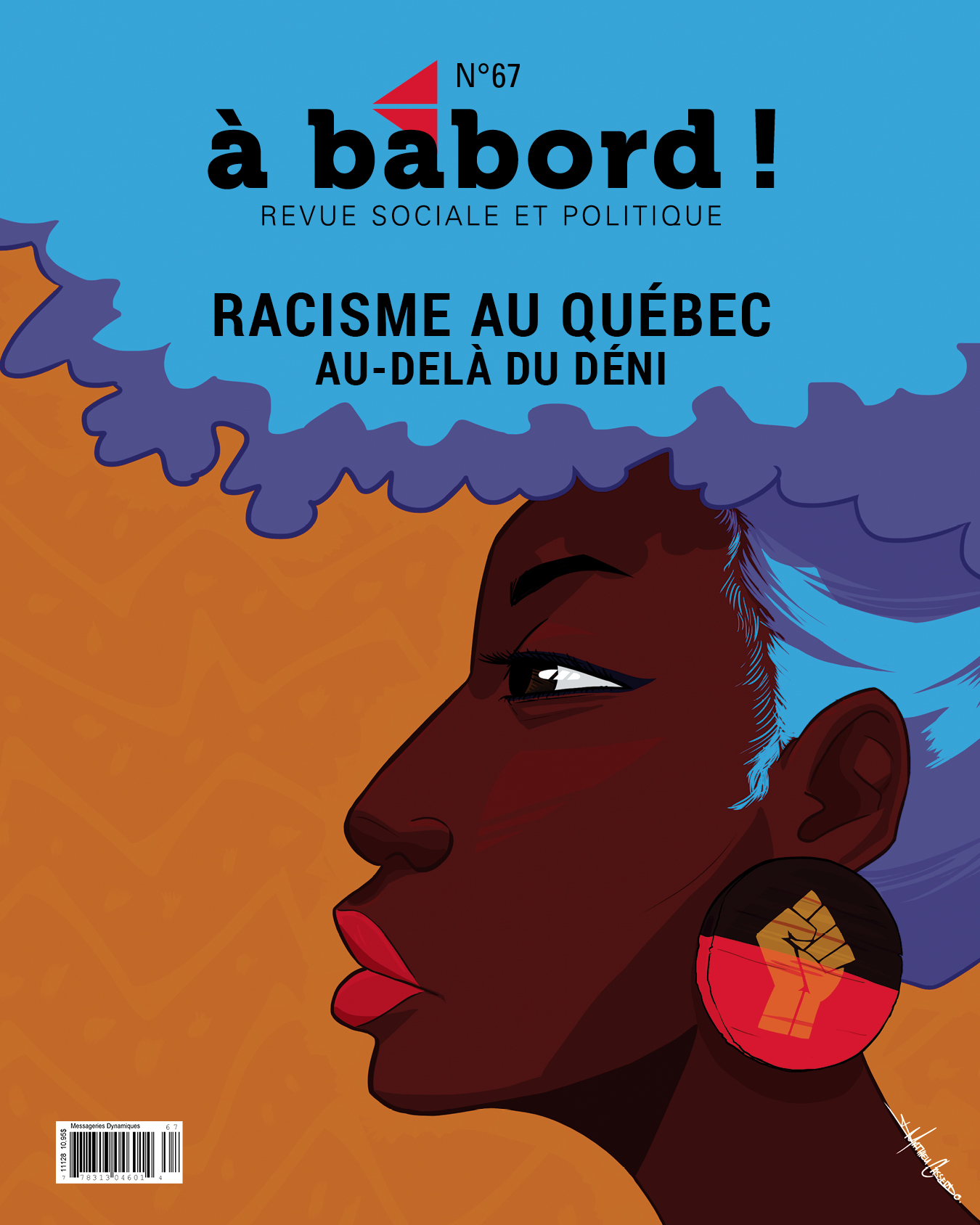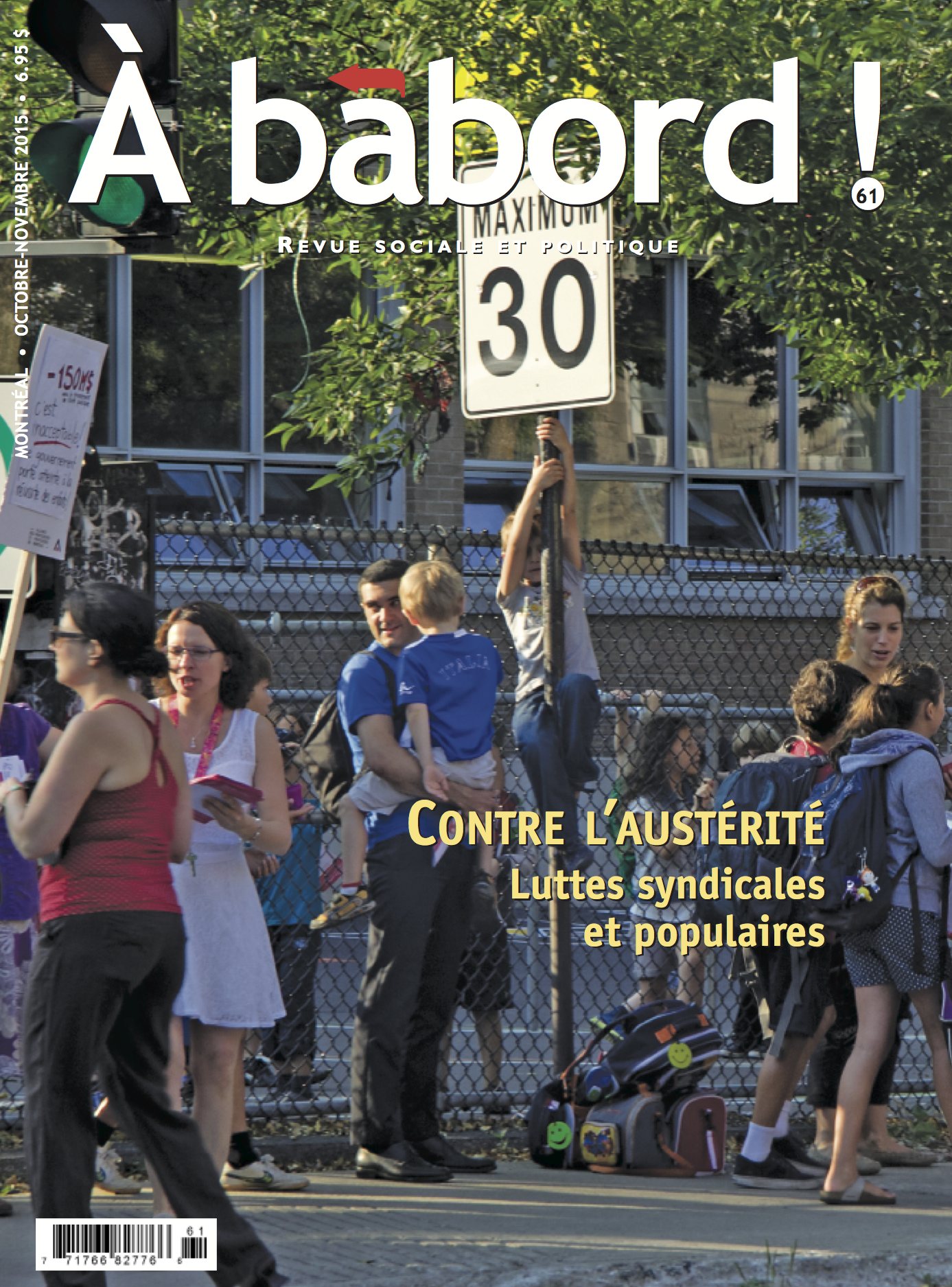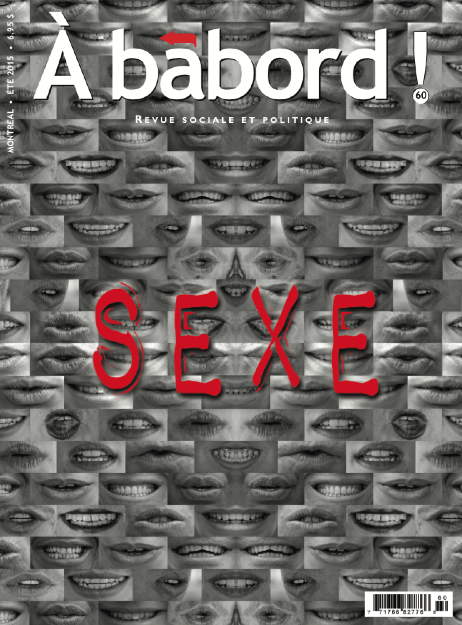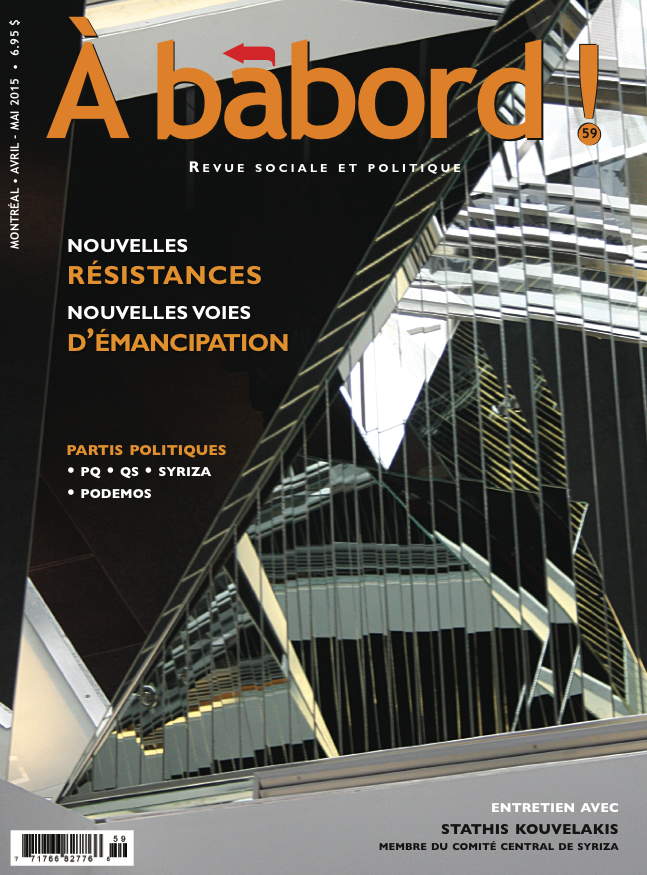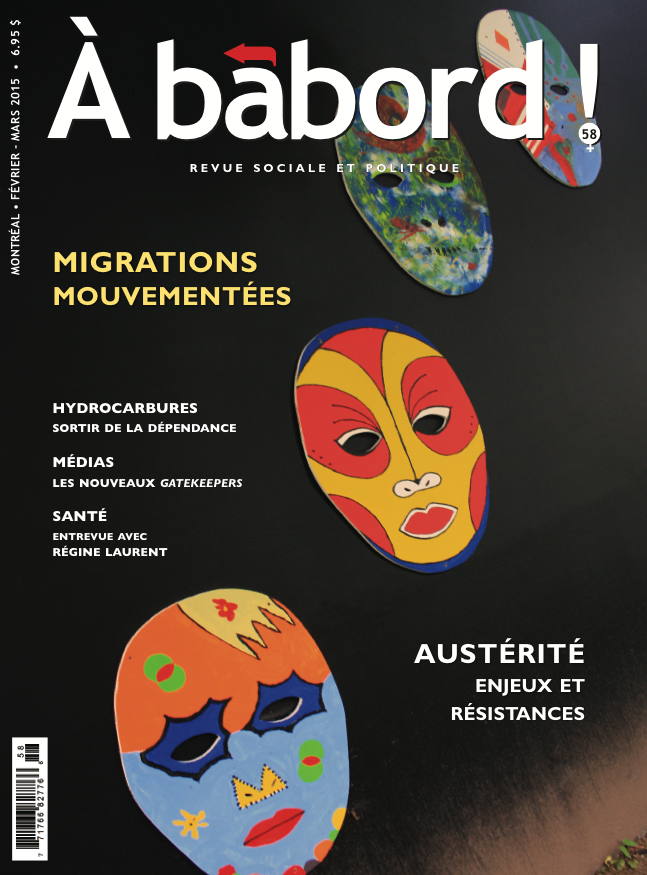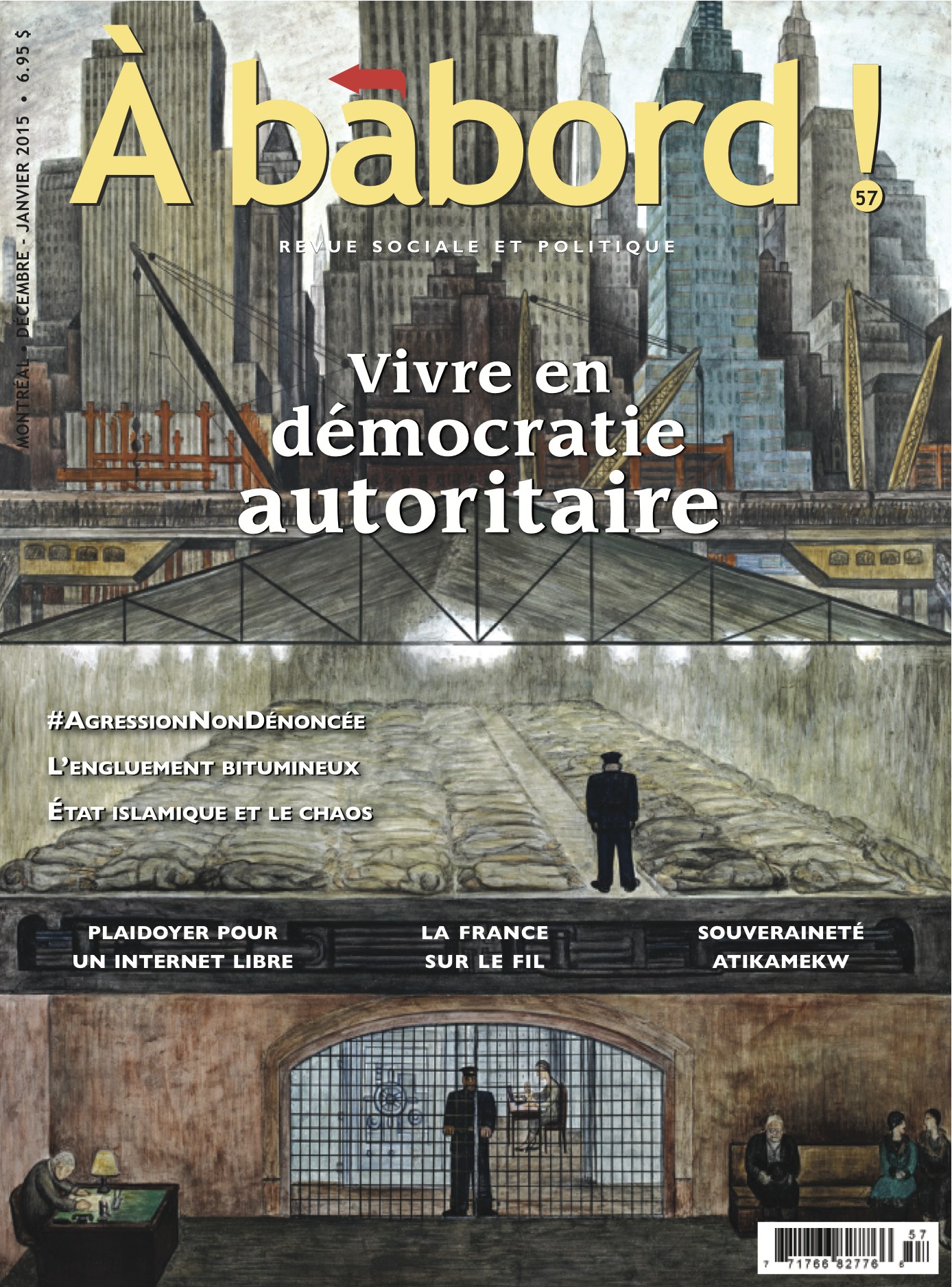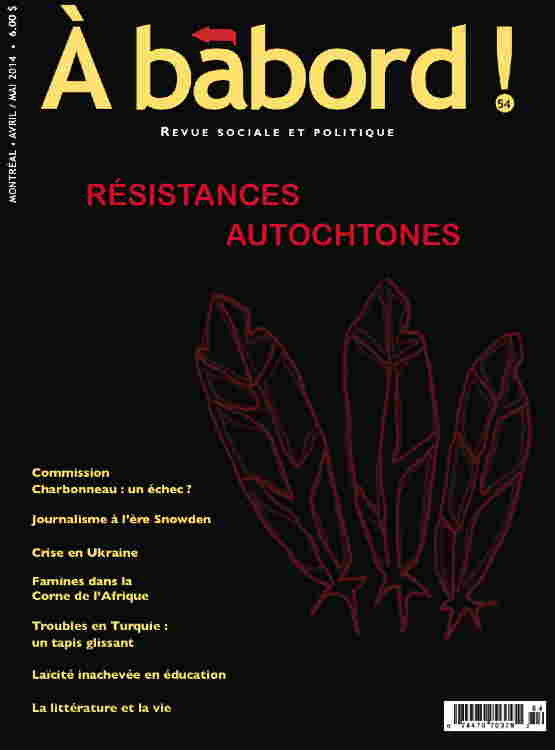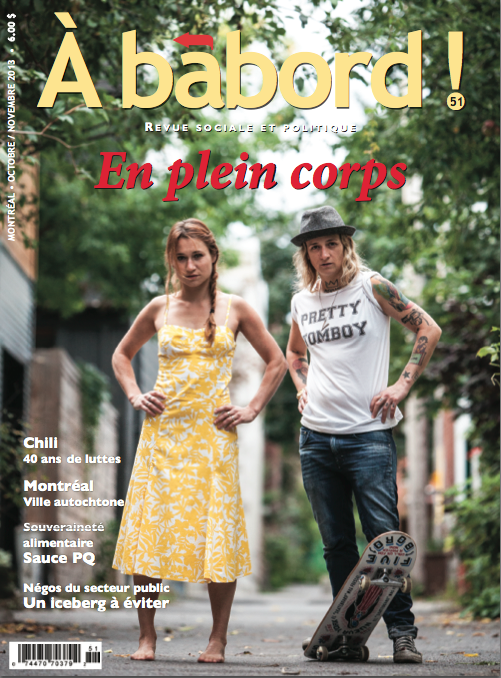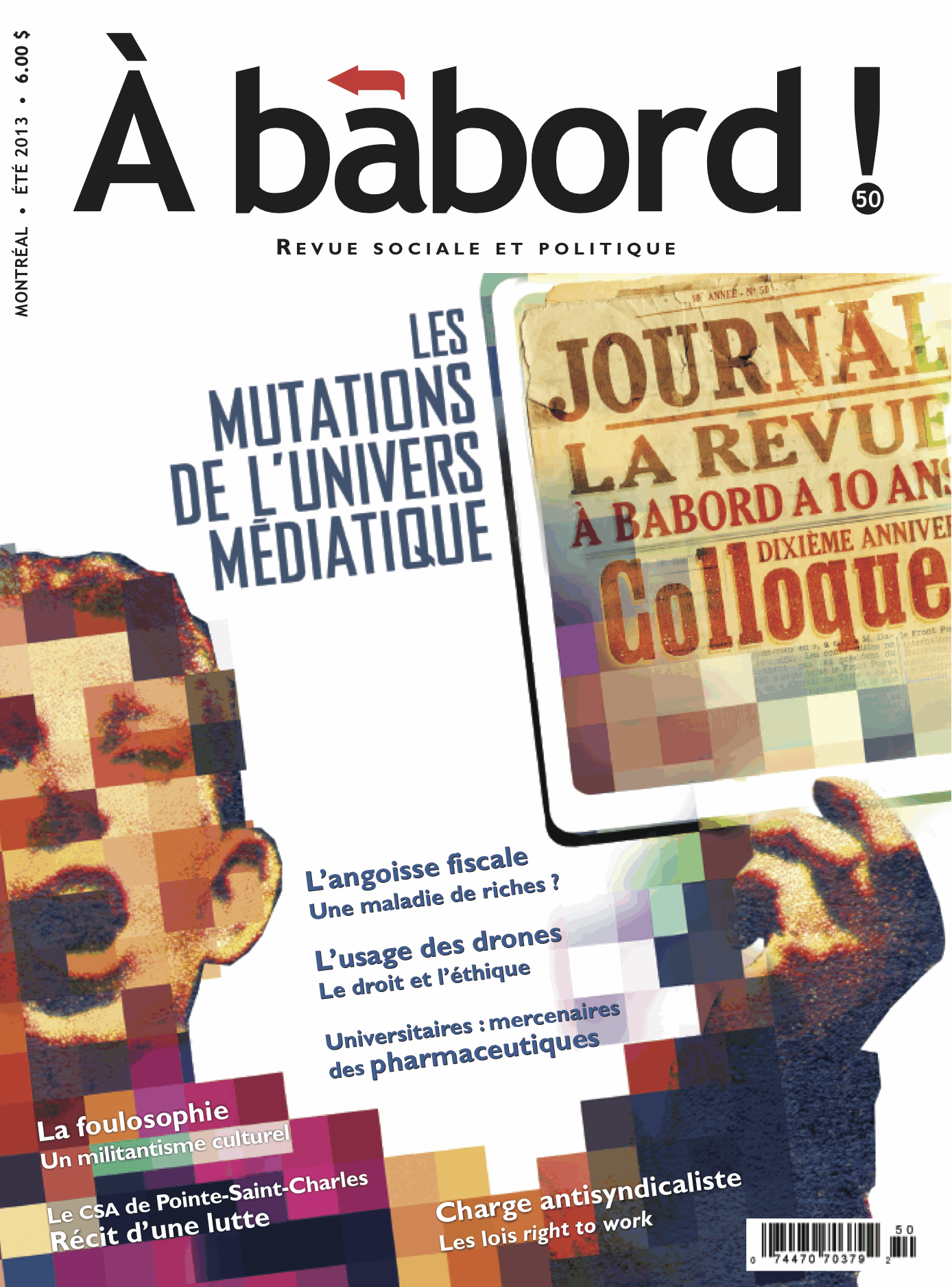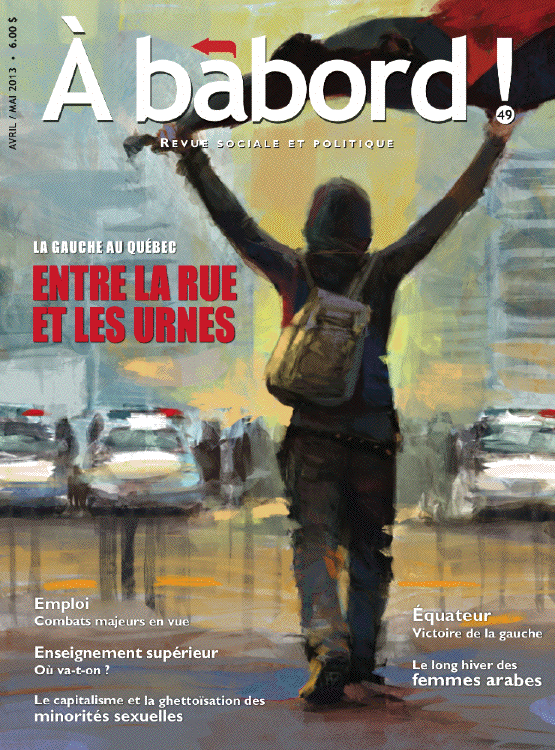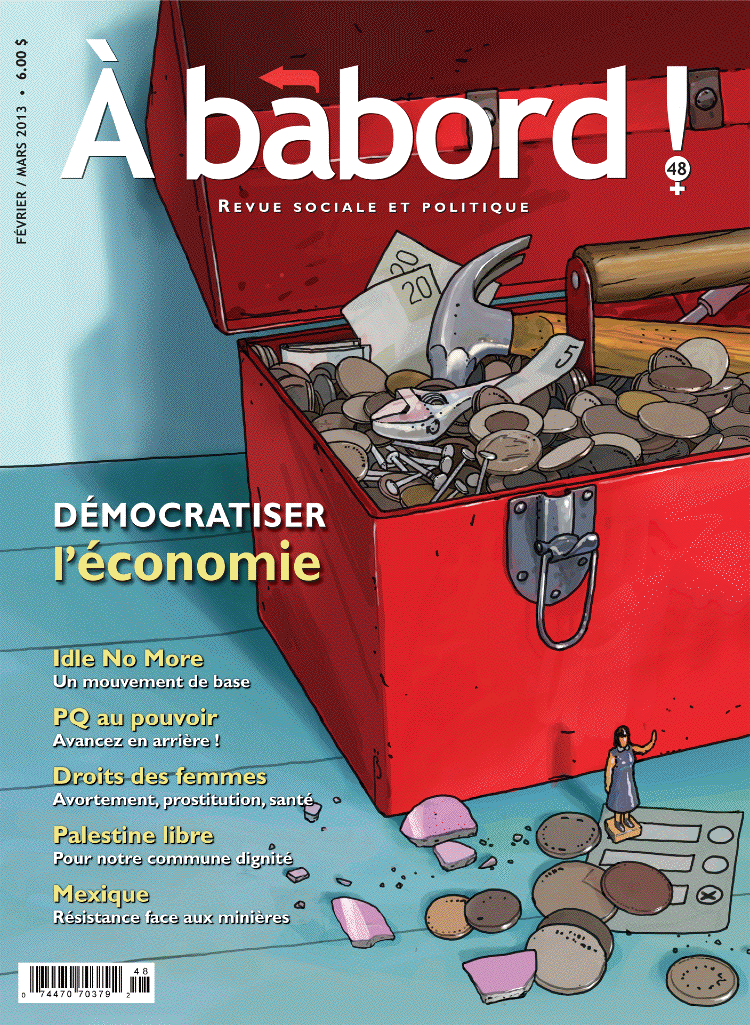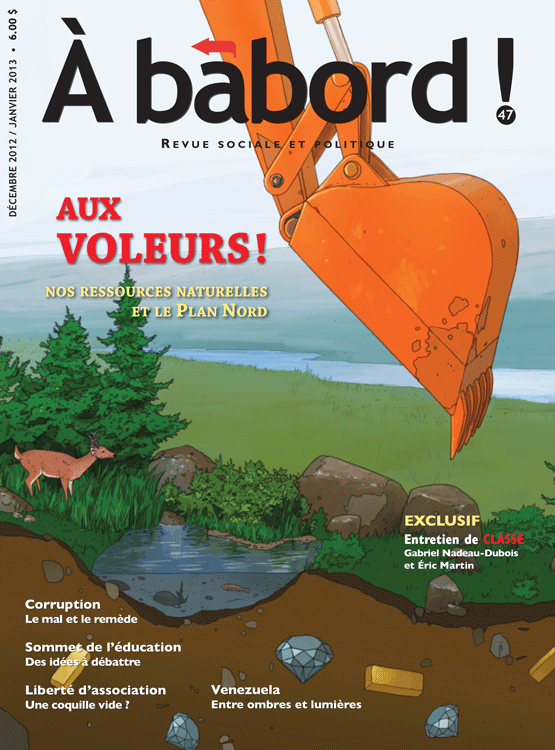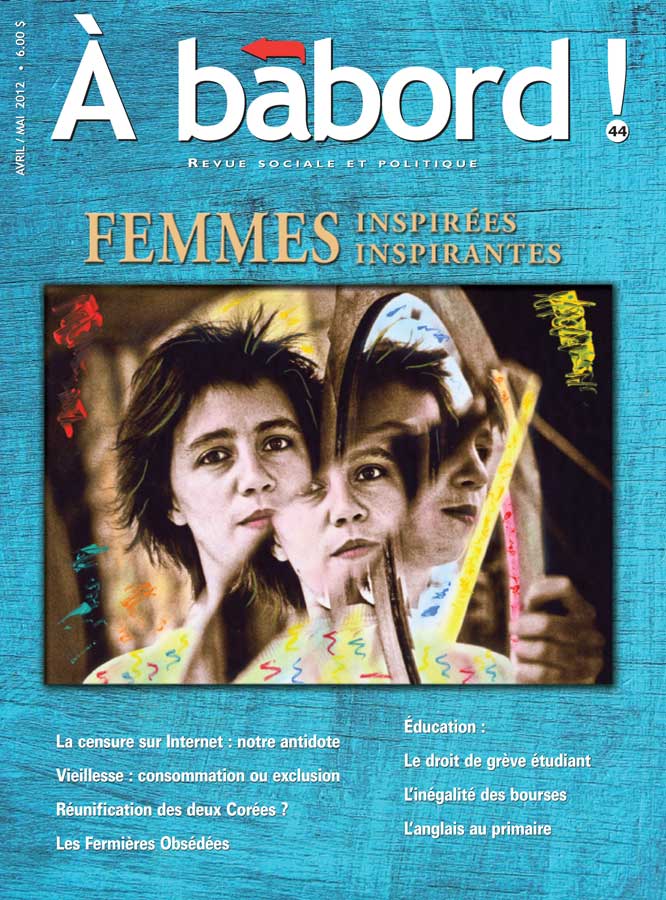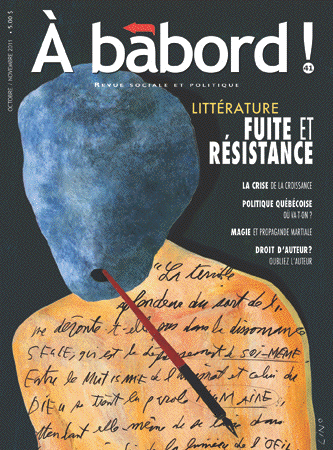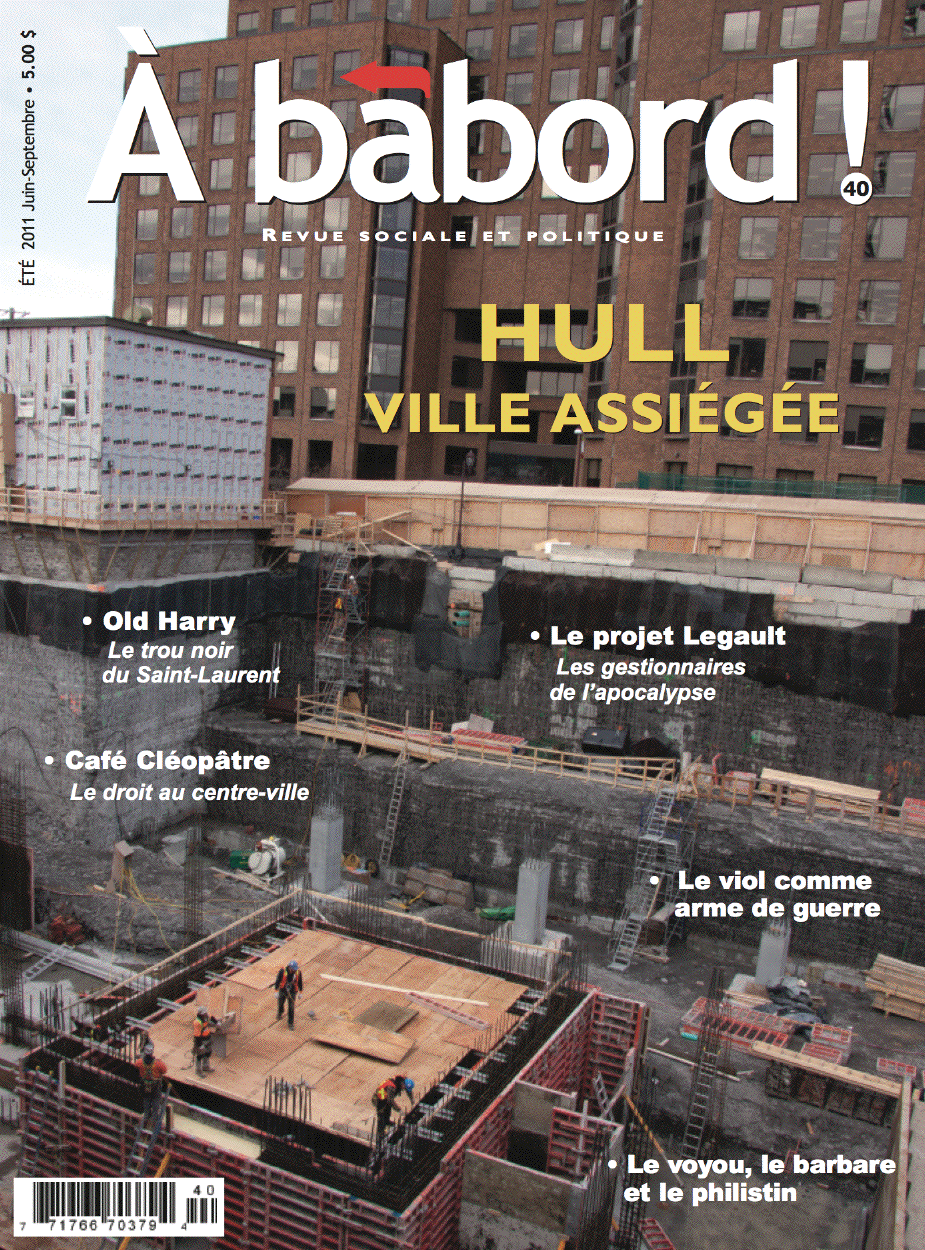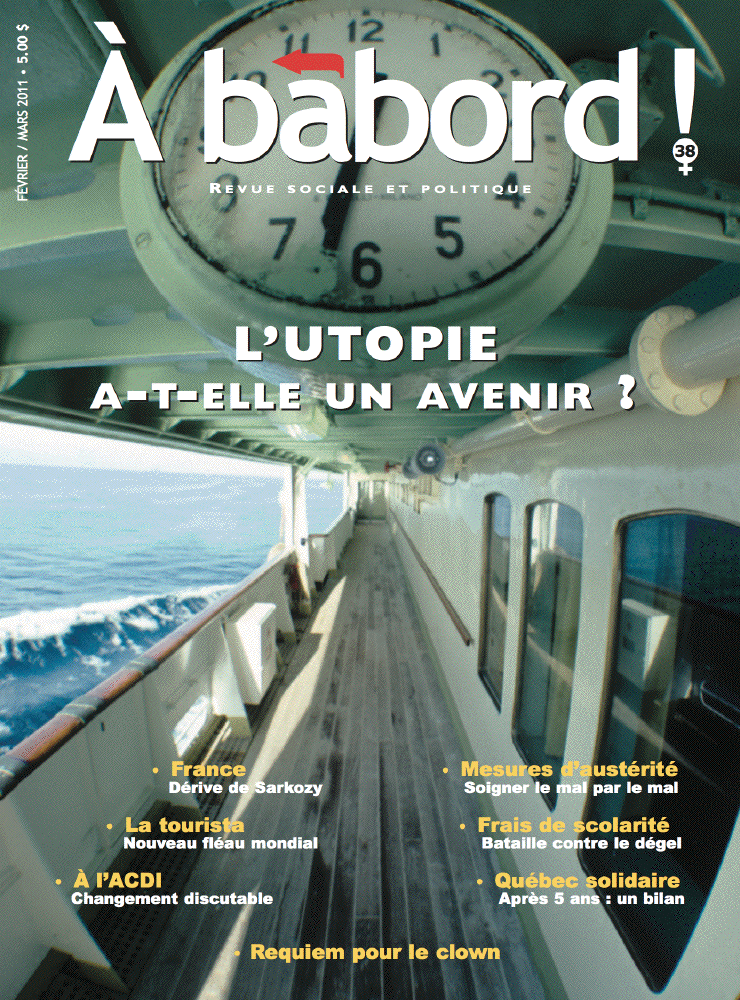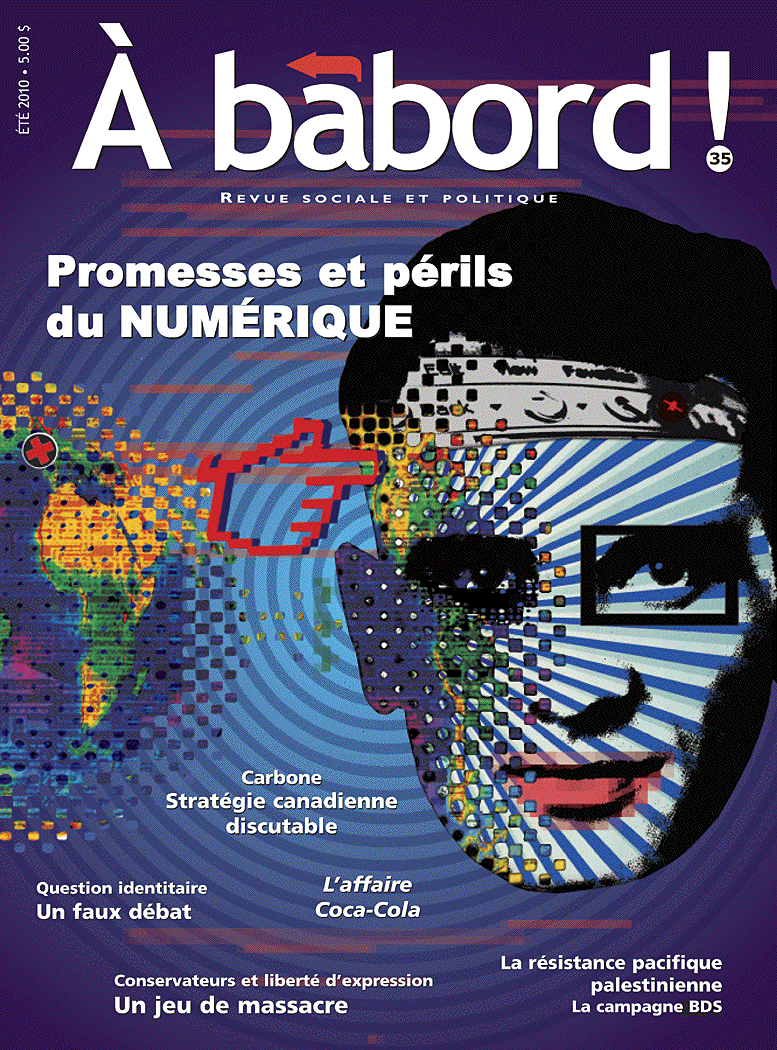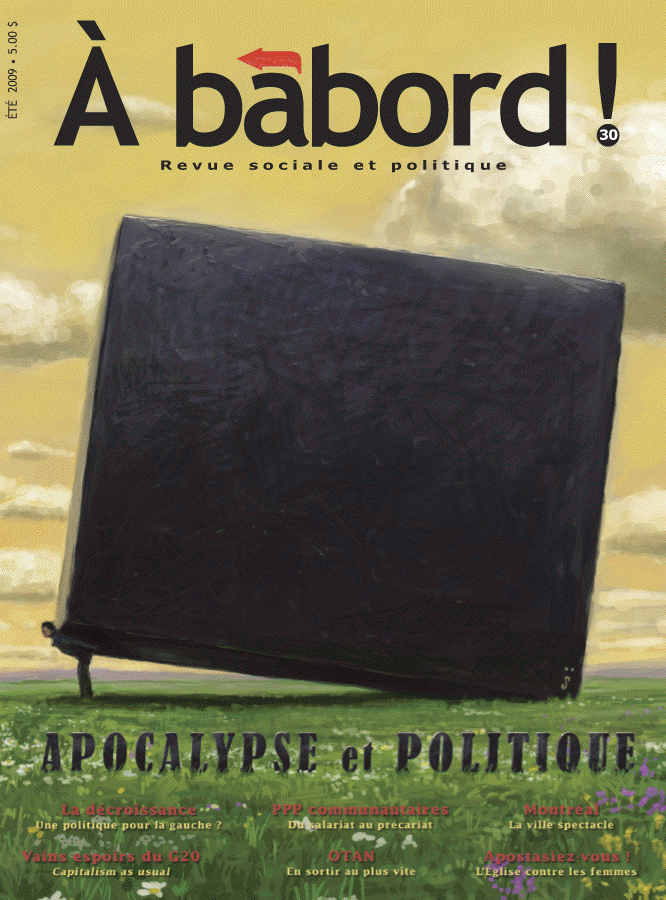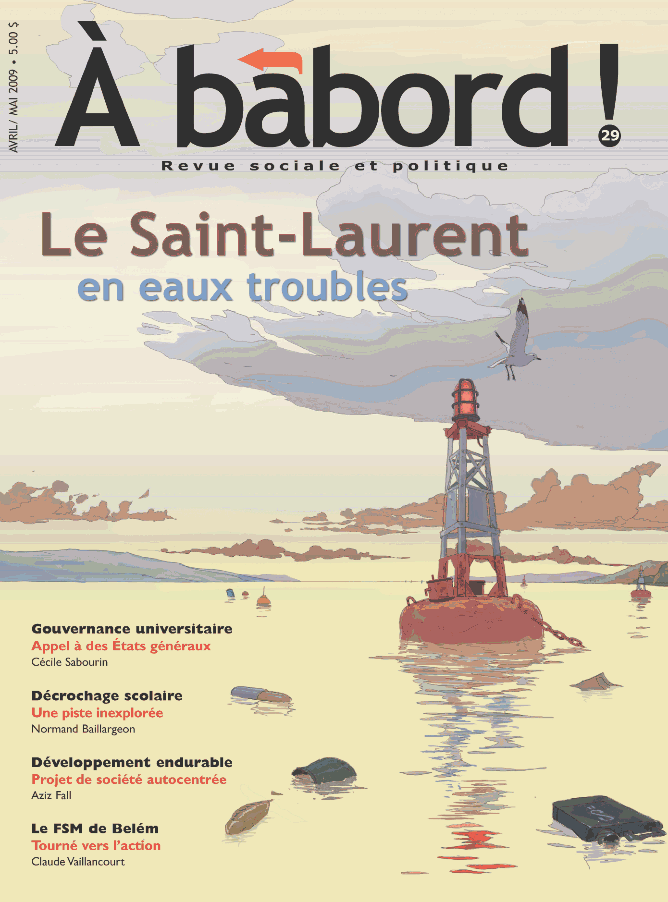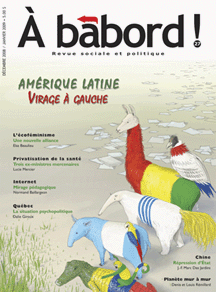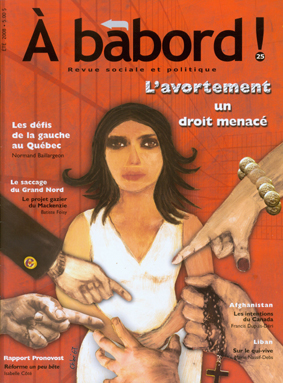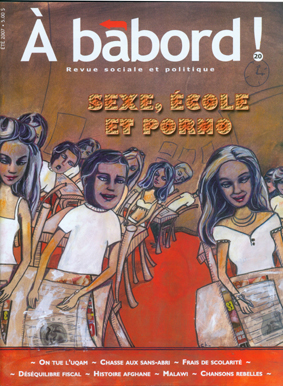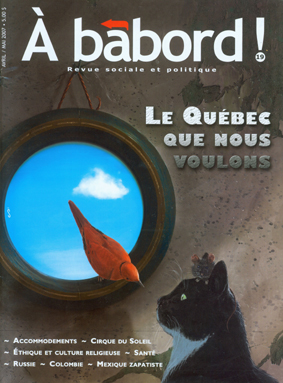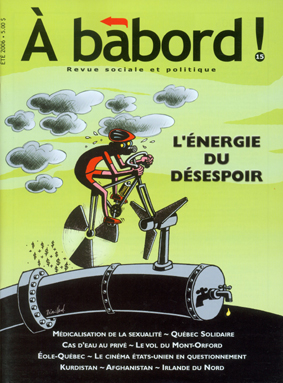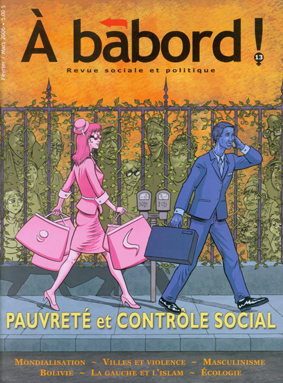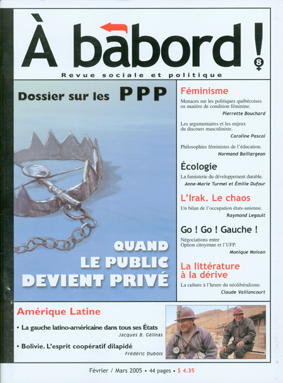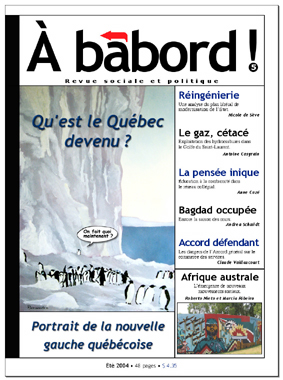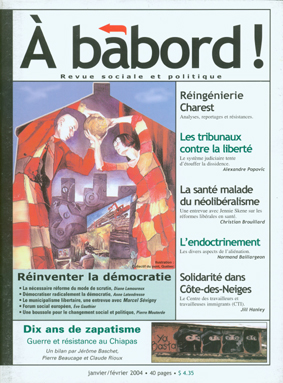Dossier : Bas-Saint-Laurent - Dépasser l’horizon
La leçon de Sainte-Paule. Une histoire politique des Opérations Dignité
Au début des années 70, le gouvernement du Québec prend la décision de fermer plusieurs villages de l’Est-du-Québec, arguant que ceux-ci ne peuvent répondre aux besoins de leur population. Plusieurs familles s’opposent à la perte de leurs terres et se mobilisent dans ce qui portera le nom des Opérations Dignité pour lutter contre ce déracinement forcé.
Dans le Québec rural, il se trouve que des institutions ont été conçues et développées au siècle dernier dans la foulée de combats politiques menés par les mouvements sociaux ruraux afin justement d’accroître la maîtrise des communautés sur leur propre destin. Le Bas-Saint-Laurent est probablement l’endroit au Québec où l’on a poussé le plus loin les initiatives de développement local et régional. Pour cela, la mise en place de ces institutions a constitué un moment lumineux d’expérimentation sociale, dont l’histoire est susceptible d’alimenter les réflexions stratégiques sur l’avenir des territoires ruraux.
« Chez nous, c’est chez nous »
Nous pouvons faire remonter cette histoire à l’un de ses moments les plus significatifs. Un mois avant la crise d’Octobre, en 1970, des citoyen·nes d’un peu partout dans la région ont convergé vers l’église du village de Sainte-Paule, dans le haut pays du Bas-Saint-Laurent. Cette mobilisation populaire, animée par une élite locale ayant pris le parti de leur coin de pays, visait à préparer une riposte collective à un processus de rationalisation du territoire de tout l’Est-du-Québec. Ce processus s’était traduit par une première vague de fermetures de dix villages agroforestiers du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie en 1969. Une autre allait suivre peu de temps après, de 1970 à 1972. Un rouleau compresseur était en marche et il fallait l’arrêter.
Mais pourquoi ces fermetures ? Alors appelés « paroisses marginales », ces villages étaient jugés inaptes à répondre aux besoins à long terme de leurs habitant·es par les équipes du Bureau d’aménagement de l’Est-du-Québec (BAEQ), un organisme du gouvernement du Québec. On proposait à ces habitant·es d’être relocalisé·es dans des centres urbanisés de la région, dans des maisons construites spécifiquement pour cela. Si des familles s’étaient résignées, d’autres se sont accrochées pendant un temps, avant d’être contraintes d’accepter l’offre de relocalisation. Des milieux de vie ont ainsi été disloqués et des villages ont été démolis par les mains de celles et ceux qui les avaient bâtis trente années plus tôt.
Si l’économie de ces paroisses était peu diversifiée et ces villages parvenaient encore difficilement à offrir des perspectives intéressantes à sa jeunesse, ce n’était pas par manque de volonté ou d’ingéniosité de cette dernière. Ces établissements situés aux limites de l’écoumène habité avaient été ouverts à la colonisation dans les années 1930 sans avoir les moyens nécessaires pour se développer. Des familles entières avaient été invitées à s’installer dans ces « pays neufs », avec l’agriculture pionnière comme principale activité « économique ». Un râteau, une hache, au revoir et bonne chance. En dépit de l’omniprésence des massifs forestiers sur le territoire, leur accès était réservé à quelques grandes compagnies de pâte et à des clubs de villégiature fréquentés par des Américain·es, limitant substantiellement les possibilités de développer une économie forestière diversifiée. Ainsi, loin d’être une fatalité, la situation des « paroisses marginales » dans les années 1950 et 1960 était le fruit d’une série de choix économiques et politiques qui empêchaient d’avance leur essor.
C’est précisément pour dénoncer ces choix qui culminaient maintenant dans la fermeture des villages qu’une première grande assemblée citoyenne eut lieu à Sainte-Paule en 1970 afin de donner du mordant et de la structure à ce mouvement de résistance rurale. Non seulement s’agissait-il d’arrêter le rouleau compresseur des relocalisations, mais il était surtout question d’avancer des propositions d’institutions destinées à donner aux localités une maîtrise de leur développement. Loin de se laisser abattre, les habitant·es du haut pays ont misé sur l’action politique de long terme, qui allait osciller entre conflictualité, concertation et pédagogie sociale. C’est ainsi qu’a pris forme un mouvement social rural que l’on a surnommé les Opérations Dignité.
Un autre modèle de développement
L’assemblée générale rurale qui eut lieu à Sainte-Paule entraîna toute une série d’actions politiques allant des manifestations spontanées à la création de comités locaux d’animation et de formation. Une autre grande assemblée populaire eut lieu à Esprit-Saint en 1971, et une troisième en 1972 à Les Méchins, lesquelles furent respectivement baptisées Opérations Dignité 2 et 3.
Les Opérations Dignité avaient plusieurs forces. L’une d’entre elles était de se concevoir comme un pilier de transformation de la société et de l’économie. Les Opérations Dignité ont très tôt proposé la création d’institutions susceptibles de donner à la ruralité québécoise en général et bas-laurentienne en particulier des leviers de maîtrise de son avenir. Ces institutions étaient pensées comme l’amorce d’un autre modèle de développement, qui romprait aussi bien avec le tout au marché qu’avec le tout à l’État. On proposa notamment :
* l’élaboration d’un cadre favorisant le développement de fermes forestières, en permettant l’accès spécifique aux forêts publiques de proximité ;
* la mise sur pied d’organismes de gestion en commun des ressources naturelles des localités pour un réinvestissement prioritaire dans la région ;
* la mise à la disposition des communautés de capitaux patients destinés à financer sur le long terme des projets structurants pour l’économie et la vitalité des villages ;
* des règles pour faciliter le regroupement des propriétaires de lots forestiers privés afin qu’ils puissent mutualiser des moyens pour soutenir la viabilité de leurs exploitations et contribuer à la vitalité de leurs villages ;
* la décentralisation des lieux de décisions politiques vers les paliers régionaux du Québec, afin que les communautés puissent davantage agir par elles-mêmes et pour elles-mêmes.
Beaucoup de ces propositions sont restées lettre morte ; d’autres ont été mises en œuvre. C’est le cas notamment des Groupements forestiers de l’Est, destinés à réunir des propriétaires de lots privés, mais aussi des Sociétés d’exploitation des ressources (SER). Mentionnons aussi que des mécanismes renforçant la viabilité des fermes de petite taille et les capacités de négociation des agriculteurs vis-à-vis l’industrie ont été adoptés dans la foulée des Opérations Dignité.
Il est clair que le modèle alternatif de développement que visaient les forces vives du mouvement ne s’est pas concrétisé : l’essoufflement des troupes, l’exode rural continu, la puissance des intérêts des compagnies privées et la situation constitutionnelle du Québec ont miné les assises de cette révolution tranquille espérée de la ruralité. Cela dit, les Opérations Dignité ont laissé dans la région des traces profondes qui sont encore visibles aujourd’hui. L’une d’entre elles est une culture de la concertation et de la participation, qui se manifeste dans plusieurs domaines et secteurs de la vie du Bas-Saint-Laurent.
Que sont devenues les institutions de la ruralité ?
Des bilans de cette période ont été faits par plusieurs personnes impliquées de près ou de loin dans ce mouvement. Ces bilans sont importants : ils permettent de transmettre la mémoire des combats qui ont façonné la société à laquelle nous appartenons. Comme le suggère indirectement la devise du Québec que l’on retrouve sur les plaques automobiles, l’oubli accroît l’aliénation. Cela dit, il nous semble qu’un volet de ce bilan reste à faire, soit celui de l’évolution récente des institutions économiques issues de ce mouvement. Avec la transition écologique comme horizon, tout devra être questionné. Il s’agit d’institutions qui ont été créées pour soutenir le développement endogène du milieu, combattre la dévitalisation et défendre un autre modèle où prime l’habitation du territoire sur l’extraction des ressources naturelles.
À ce titre, le cas des Groupements forestiers vient spontanément en tête. À bien voir comment ont évolué certains de ces groupements, il semble qu’ils se sont progressivement retournés contre la raison fondamentale qui les a fait naître. De moyens mis à la disposition des propriétaires de lots pour favoriser la pérennité de leurs entreprises ainsi que de leurs communautés, des groupements sont devenus dans certains cas des agents de déstructuration des milieux. Certains groupements sont ainsi très actifs sur le marché des terres forestières en achetant plusieurs lots, contribuant du même coup à la hausse moyenne du prix des terres et compétitionnant directement avec des candidates et candidats de la relève. Il s’agit là de vrais problèmes.
Les institutions issues d’une revendication pour la justice et la poursuite du bien commun sont constamment menacées d’être détournées des intentions initiales qui les ont fait naître. La normalisation du néolibéralisme, la puissance de l’imaginaire anglo-américain valorisant la propriété privée et disqualifiant la poursuite de l’intérêt général ont accru cette menace. Face à cela aussi bien qu’à la situation qui prévaut dans les grandes organisations ou vis-à-vis la crise écologique, il faut écouter la leçon de Sainte-Paule : la politique est la seule alchimie qui puisse métamorphoser une situation menaçante en une occasion de changer le monde.