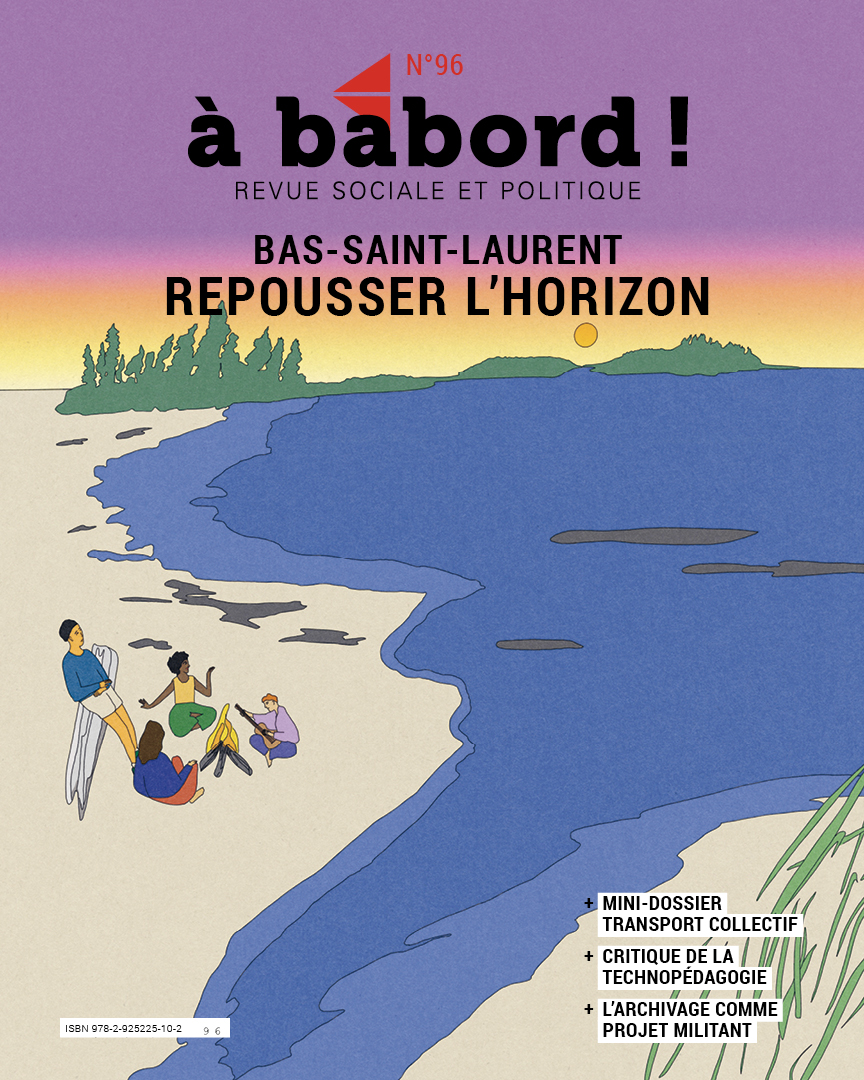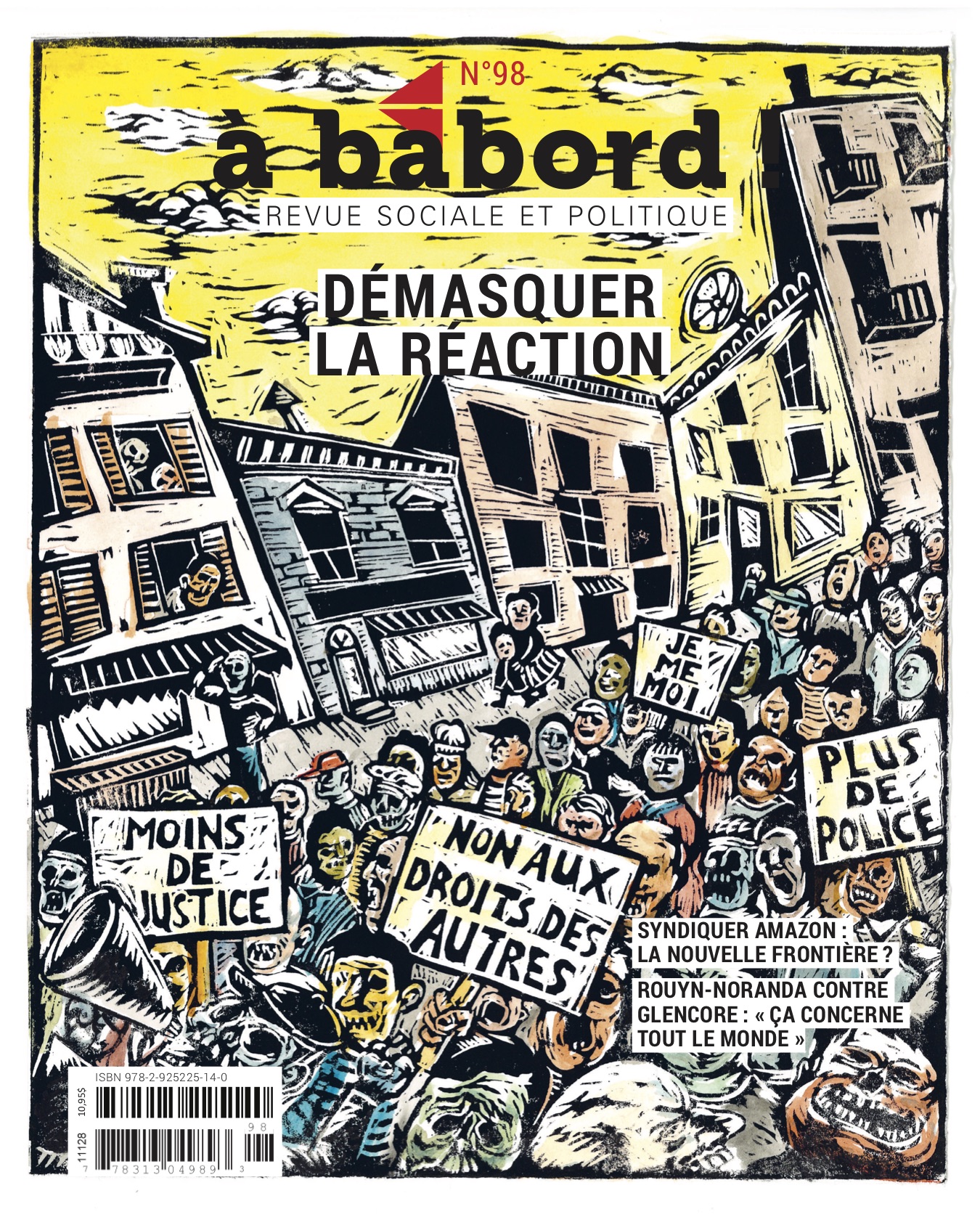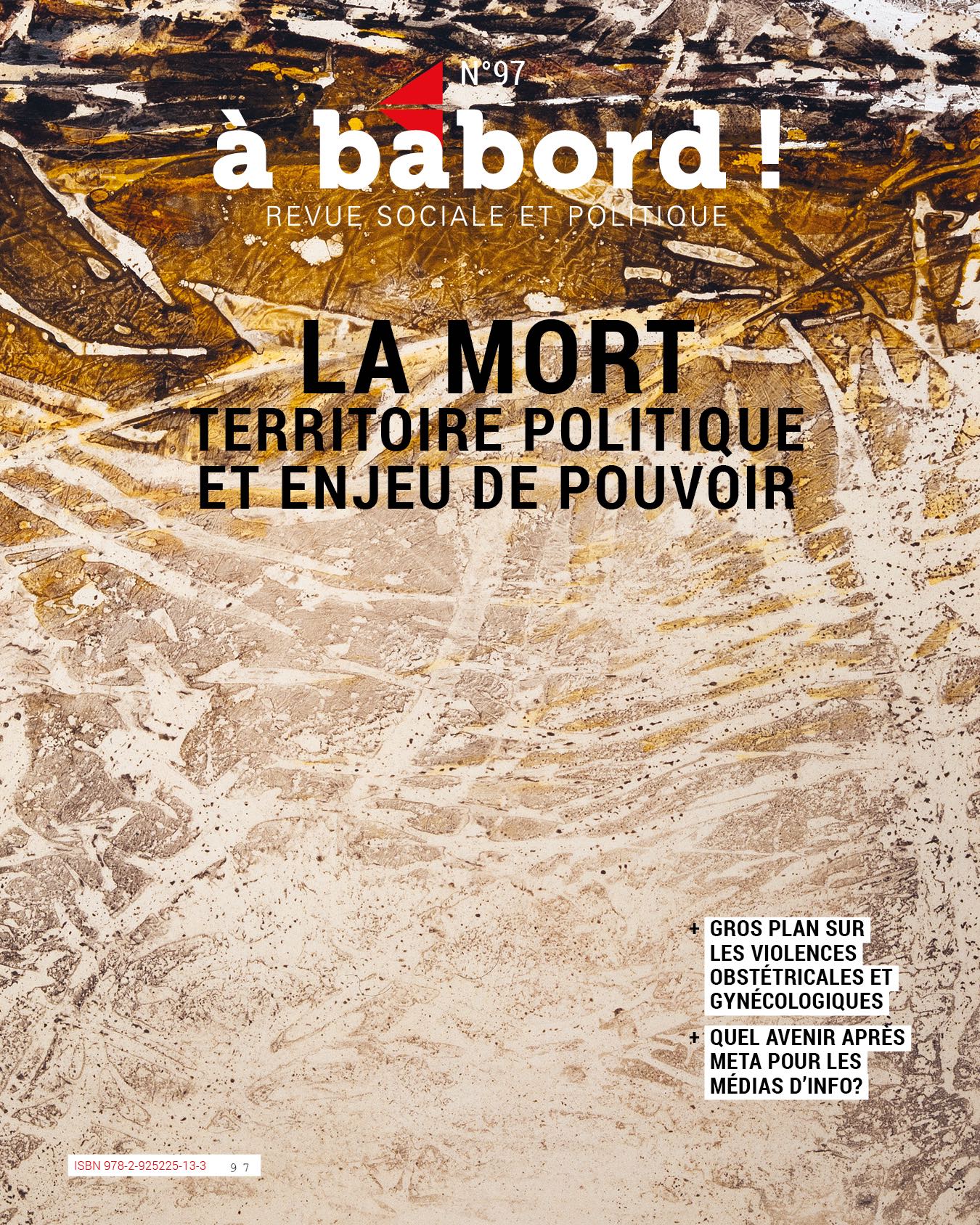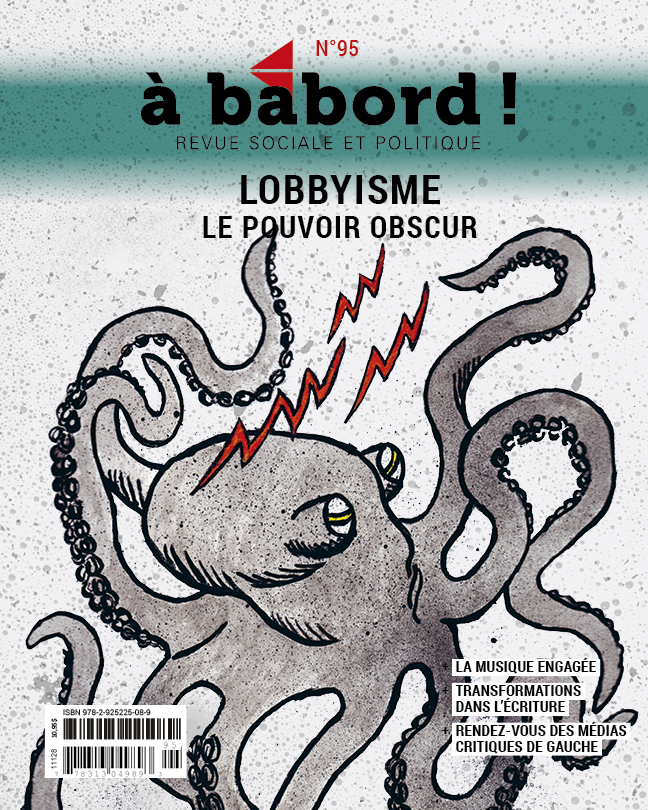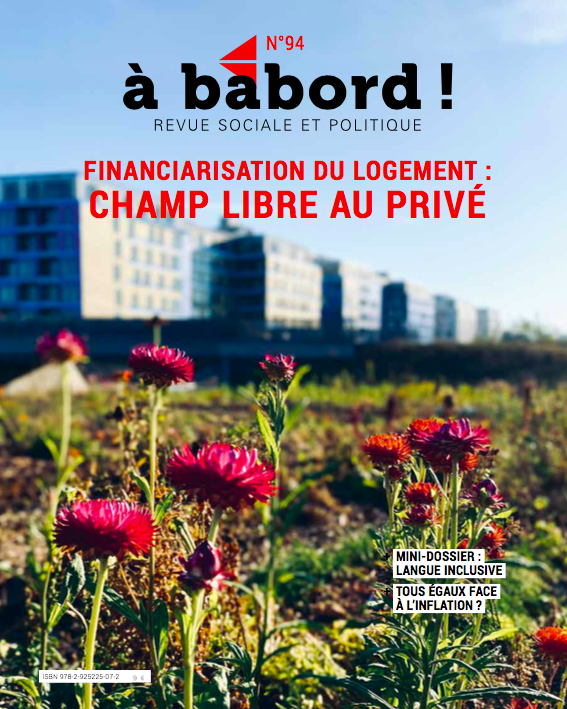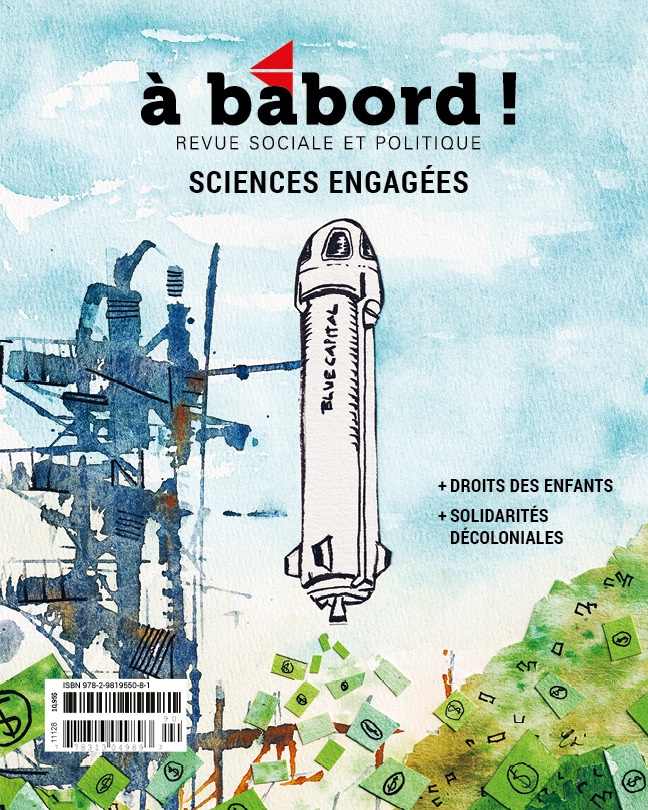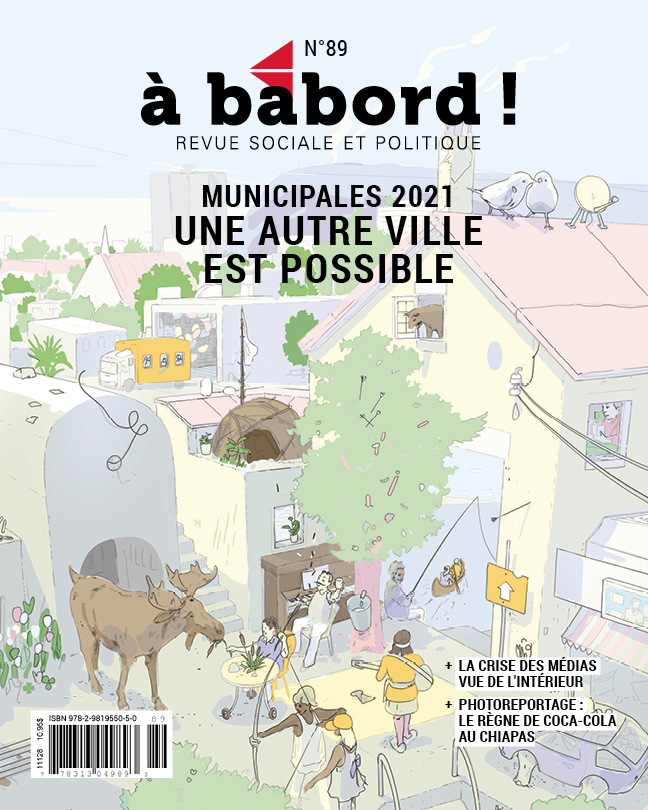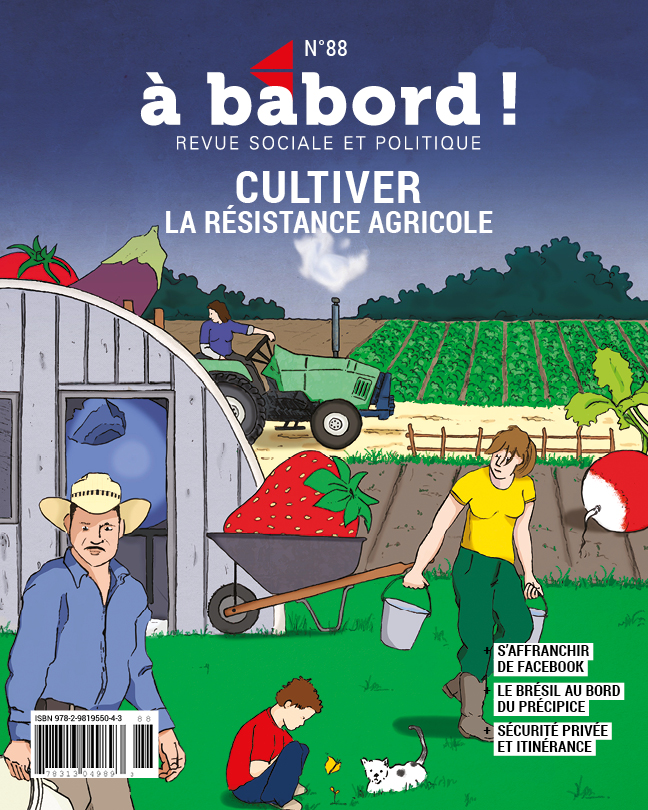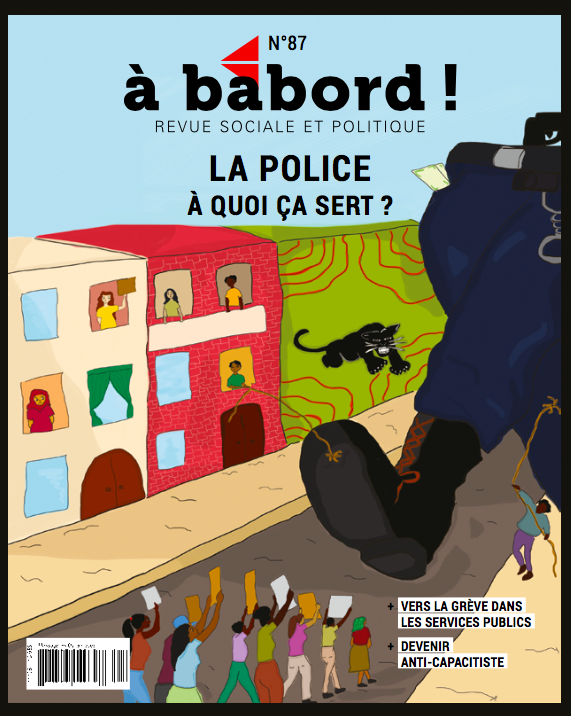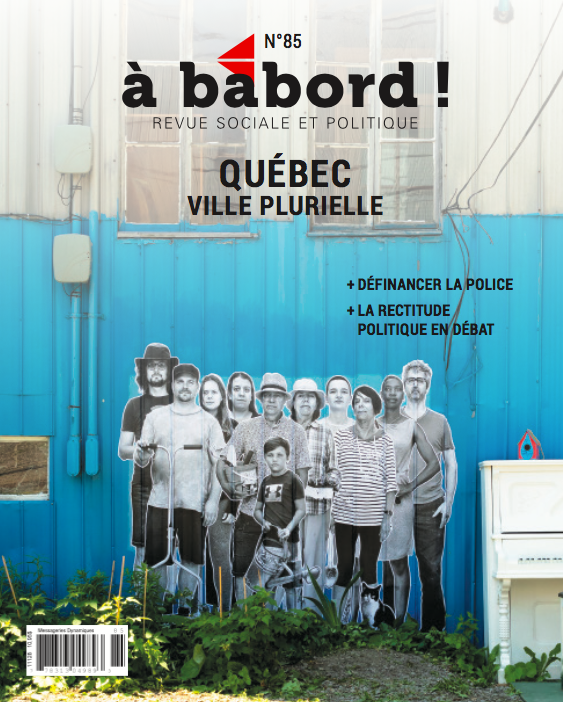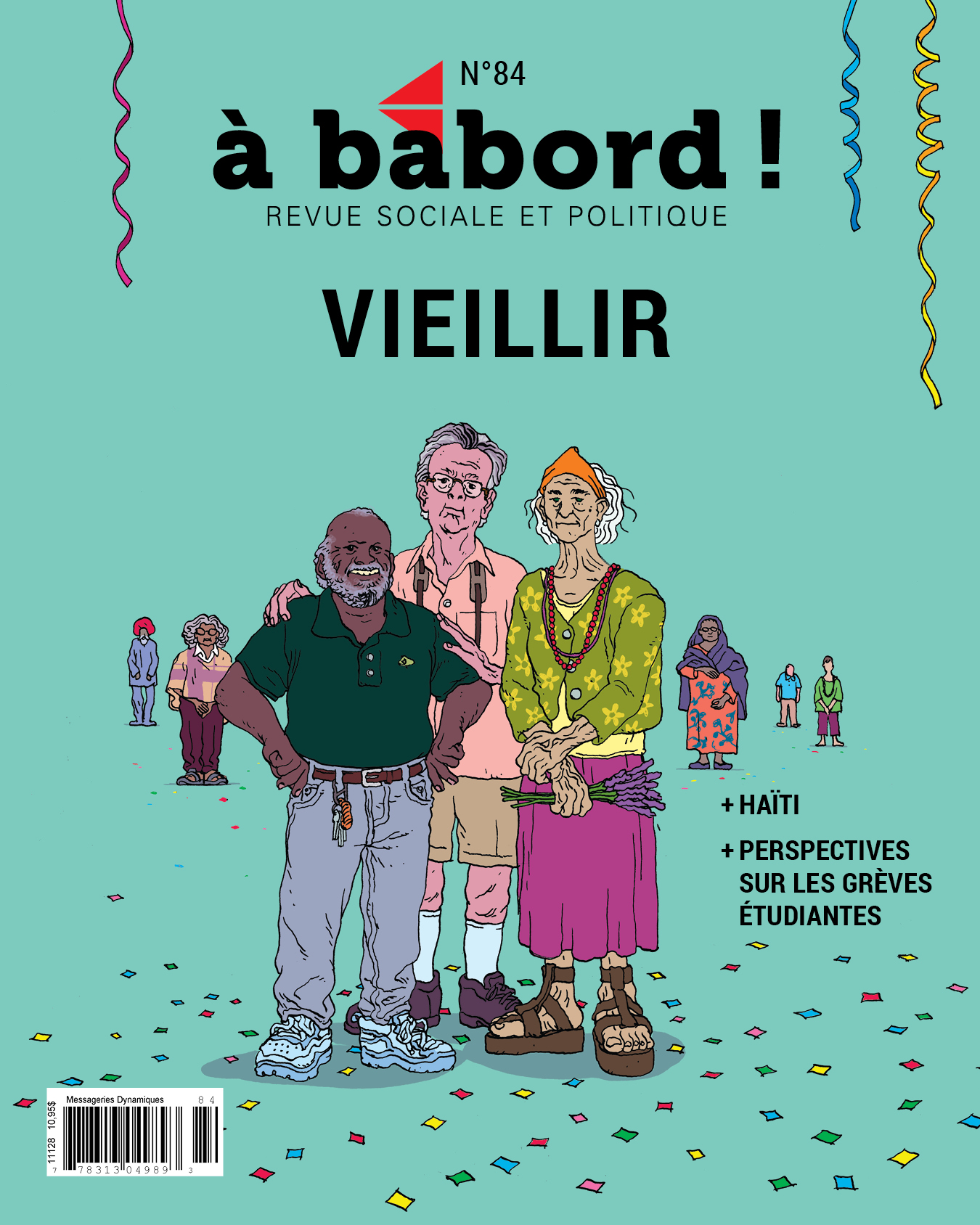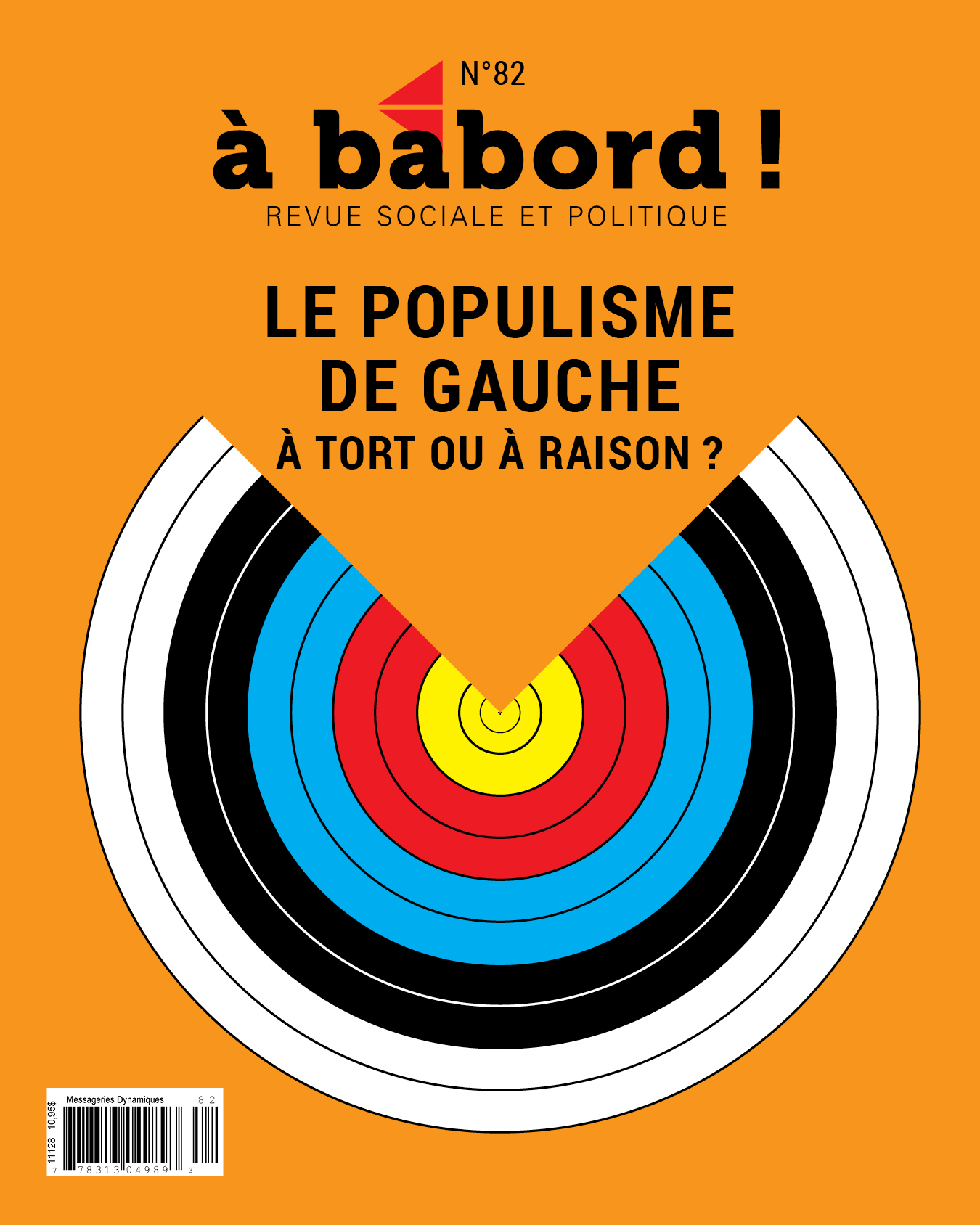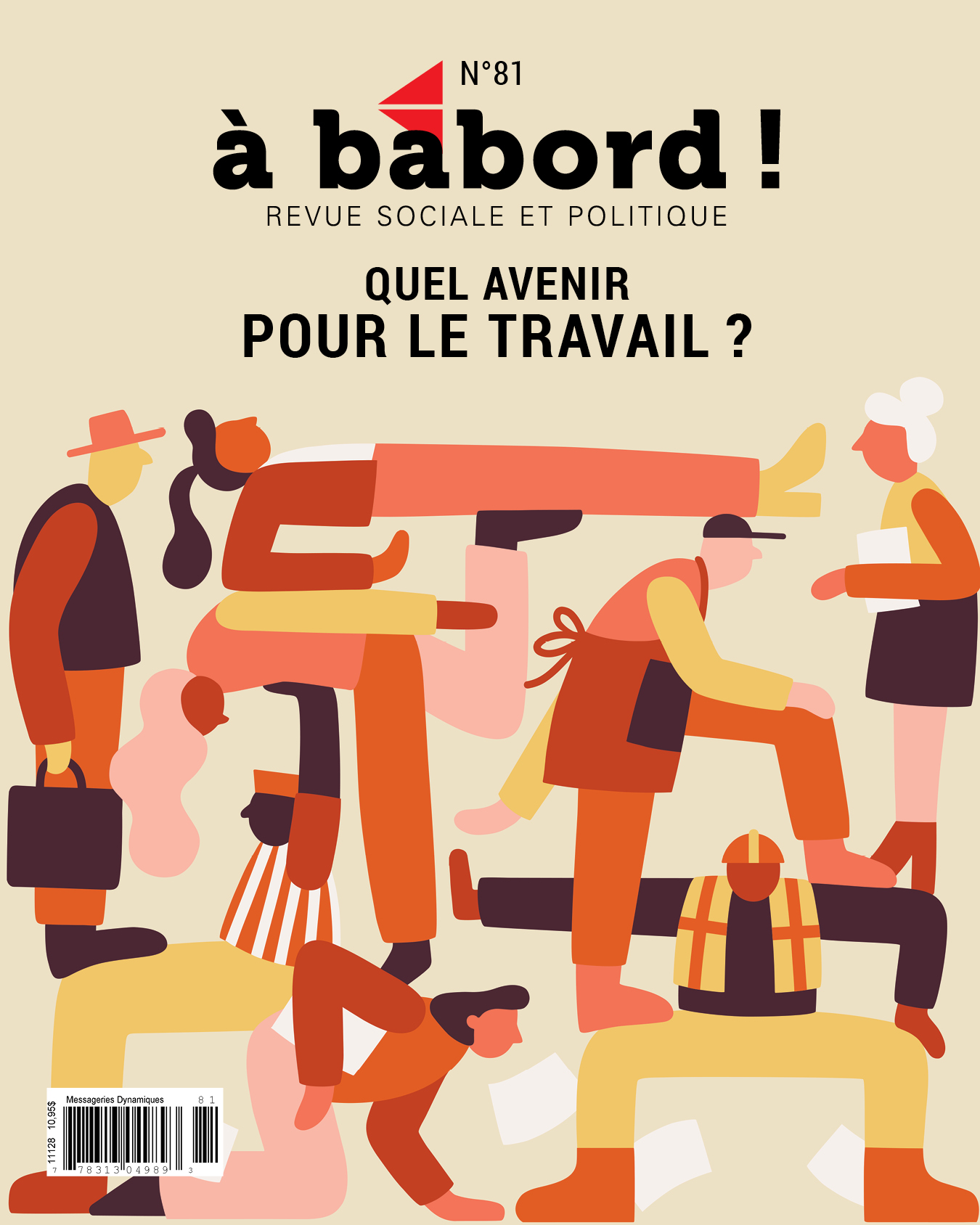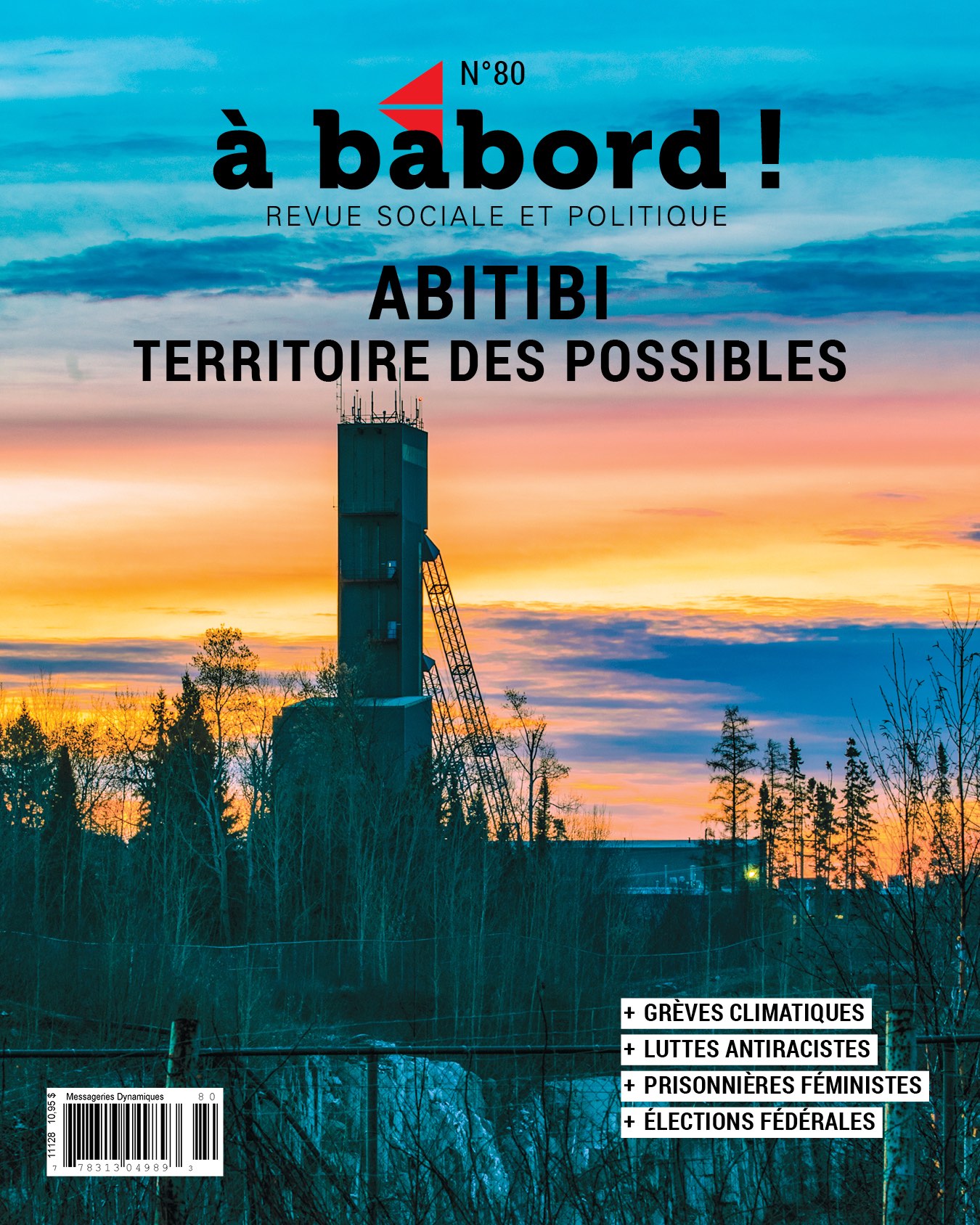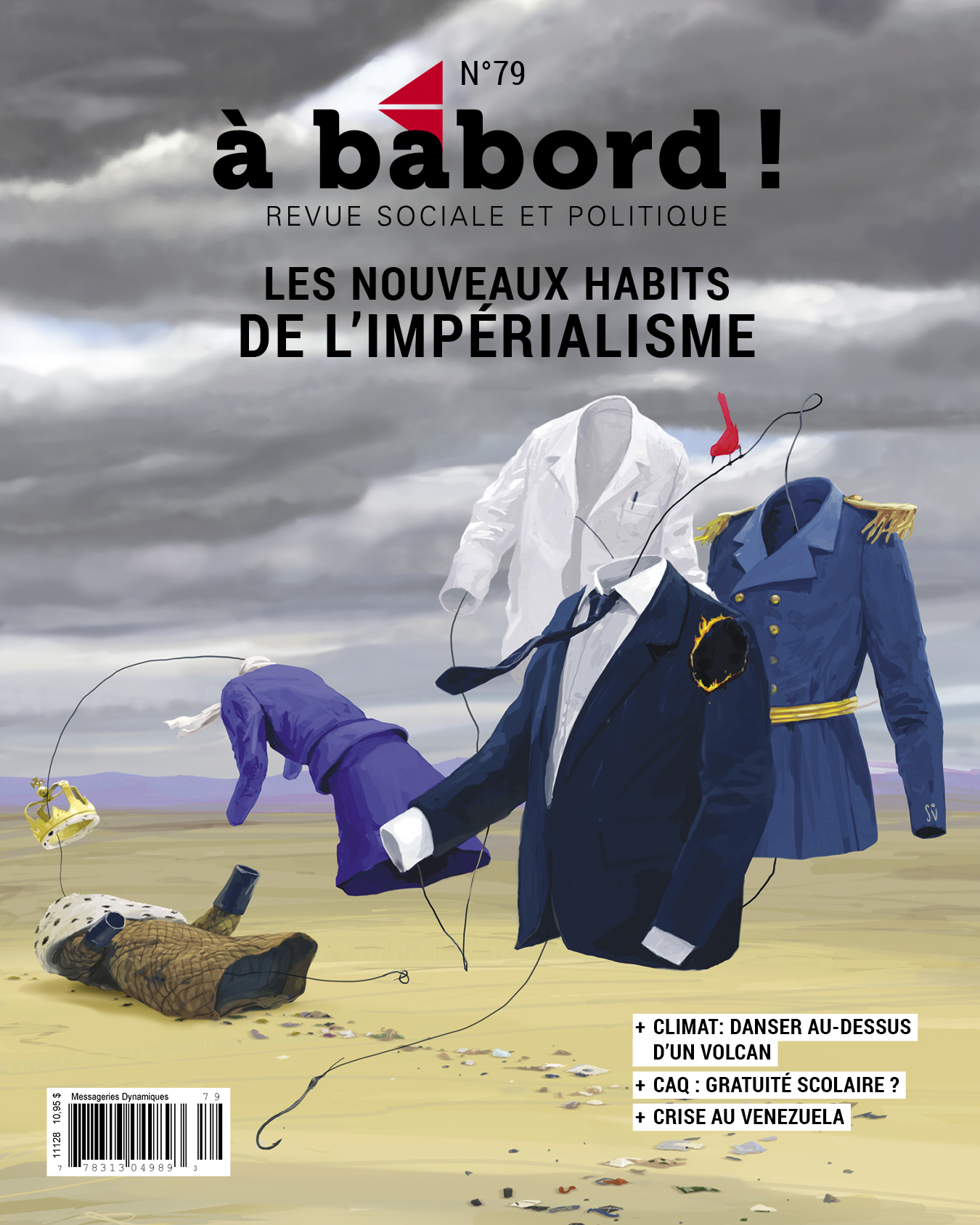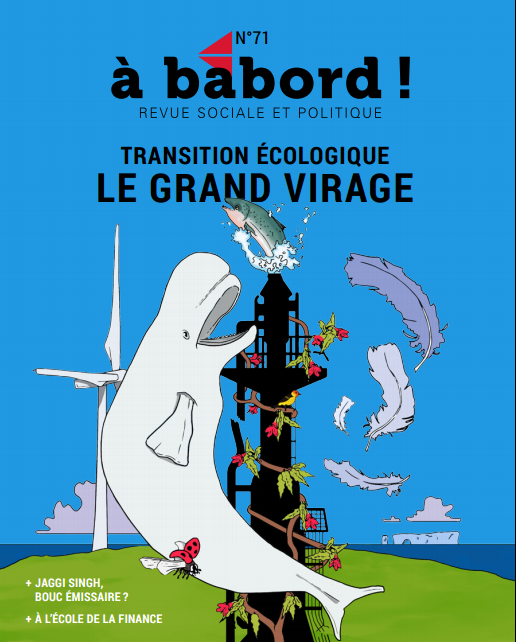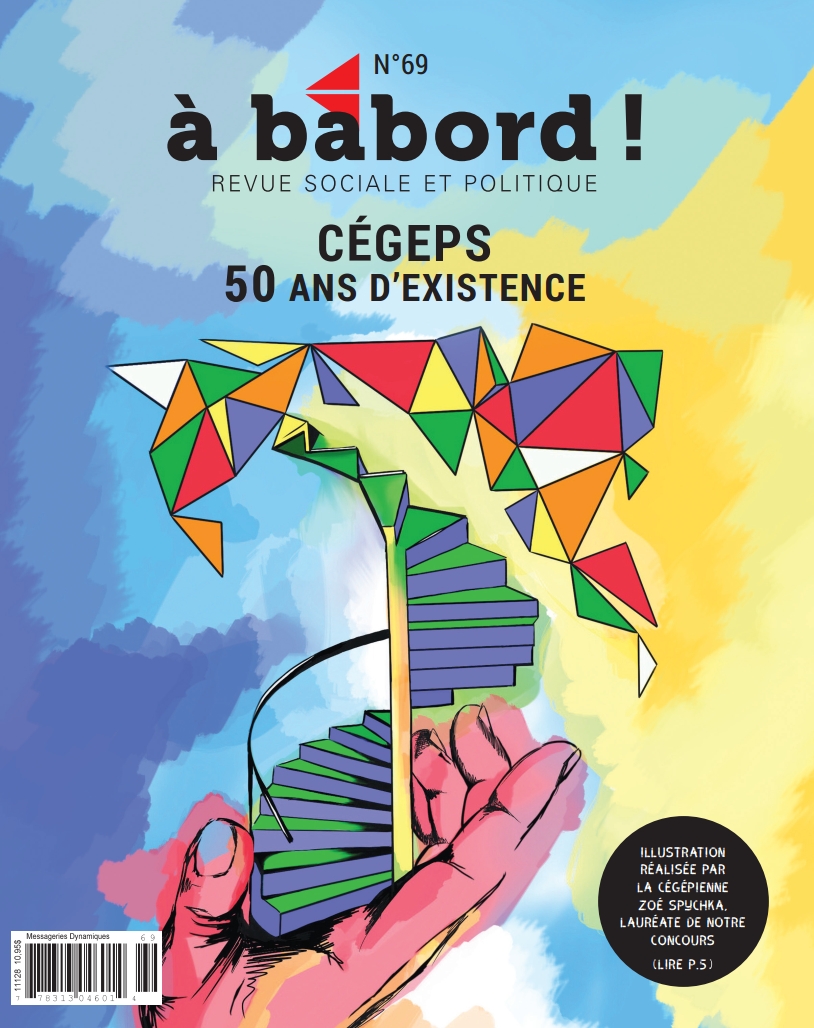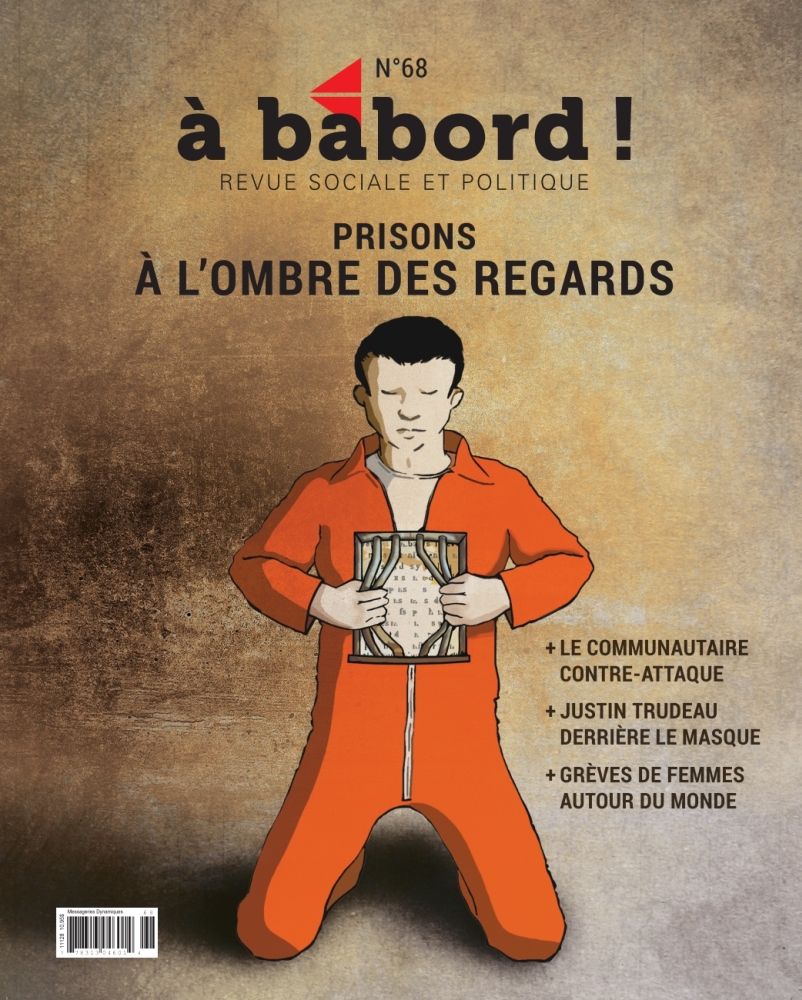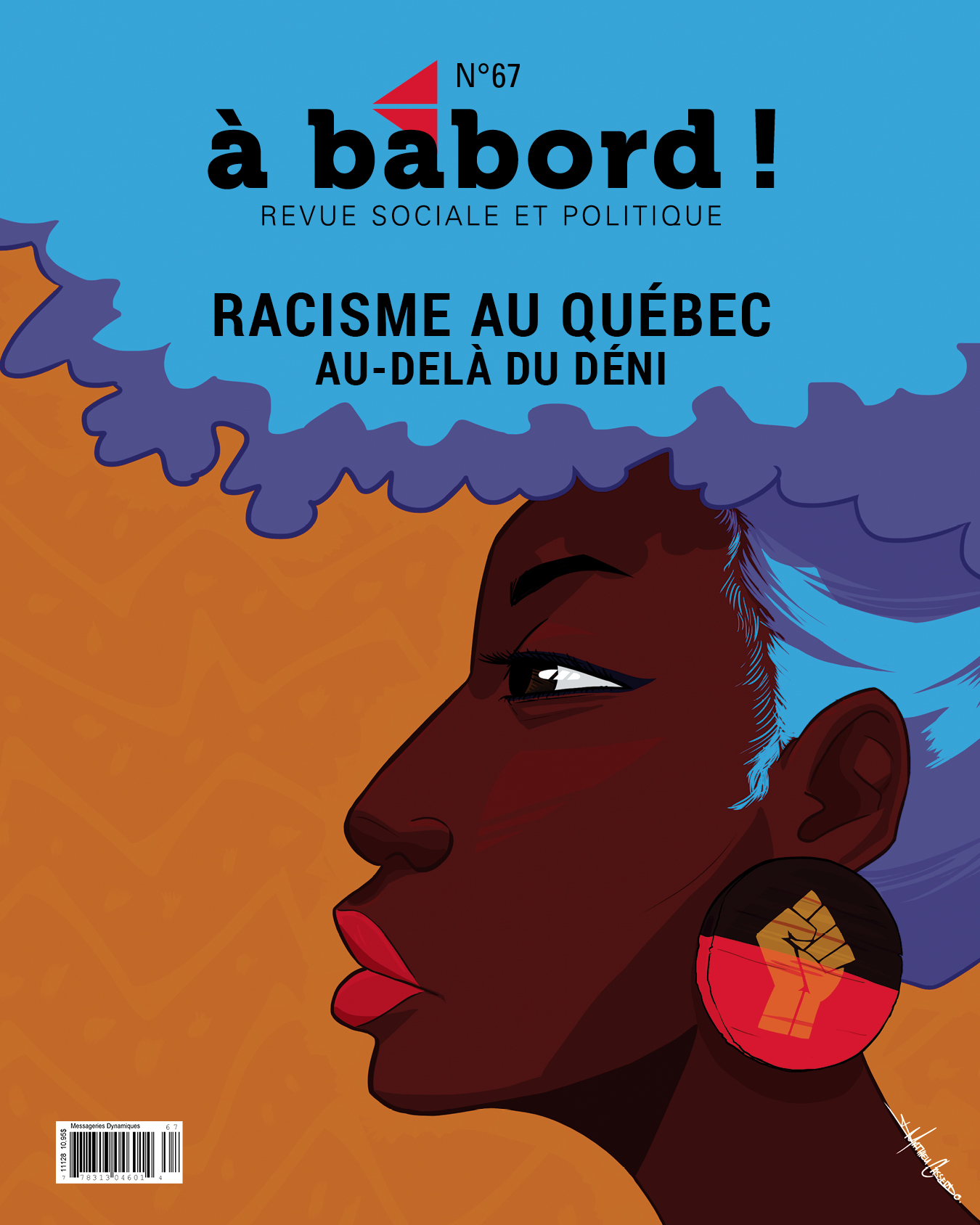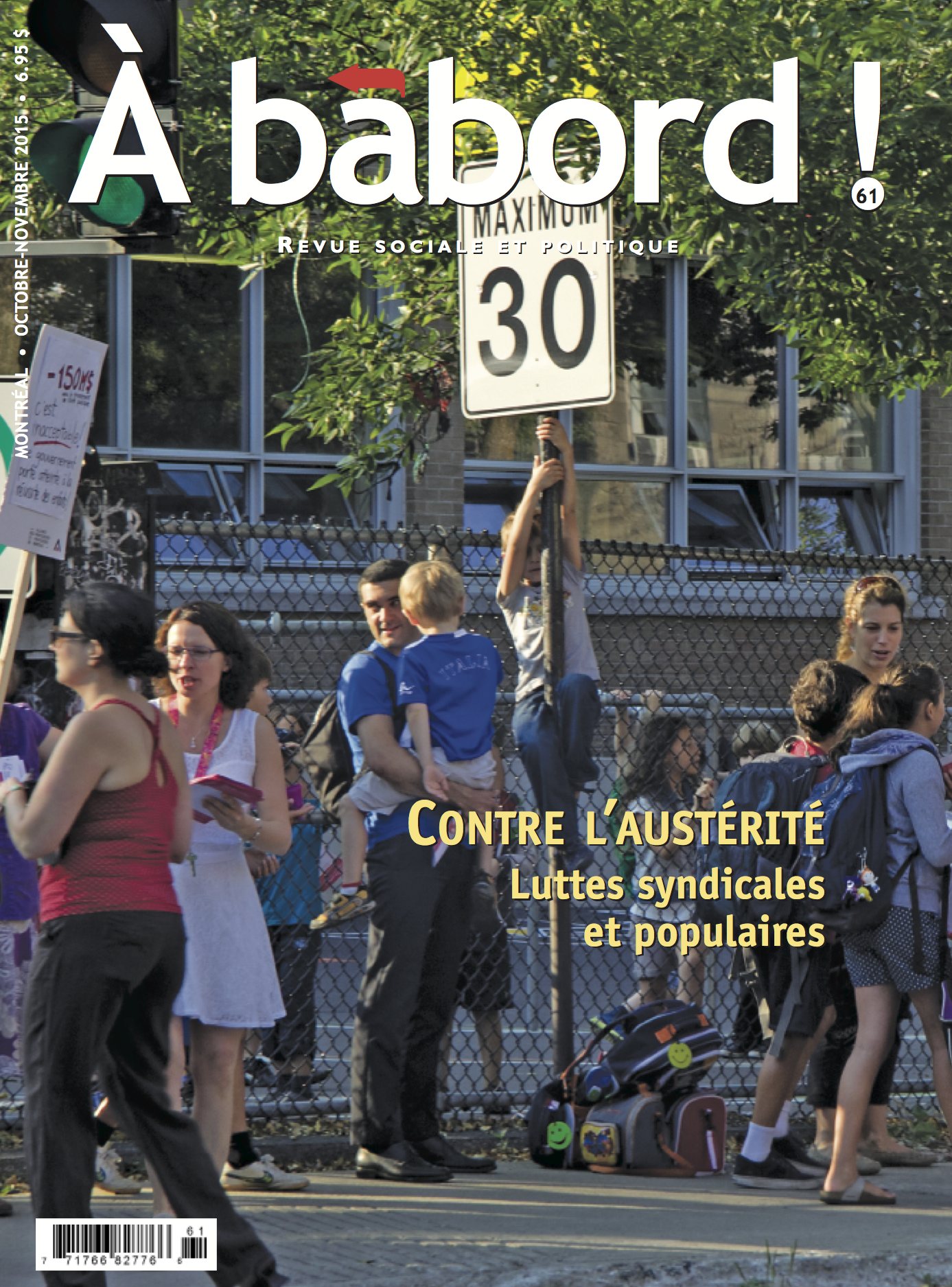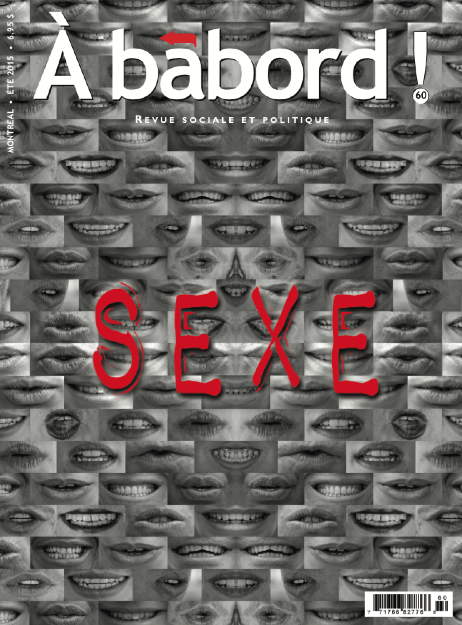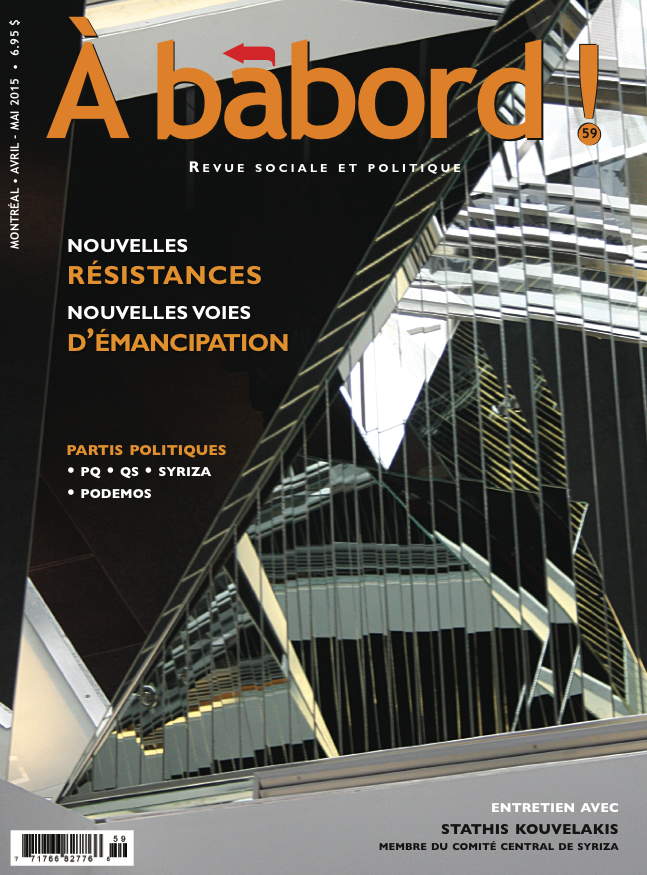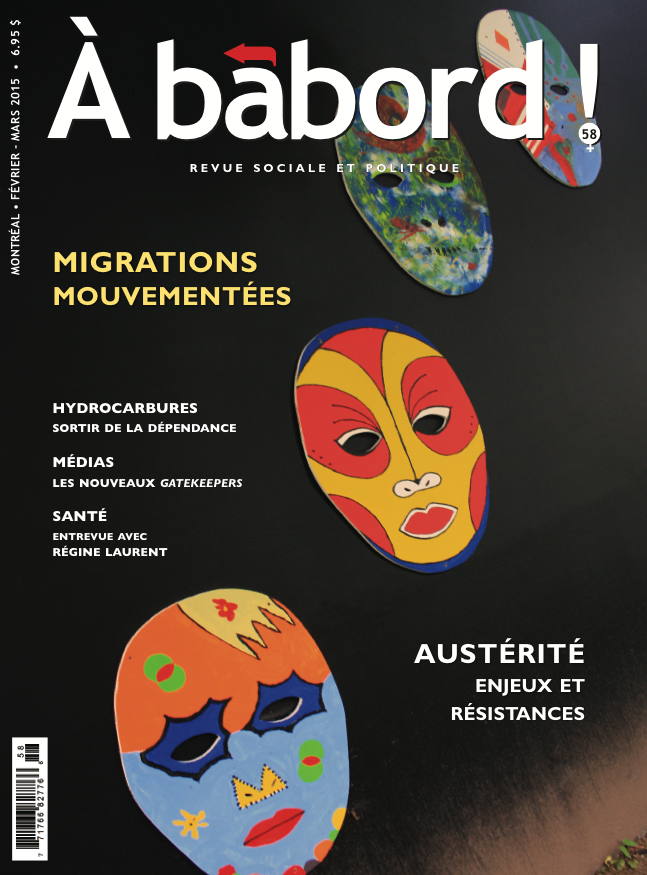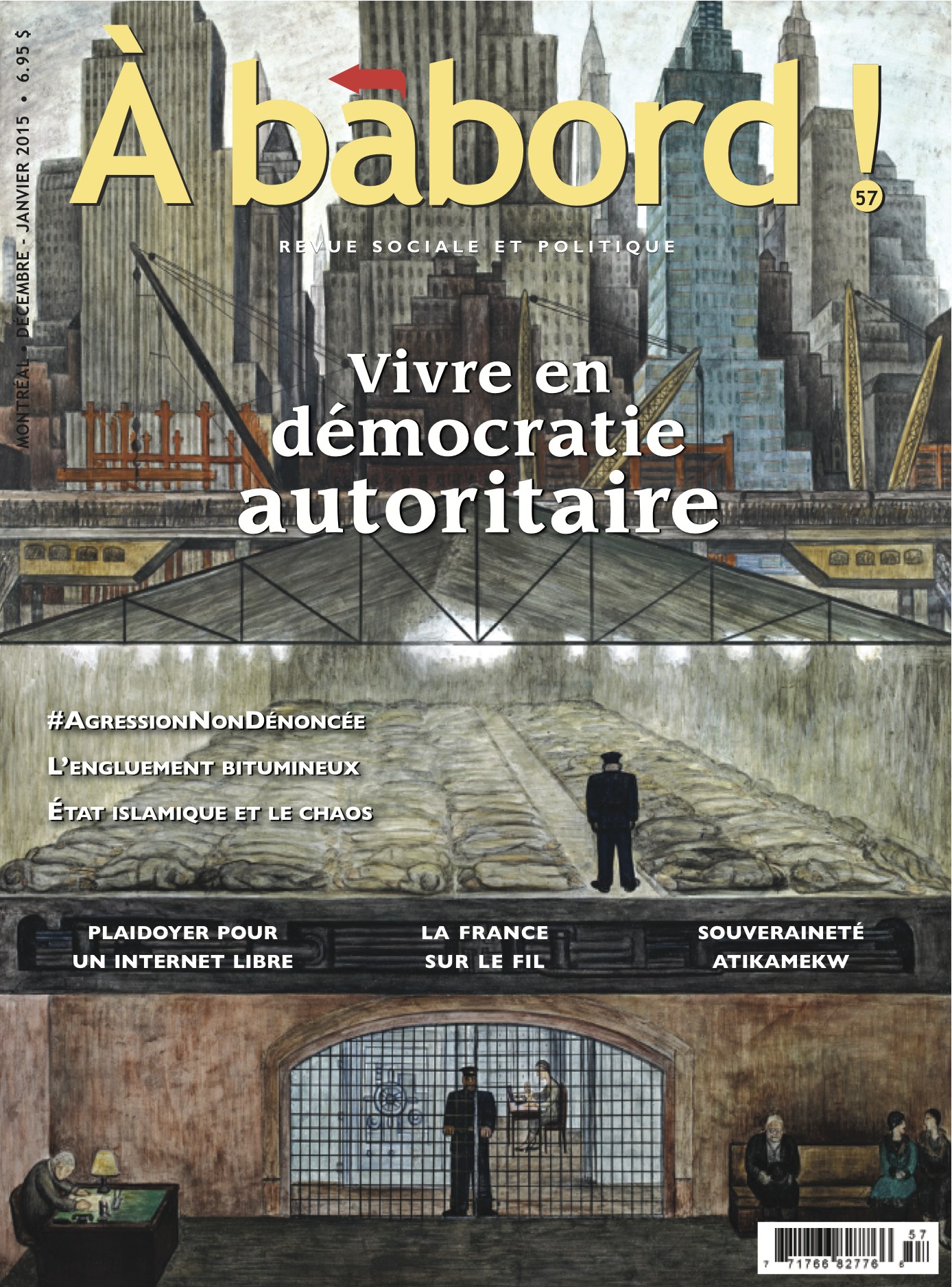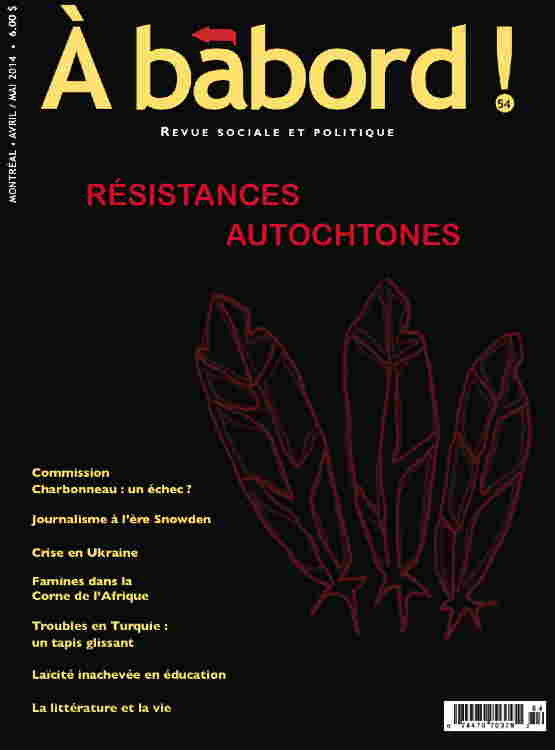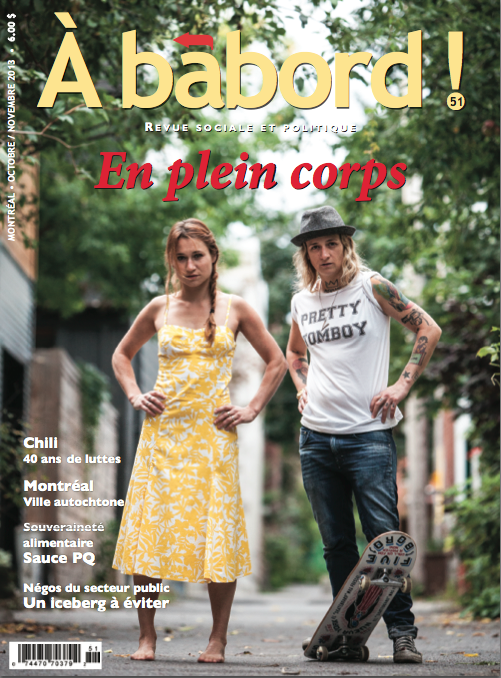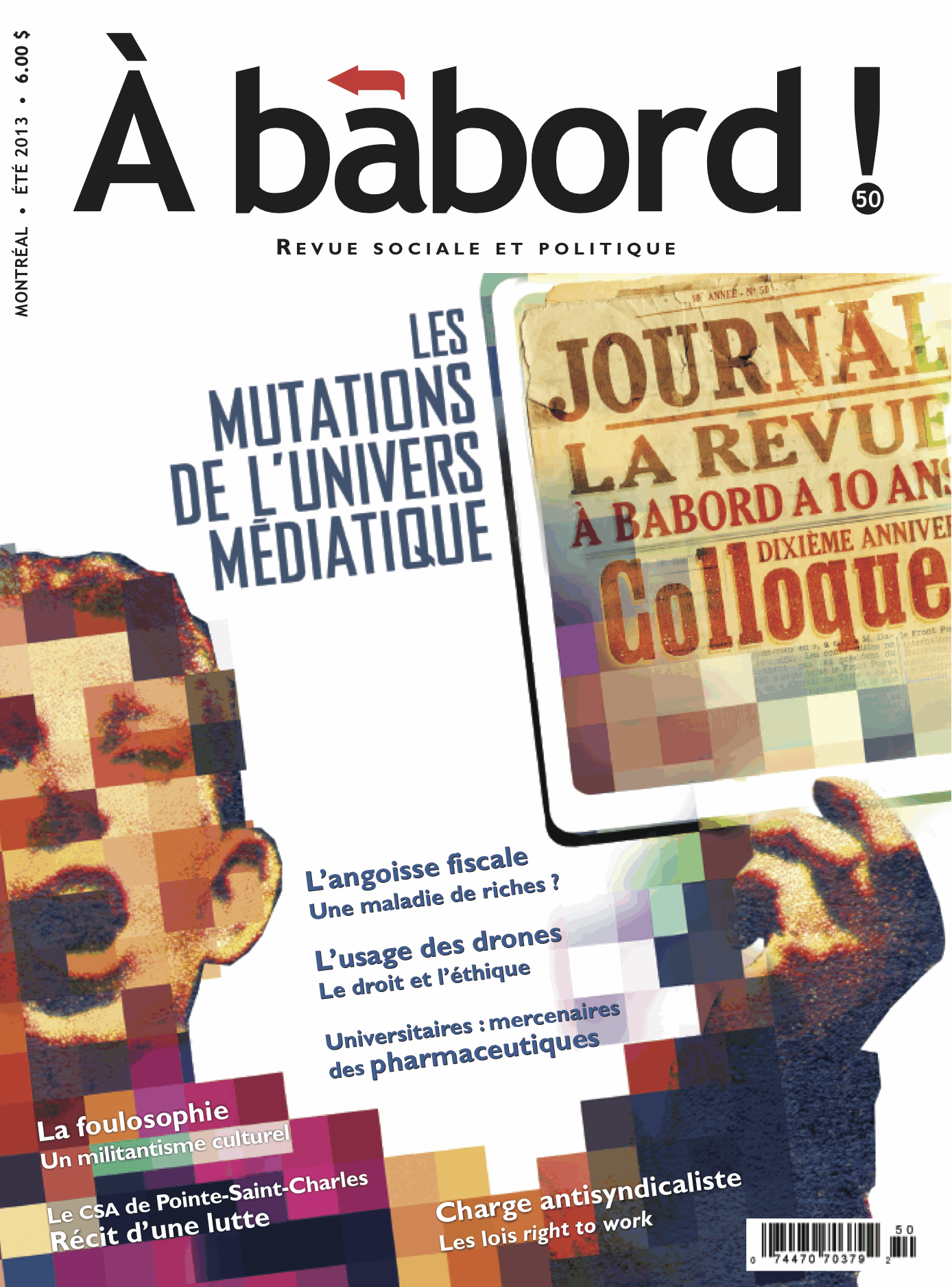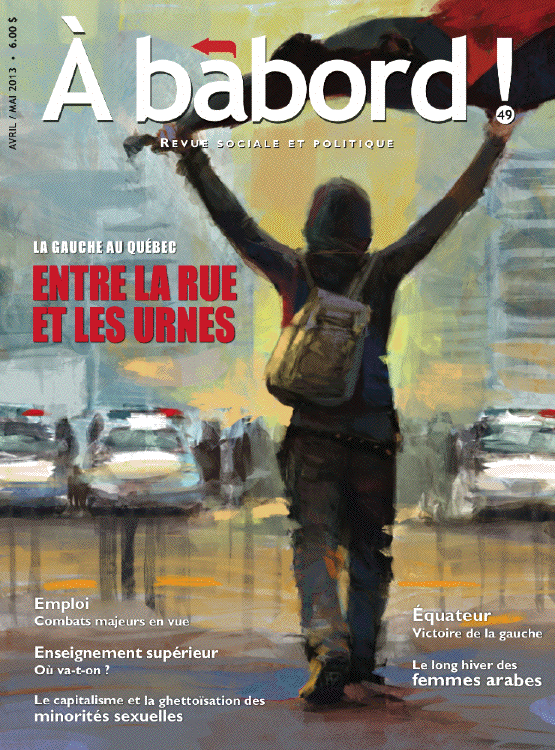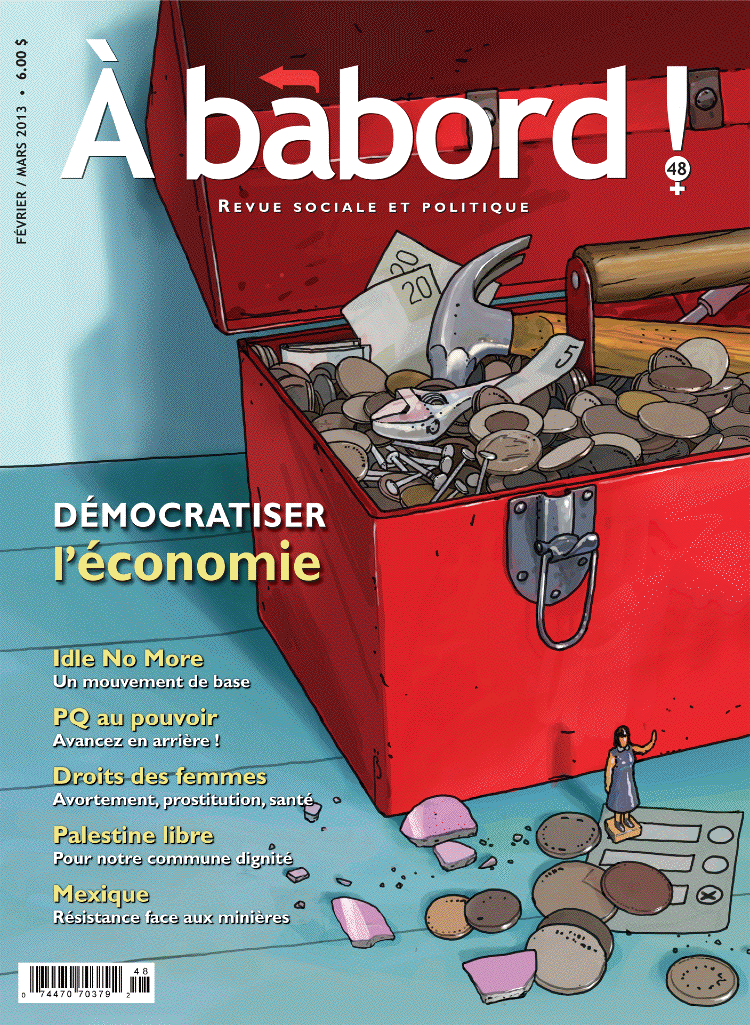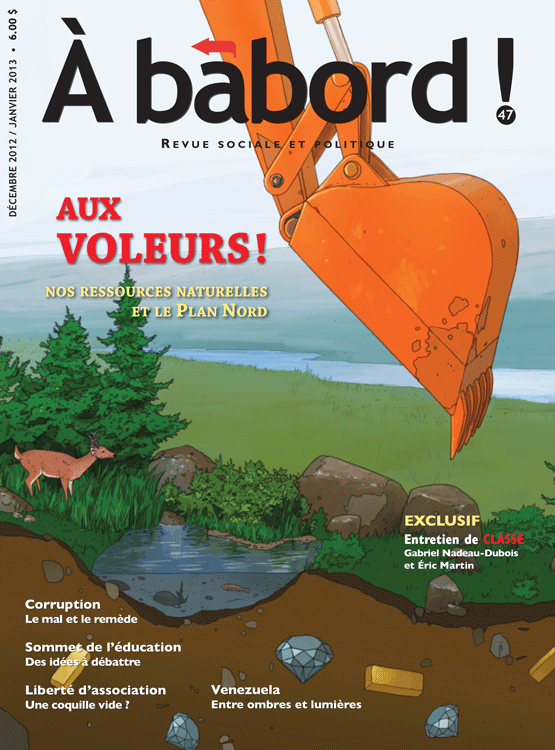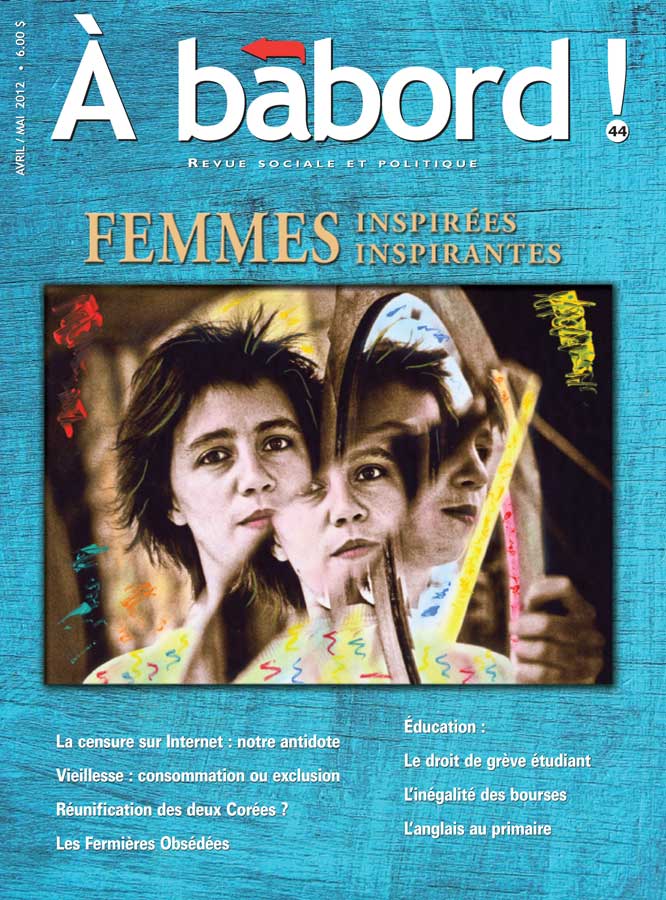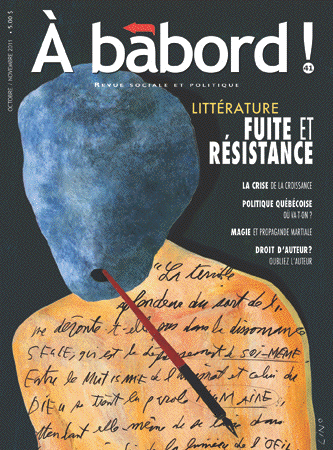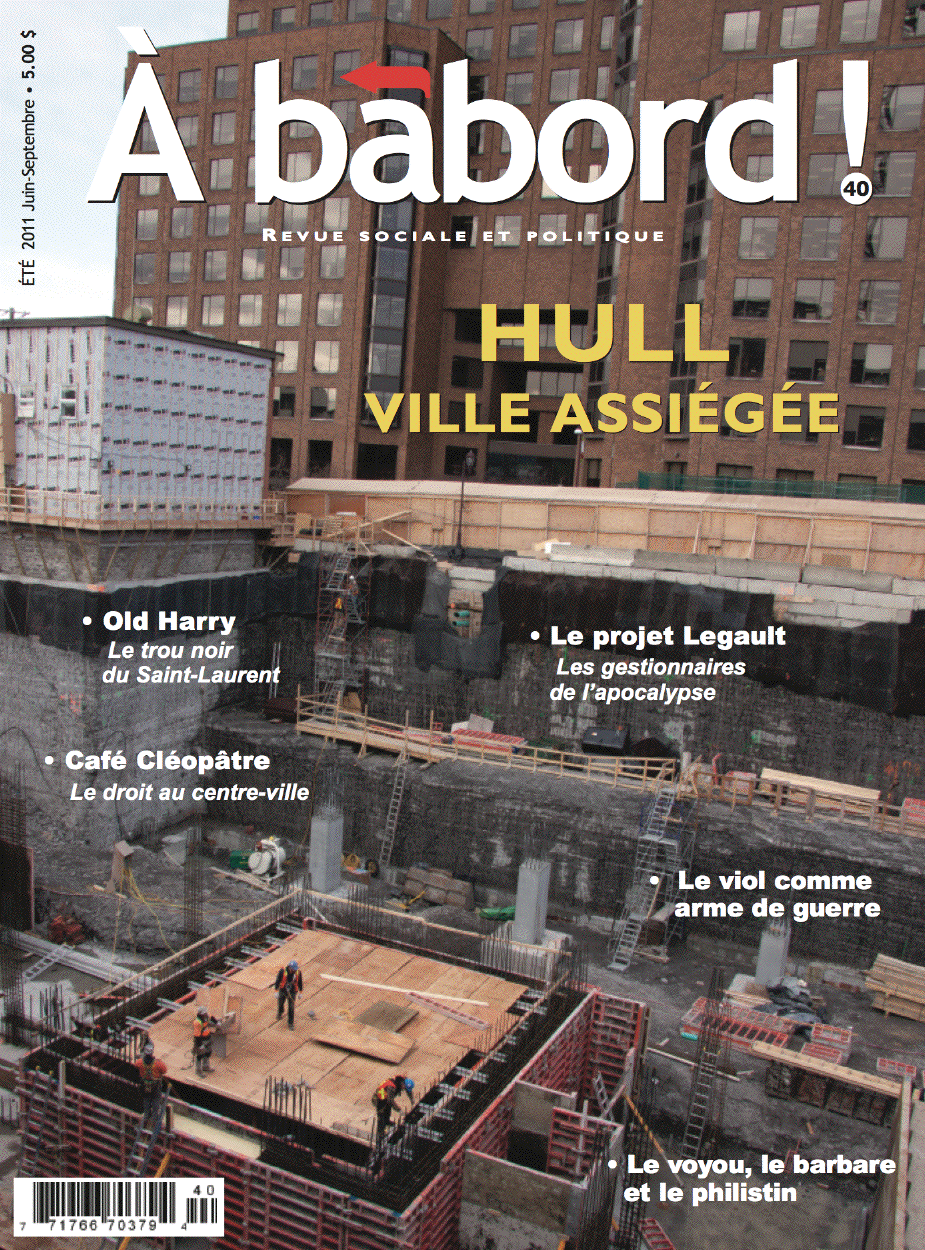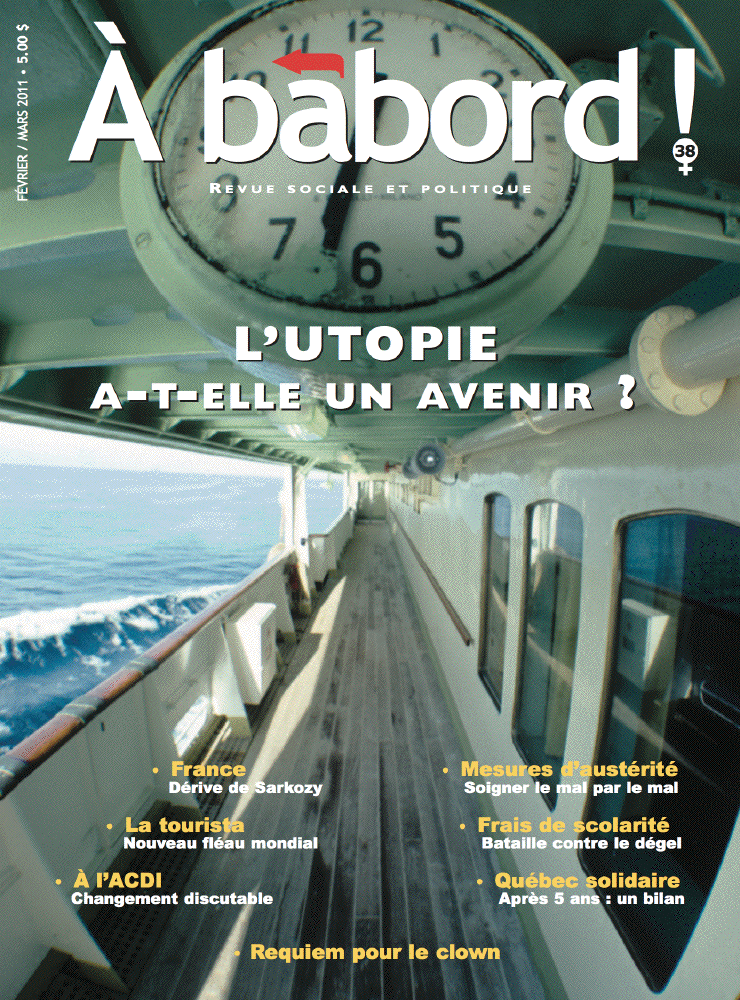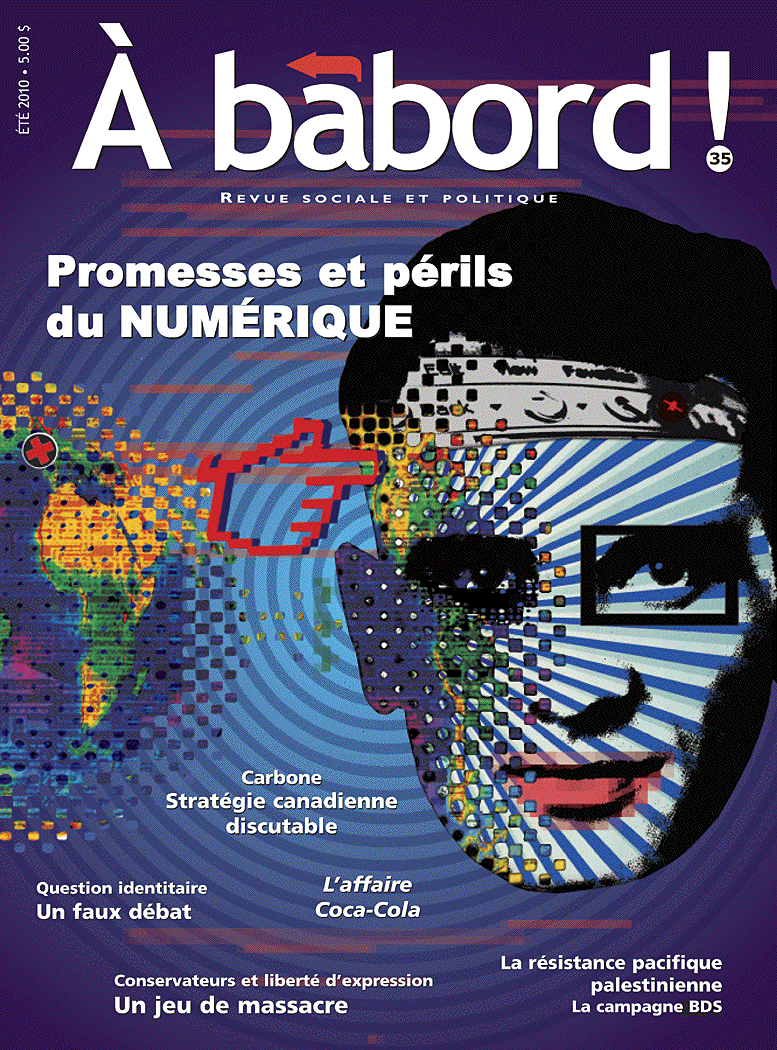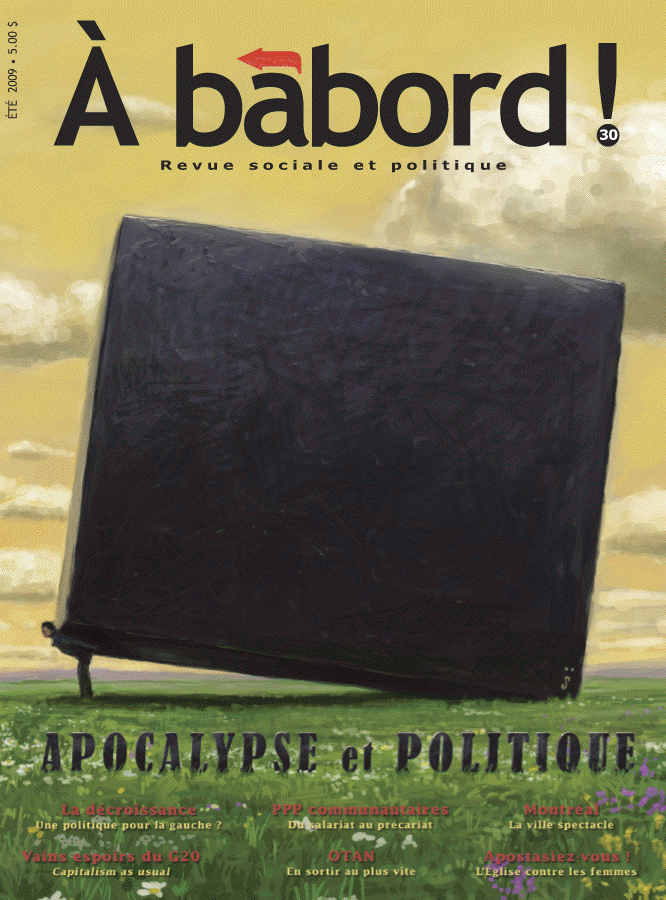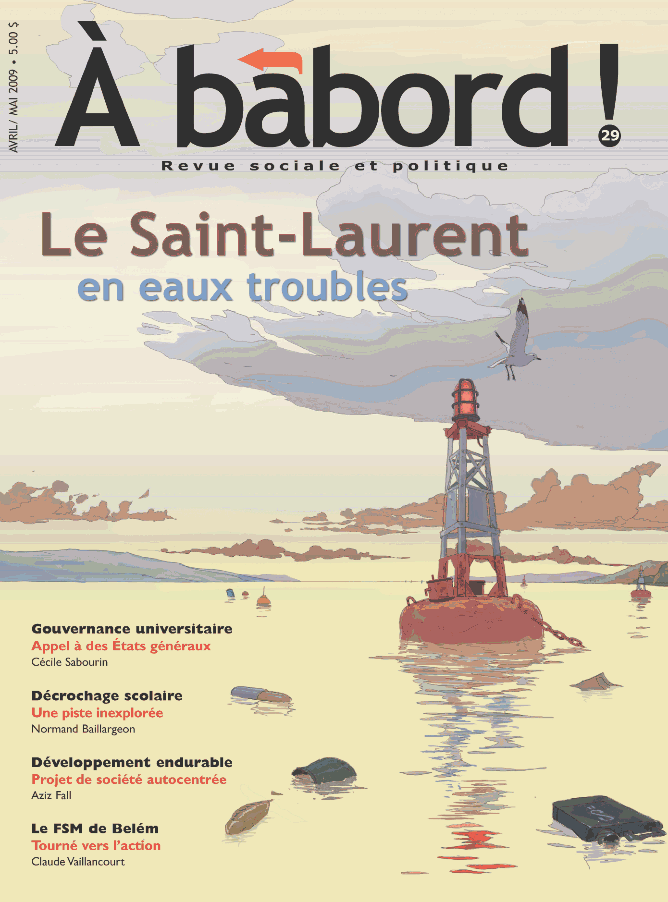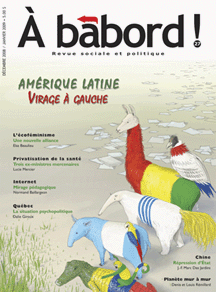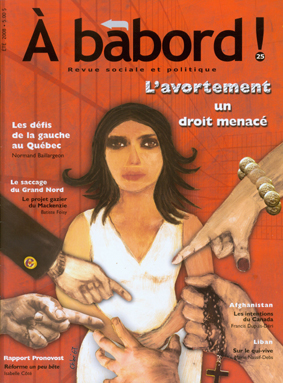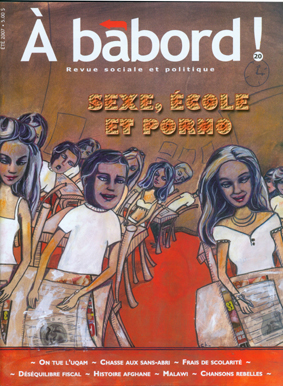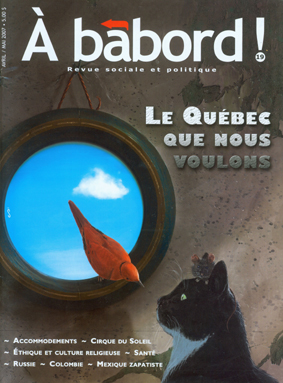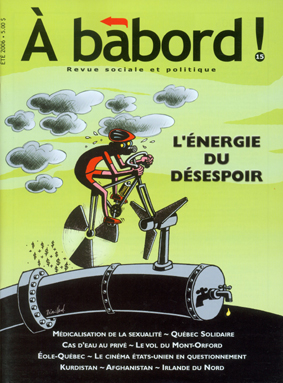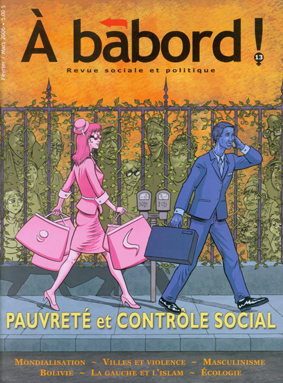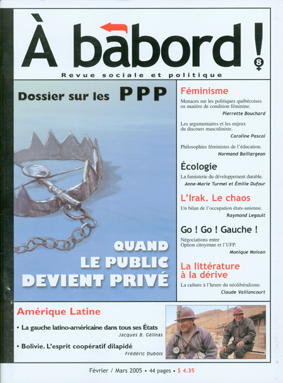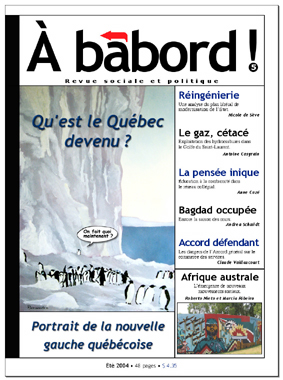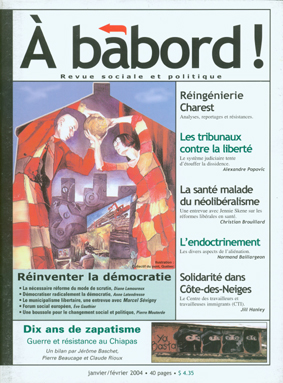Mémoire des luttes
Aux origines du FLQ : pour l’indépendance et le socialisme
Au début des années 1960, le Québec est en ébullition. La Révolution tranquille est en marche, mais pour plusieurs, elle est insuffisante. Dans ce contexte, de jeunes radicaux fondent en 1963 le Front de libération du Québec (FLQ), « pour l’indépendance et le socialisme ». Ce moment fondateur, moins connu que les coups d’éclat de la fin de la décennie, permet de comprendre les motivations de l’indépendantisme révolutionnaire au Québec et sa pérennité. Soixante ans plus tard, que reste-t-il du premier FLQ ?
En septembre 1960, le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) est créé. Il fait la promotion de la souveraineté du Québec, tout en adoptant un discours résolument à gauche, incarné par son charismatique leader Pierre Bourgault [1]. En marge du RIN, de petits groupes radicaux se forment, dont le Comité de libération nationale (CLN) et le Réseau de résistance (RR), qui envisagent une action clandestine en appui à l’action légale afin de parvenir à la souveraineté dans une perspective socialiste. De novembre 1962 à février 1963, le RR mène quelques attaques contre des symboles de la domination culturelle et économique anglo-saxonne, avant que trois de ses membres participent à la fondation d’une nouvelle organisation : le Front de libération du Québec (FLQ), dont le nom s’inspire directement du Front de libération nationale (FLN) algérien.
Un Québec à révolutionner
Le nouveau groupe considère que les Canadiens français sont colonisés « politiquement, socialement, économiquement », puisque le Québec est inféodé aux intérêts anglo-saxons (britanniques, américains et canadiens). La domination régalienne de Londres et d’Ottawa est bien réelle, ainsi que la dévalorisation du français dans de nombreux milieux de travail. Les conditions sociales des classes populaires francophones sont misérables, comme le démontrent les commissions Parent (1961-1966) ou Castonguay-Nepveu (1966-1971). En 1960, 36 % des anglophones au Québec effectuent une 11e année de scolarité, contre 13 % des francophones. Dans le même sens, 13 % des anglophones de 20 à 24 ans fréquentent l’université, contre 3 % des francophones du même âge. Enfin, l’économie est dominée par la bourgeoisie anglophone qui possède massivement les capitaux et les industries : elle détient 80 % des actifs à Montréal, alors que les francophones, avec les travailleurs migrants, sont largement confinés à des emplois peu ou pas qualifiés, généralement mal payés et souvent dangereux. Le FLQ se veut une réponse à ces injustices.
Bien que les Québécois·es ne vivent pas, au sens strict, sous un régime colonial comme celui de l’Indochine ou de l’Algérie, leur identification aux peuples qui ont lutté pour leur indépendance est compréhensible. La comparaison sera aussi faite avec les Afro-Américains, malgré les limites d’une telle analogie. Dans tous les cas, la perception de soi comme peuple dominé et l’identification avec d’autres peuples soumis à des régimes coloniaux expliquent les choix théoriques du premier FLQ (nommément, l’indépendance et le socialisme) ainsi que ses choix stratégiques (la lutte armée en appui à une lutte populaire massive). En effet, lutter contre l’impérialisme implique un horizon social progressiste, ainsi qu’une volonté d’agir « par tous les moyens » face à un ennemi qui refuse le compromis.
Sur ces bases, le premier FLQ vise, par son action directe, plusieurs objectifs. D’abord, il désire attirer l’attention sur la condition des Québécois·es, au niveau national comme international. Ensuite, il cherche à montrer qu’une action combative est possible ici même en Amérique du Nord, au cœur de « l’empire américain ». Il souhaite aussi galvaniser les groupes indépendantistes et accompagner le développement d’un mouvement souverainiste large. En somme, sa stratégie repose sur la propagande et l’agitation, communes aux groupes clandestins du même genre qui émergent partout en Occident à l’époque.
De la parole aux actes
À la fin du mois de février 1963, une demi-douzaine de personnes, notamment issues du Réseau de résistance, fonde officiellement le FLQ. Gabriel Hudon, Pierre Schneider, Georges Schoeters et Raymond Villeneuve sont au cœur de l’organisation. Ils passent une première fois à l’action dans la nuit du 7 au 8 mars 1963, ciblant trois casernes militaires de la région de Montréal avec des bombes incendiaires. Début avril, trois nouvelles bombes explosent, visant différents établissements fédéraux. La pression policière commence à se faire sentir, alors que plusieurs indépendantistes radicaux sont arrêtés et interrogés en lien avec ces attaques. Le 21 avril, un malheureux attentat du FLQ dans un centre de recrutement militaire de Montréal coûte la vie au veilleur de nuit de l’établissement. Le 3 mai, une bombe (non amorcée) est déposée au siège social de la Solbec Copper, en solidarité avec les travailleurs en grève de cette entreprise. Au printemps, différentes attaques sont menées, à nouveau contre des établissements de l’armée, mais aussi de sociétés canadiennes, dont Golden Eagle (Ultramar), et des boîtes aux lettres de la ville bourgeoise de Westmount.
Enfin, début juin 1963, une vingtaine de membres de ce premier réseau du FLQ sont arrêtés. Malgré la sympathie populaire et l’appui qu’ils reçoivent du « Comité Chénier » (un groupe de défense des prisonniers politiques du FLQ), onze felquistes sont condamnés en octobre. Hudon et Villeneuve écopent de 12 ans de prison, et Schoeters de 10 ans. C’est la fin du premier réseau du FLQ, qui sera suivi par (au moins) cinq autres réseaux successifs jusqu’en 1972. De sa première mouture, on peut retenir plusieurs éléments, notamment sa théorie du Québec comme « nation dominée », le lien organique qu’il établit entre indépendance et socialisme, et la nécessité, dans le contexte des années 1960, de dynamiser le mouvement social par une action de propagande armée. En sus de son intérêt historique, cet épisode peut-il encore nous apprendre quelque chose aujourd’hui ?
Lutter pour changer le système
Un premier élément pertinent est certainement la conception qu’une lutte de libération doit nécessairement s’accompagner d’une lutte globale contre le système oppresseur. En effet, il semble illusoire de penser qu’on puisse lutter uniquement dans un horizon sectoriel. À l’époque comme de nos jours, les luttes doivent, sinon converger, du moins s’inscrire dans une stratégie de lutte anti-capitaliste. Le premier Message du FLQ à la nation (16 avril 1963) affirmait déjà : « L’indépendance seule ne résoudrait rien, elle doit à tout prix être complétée par la révolution sociale. » Aujourd’hui, alors que l’impérialisme sévit plus que jamais, que la grande industrie est responsable de la crise écocidaire et que les nationalismes réactionnaires gagnent du terrain, il semble inspirant de penser nos luttes d’émancipation collective dans un horizon de dépassement du capitalisme et d’instauration d’une nouvelle société juste et égalitaire. Un deuxième élément pertinent est le rôle que peuvent jouer des groupes pratiquant l’action directe, à la fois pour faire connaître une cause et pour galvaniser un mouvement. S’il est moralement inacceptable de valoriser la violence en soi, la question se pose de son usage dans un contexte bloqué, comme la crise écologique que les capitalistes amplifient chaque jour un peu plus, au risque de nous annihiler tous. C’est ce vers quoi pointent les travaux récents d’Andreas Malm qui tente de lier l’action directe avec un mouvement de masse.
En somme, selon nous, plusieurs raisons justifient de porter attention au premier FLQ [2]. Il nous aide d’abord à comprendre d’où vient l’indépendantisme au Québec et pourquoi il a pris une tendance révolutionnaire. Surtout, il nous rappelle que parfois, face à des situations iniques, dans lesquelles l’oppression se perpétue sans horizon de changement prévisible, l’action directe peut devenir un moyen légitime de galvaniser et d’accompagner un mouvement de masse. Malgré que l’activisme pratiquant la violence à la pièce ait montré ses limites, lutter dans un horizon de dépassement du capitalisme et envisager une diversité tactique nous semble important en cette époque trouble pour l’humanité.
[1] Il déclare le 3 mars 1963 : « L’indépendance en soi, ça ne veut rien dire. Il faut que l’indépendance s’accompagne de la révolution sociale. »
[2] Pour en savoir plus sur le premier réseau du FLQ, on consultera les témoignages de deux de ses membres : La véritable histoire du FLQ (Claude Savoie, 1963) et Ce n’était qu’un début (Gabriel Hudon, 1977).