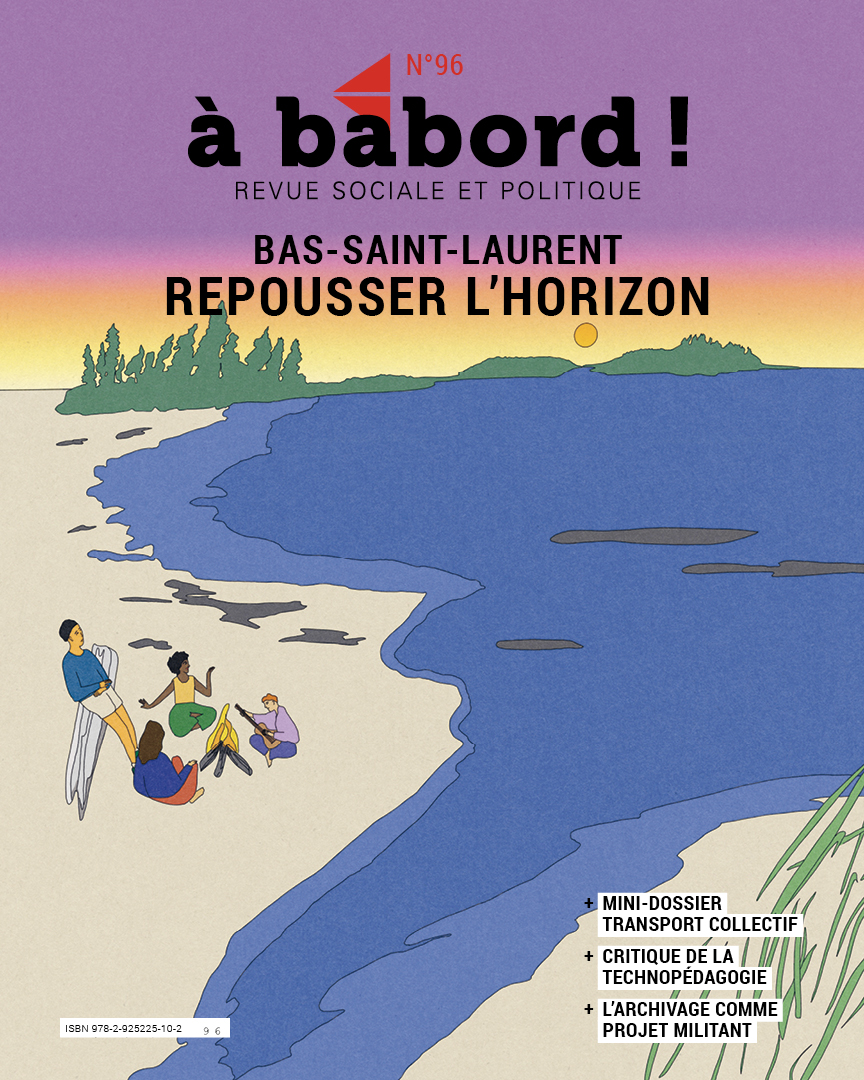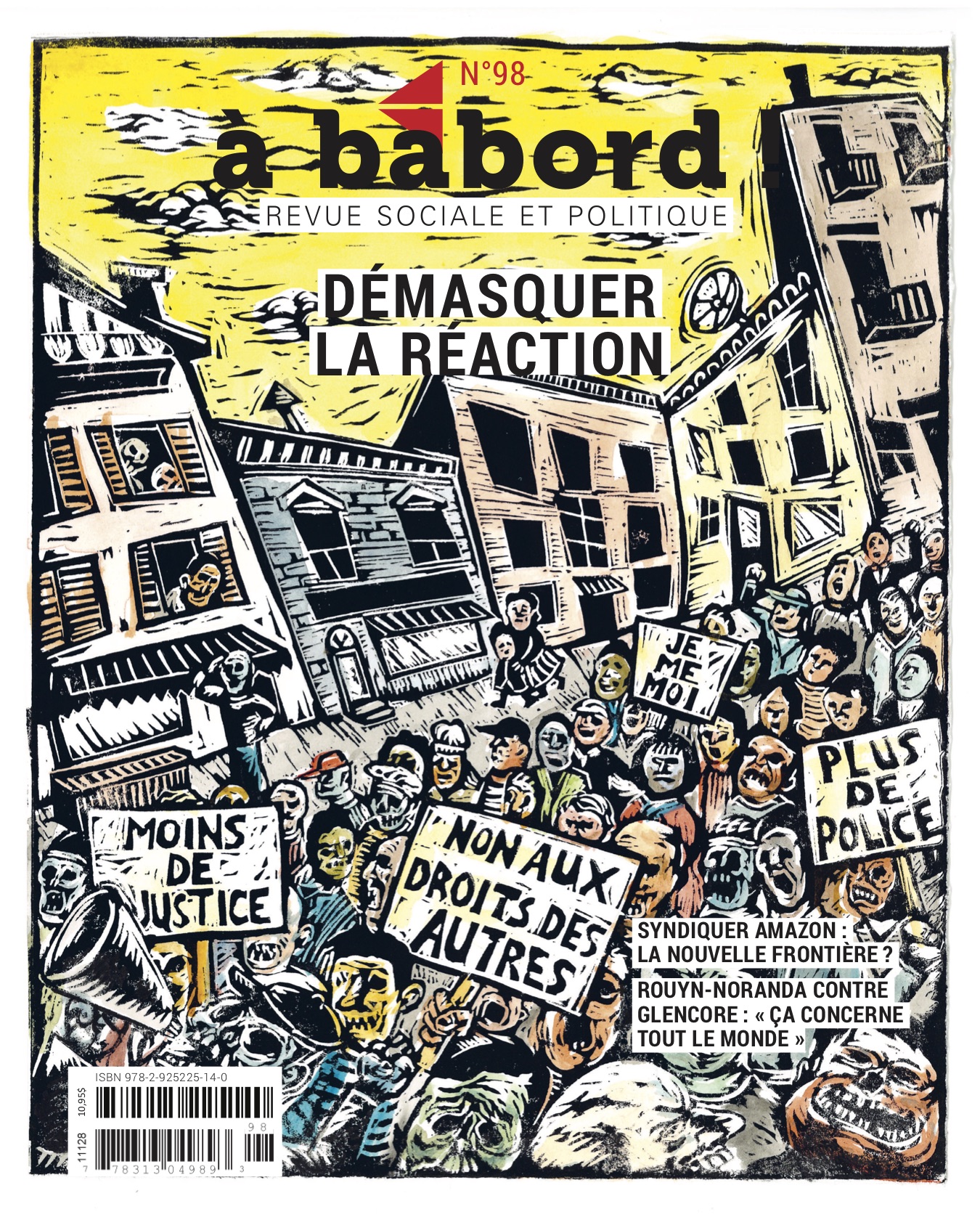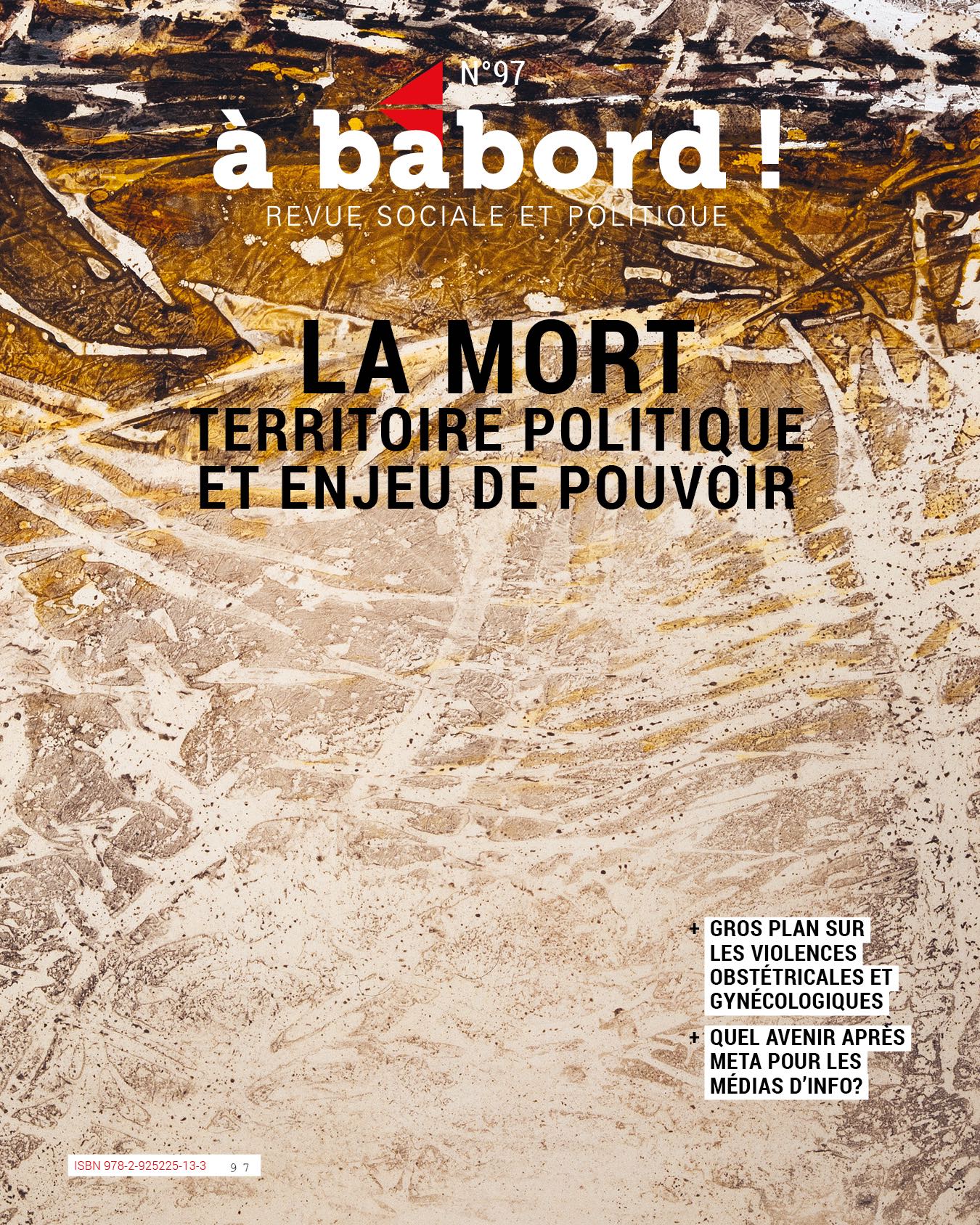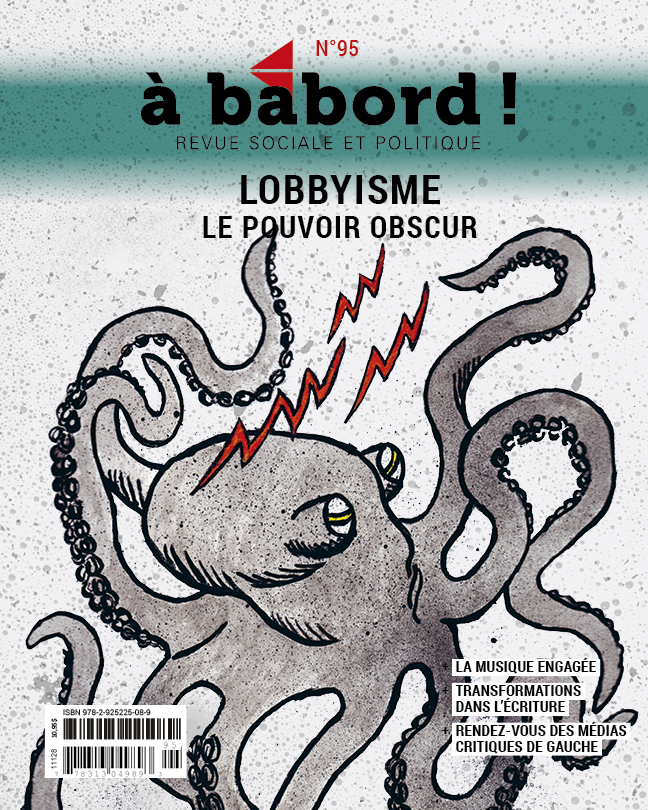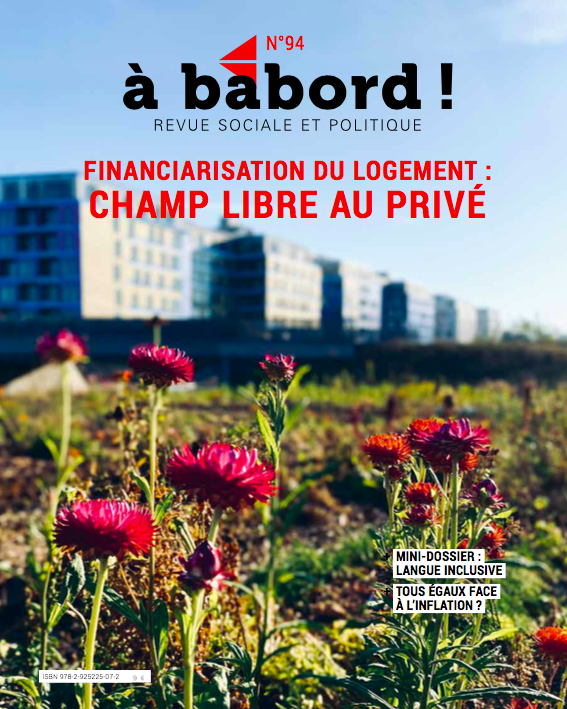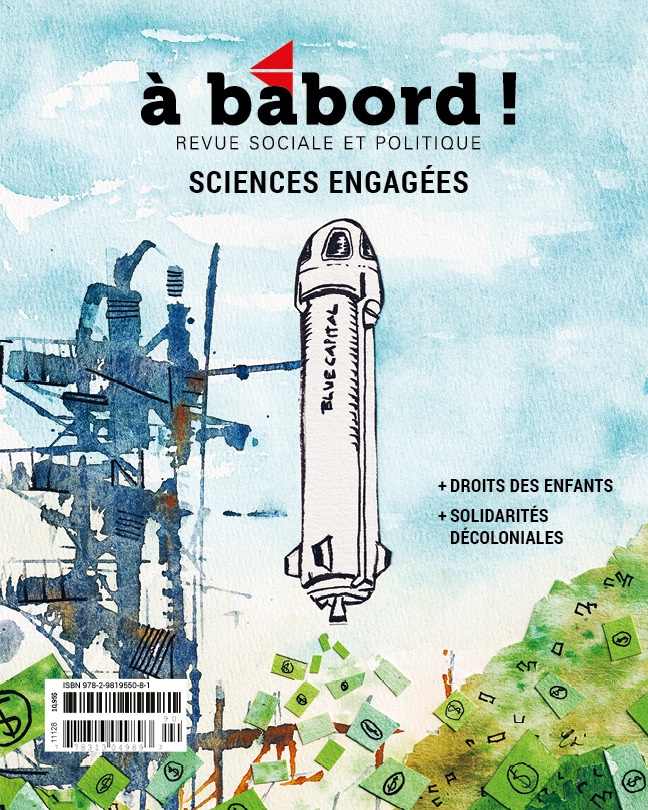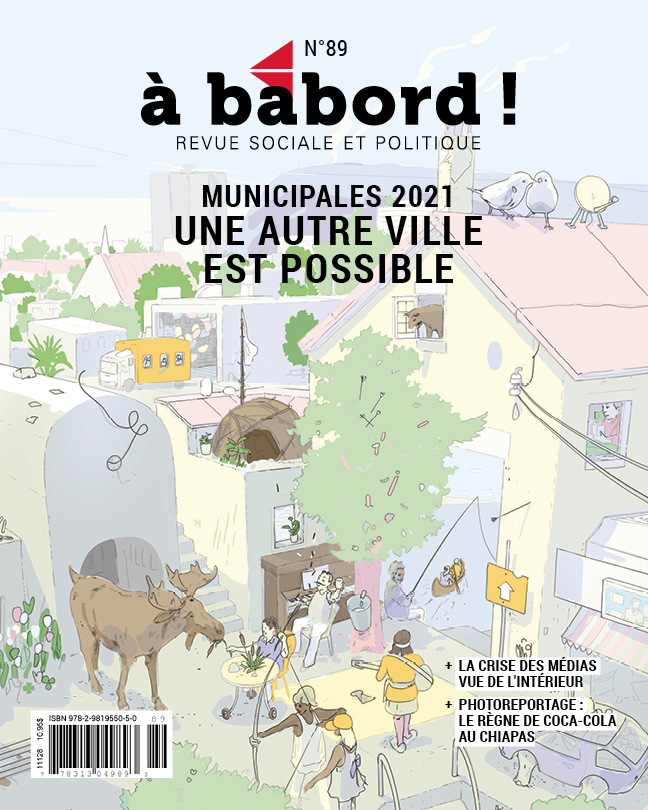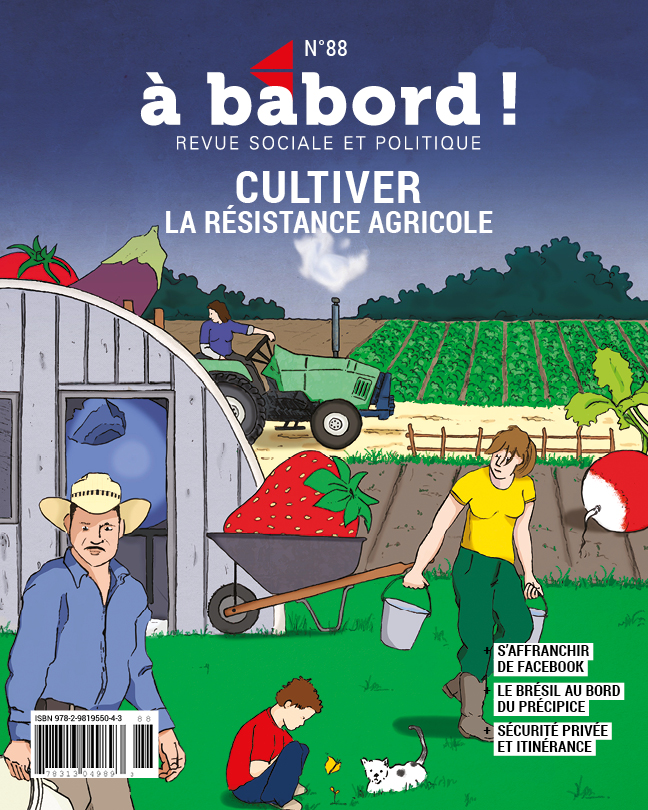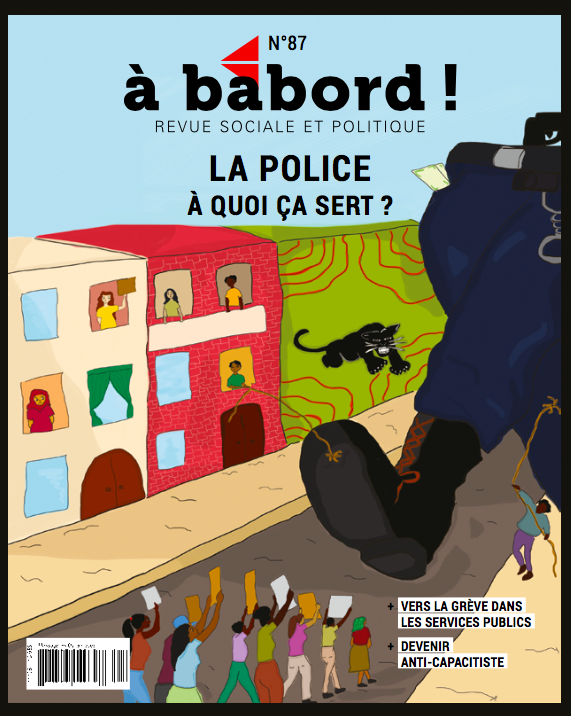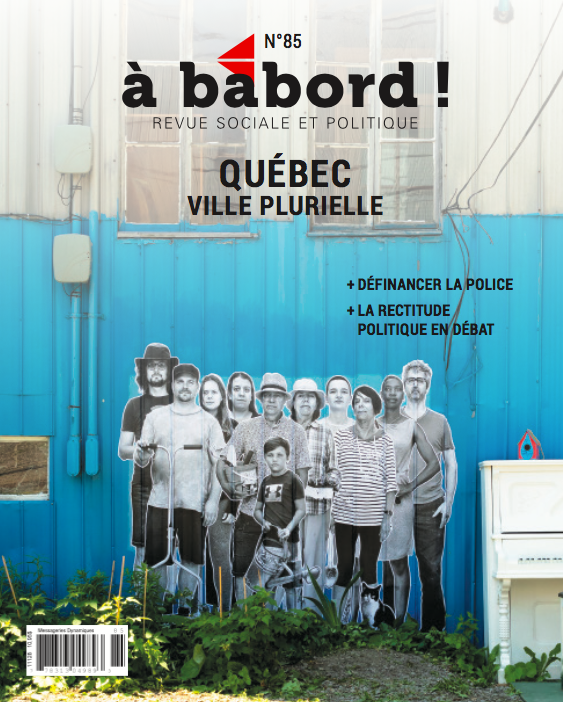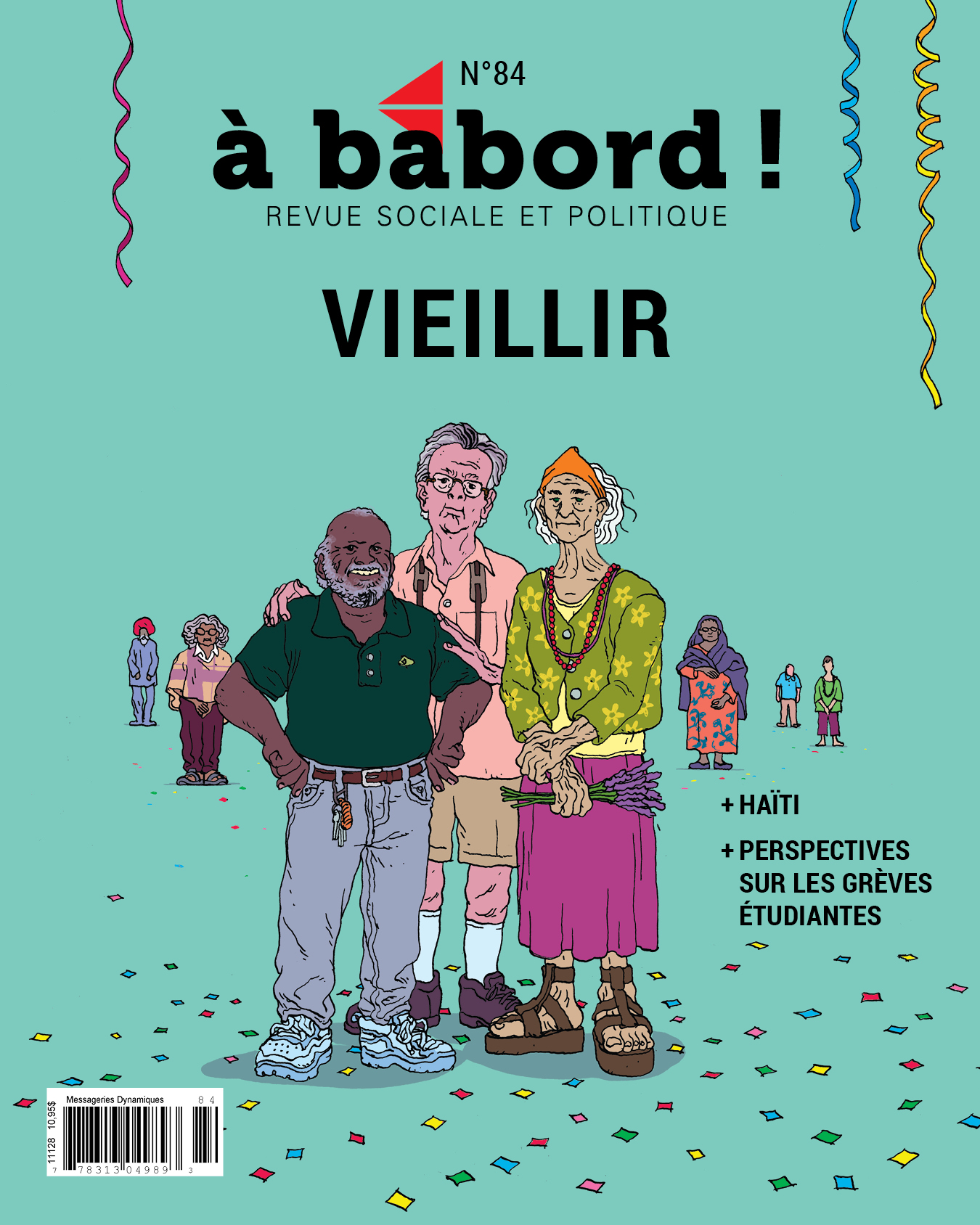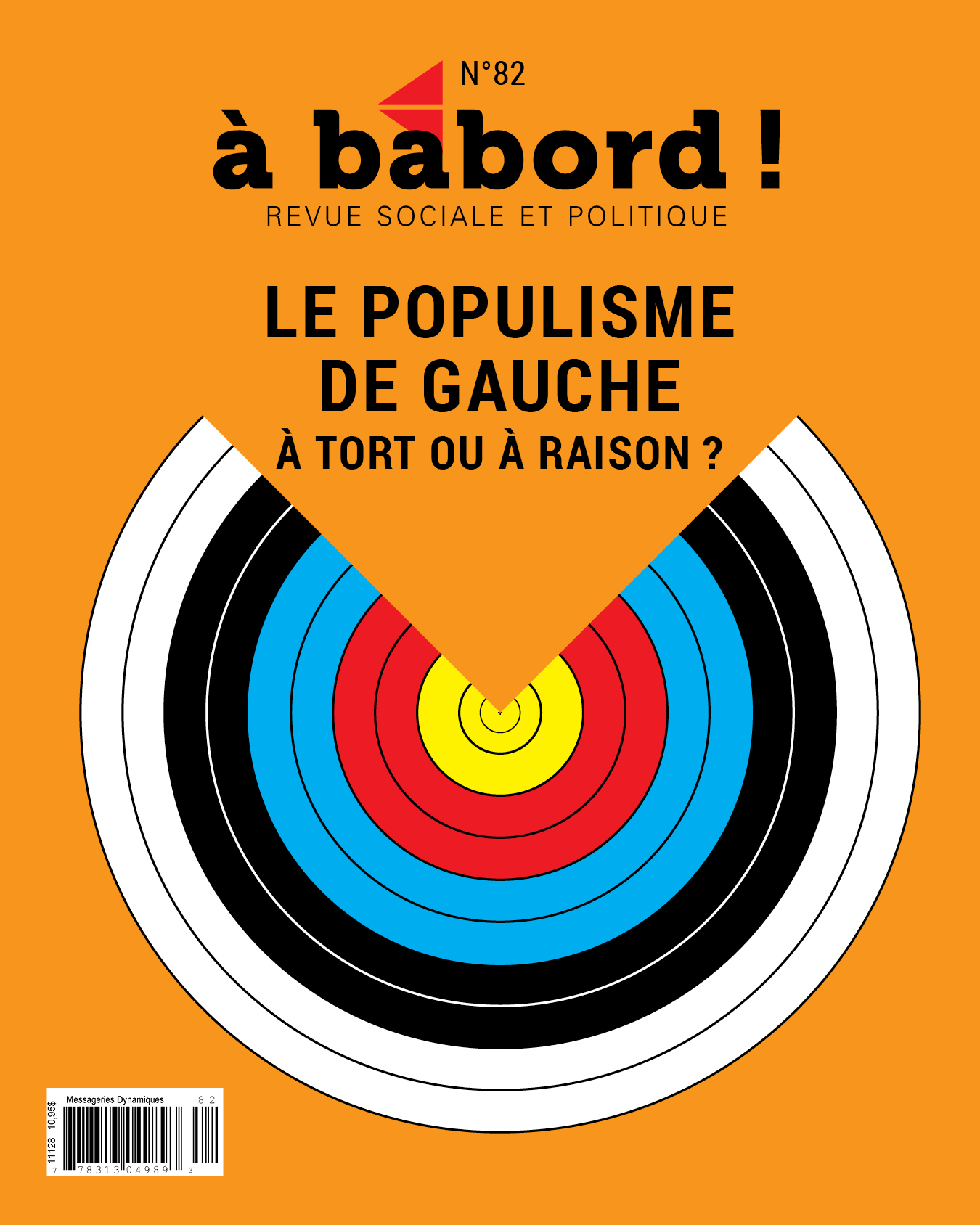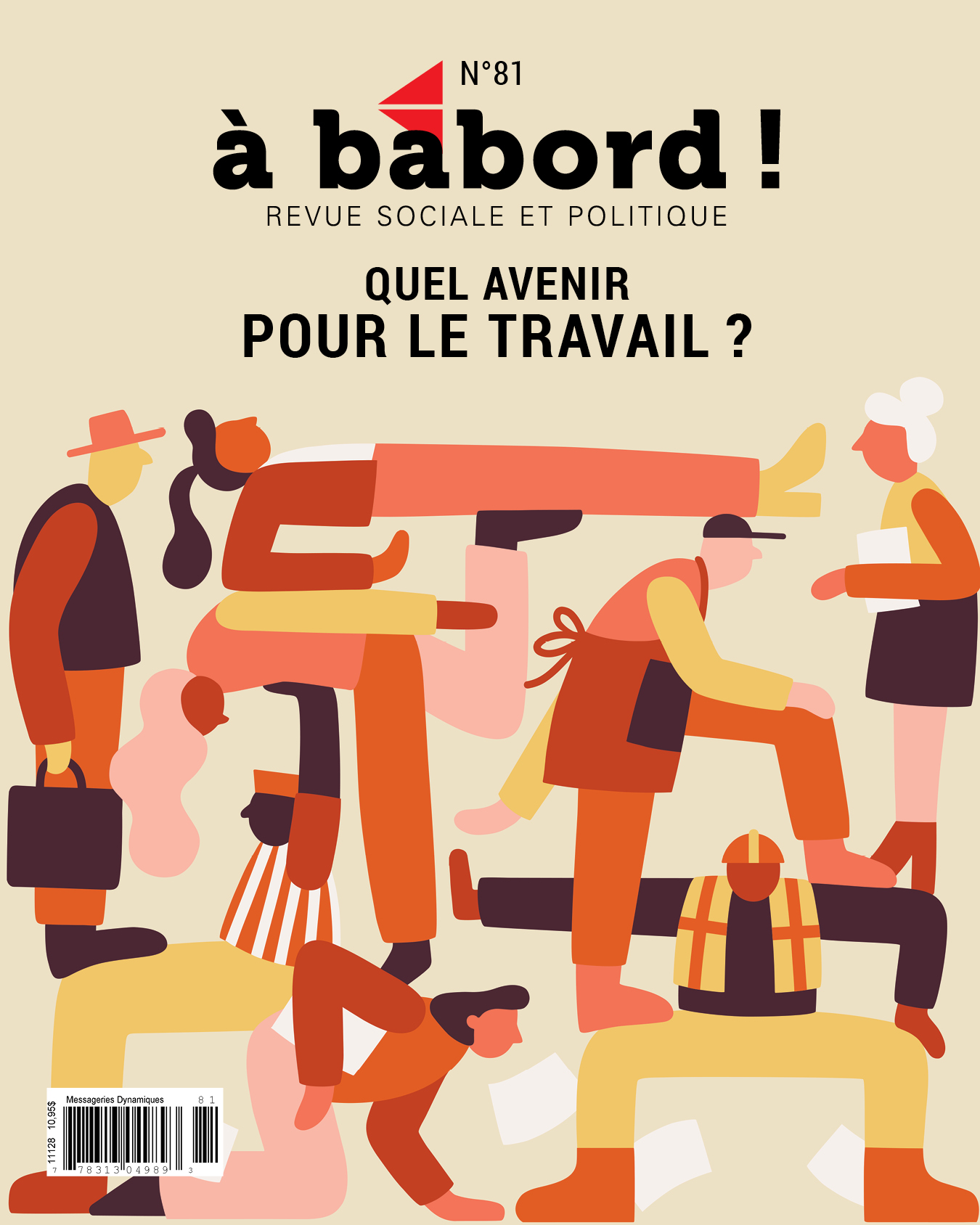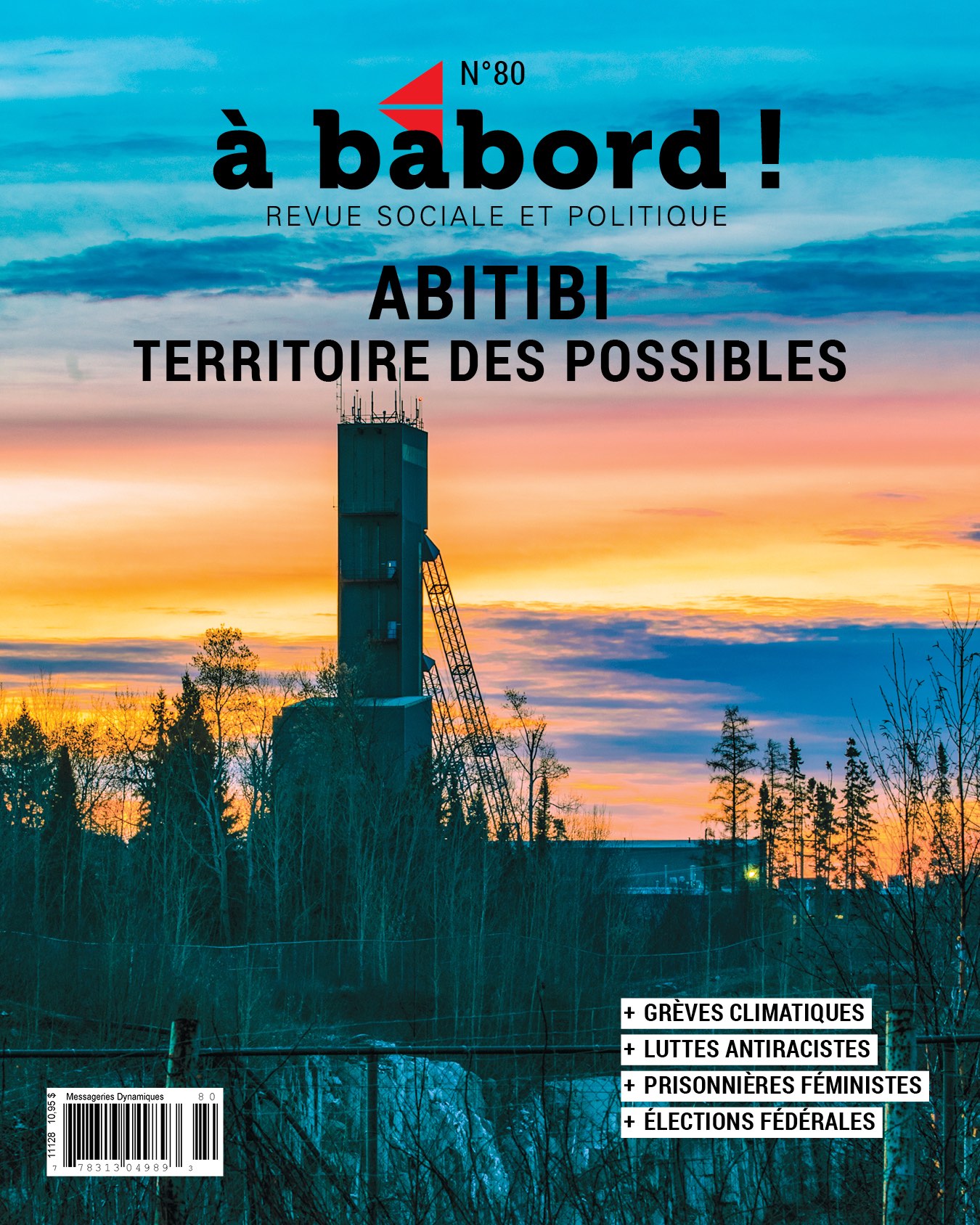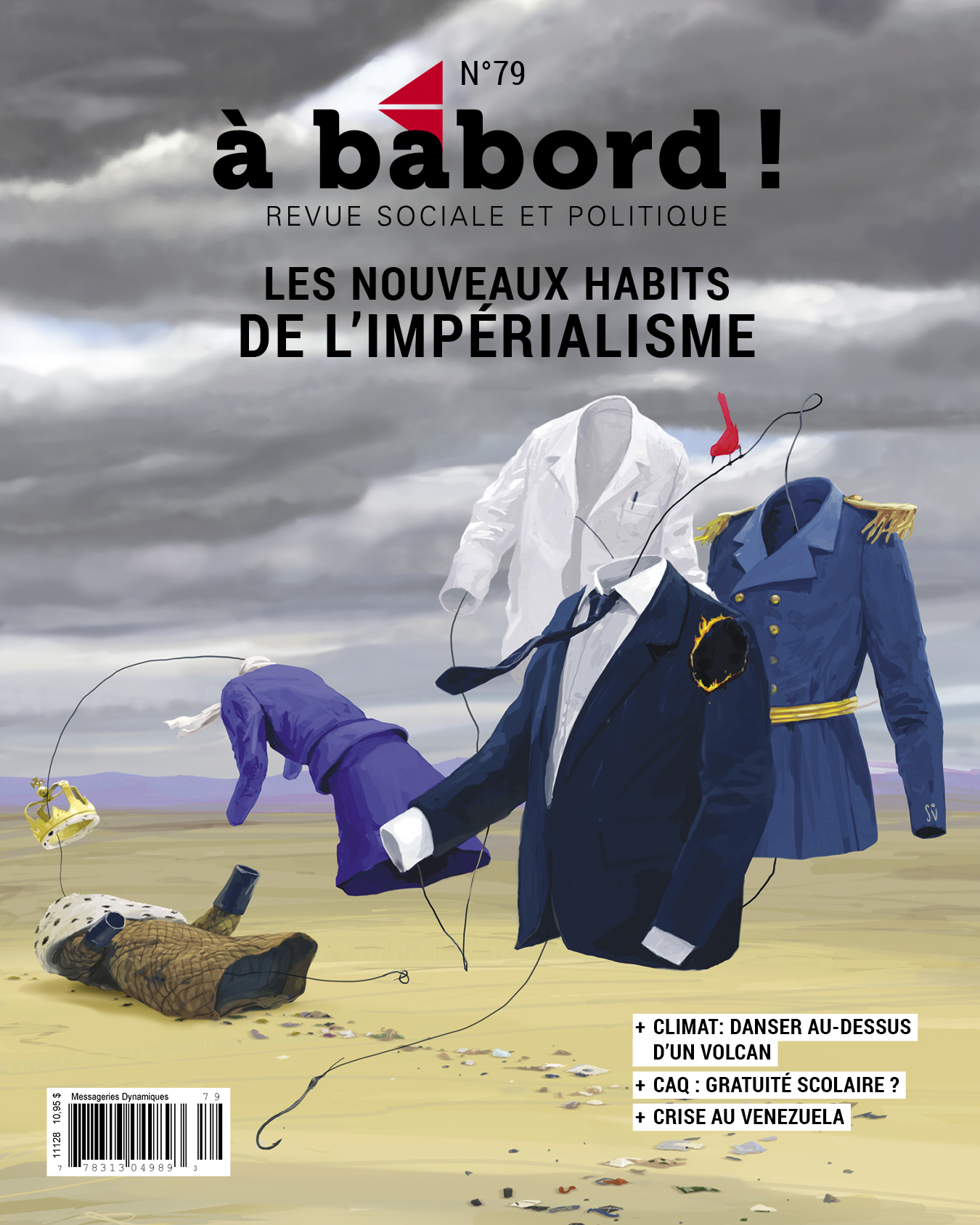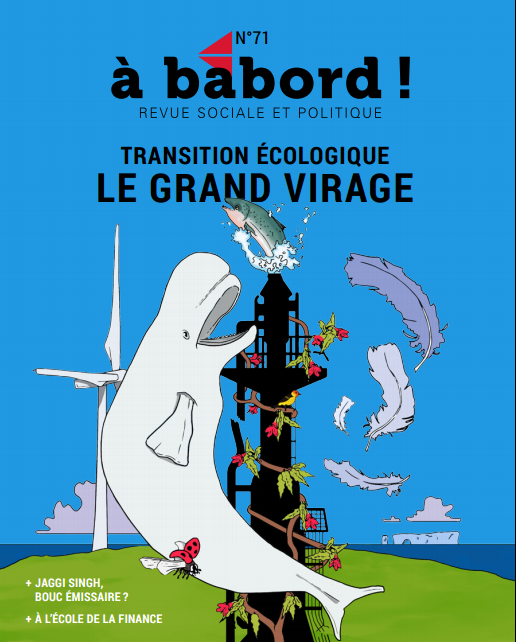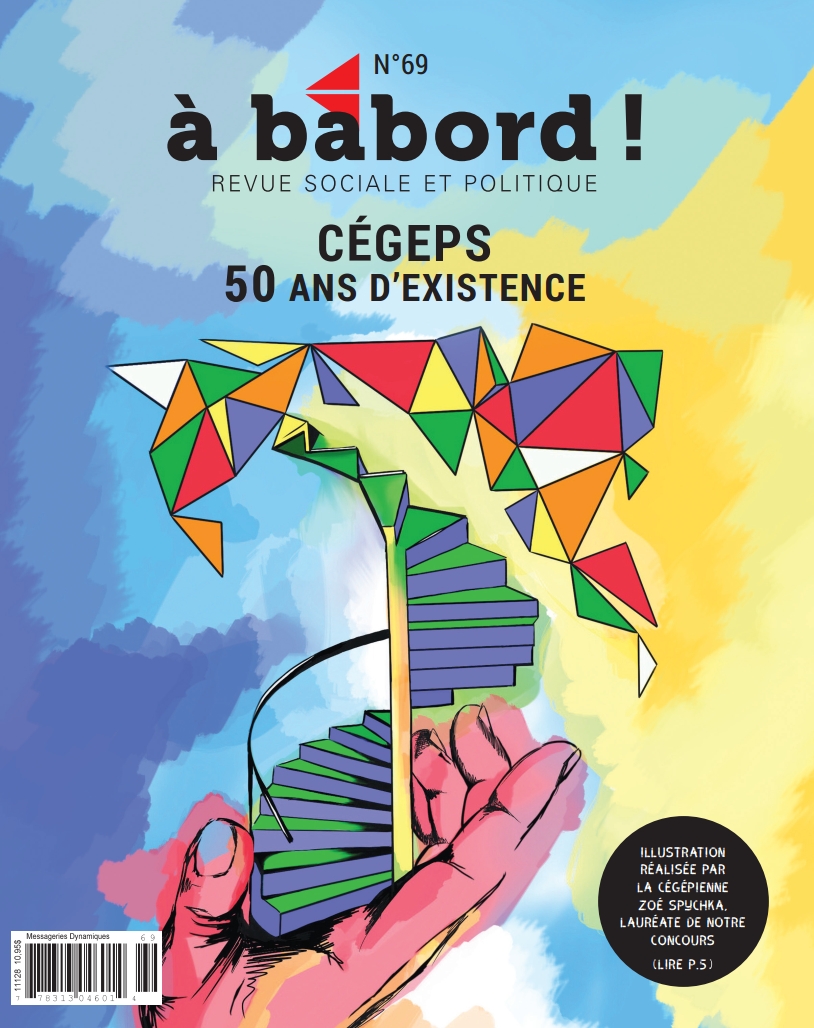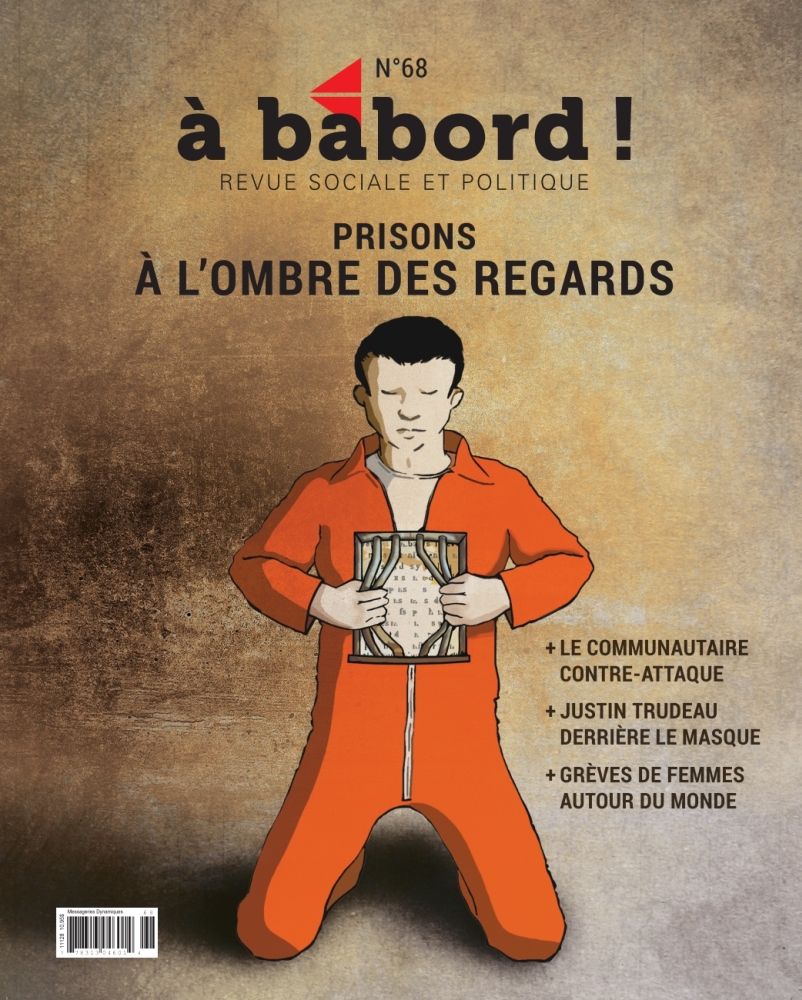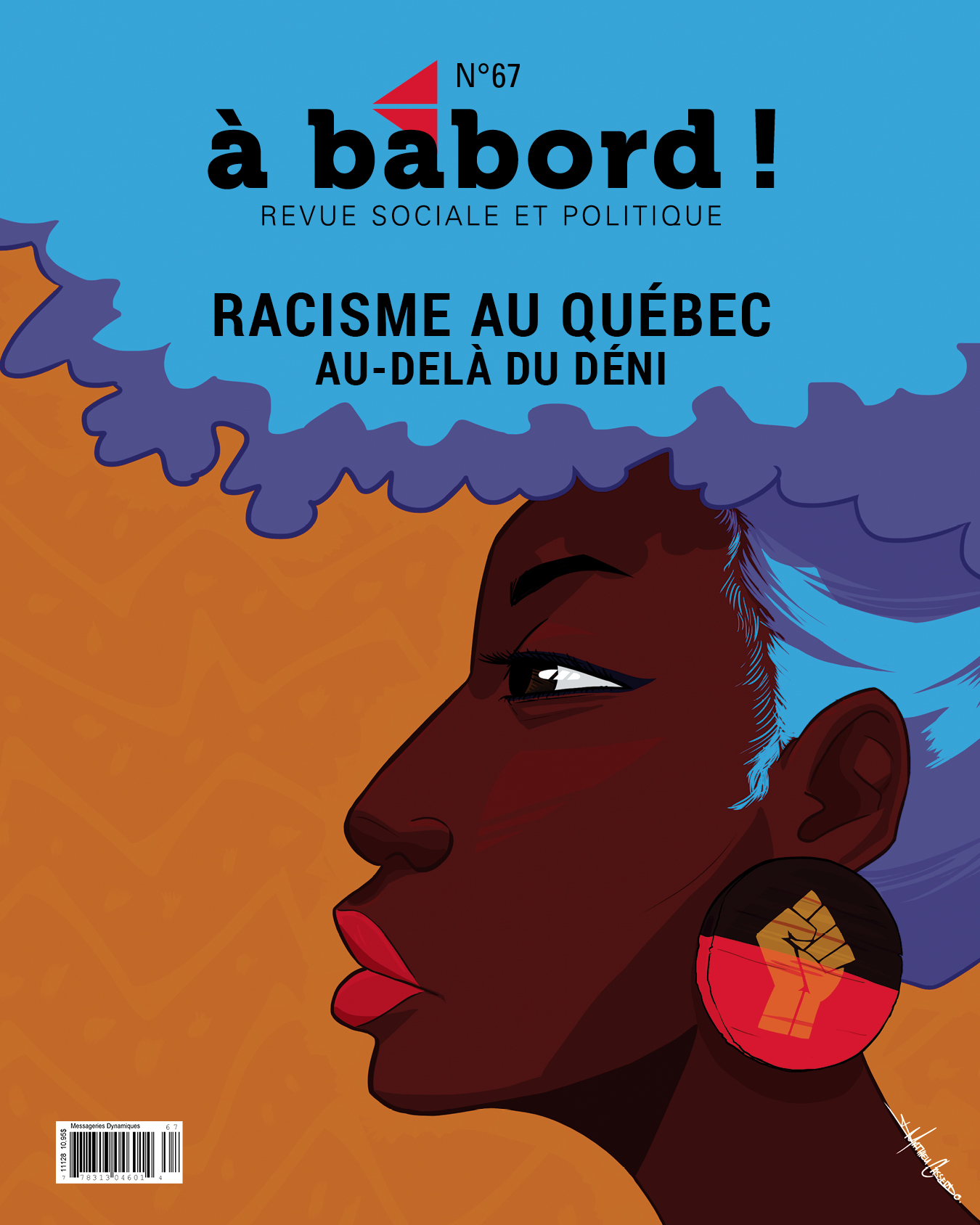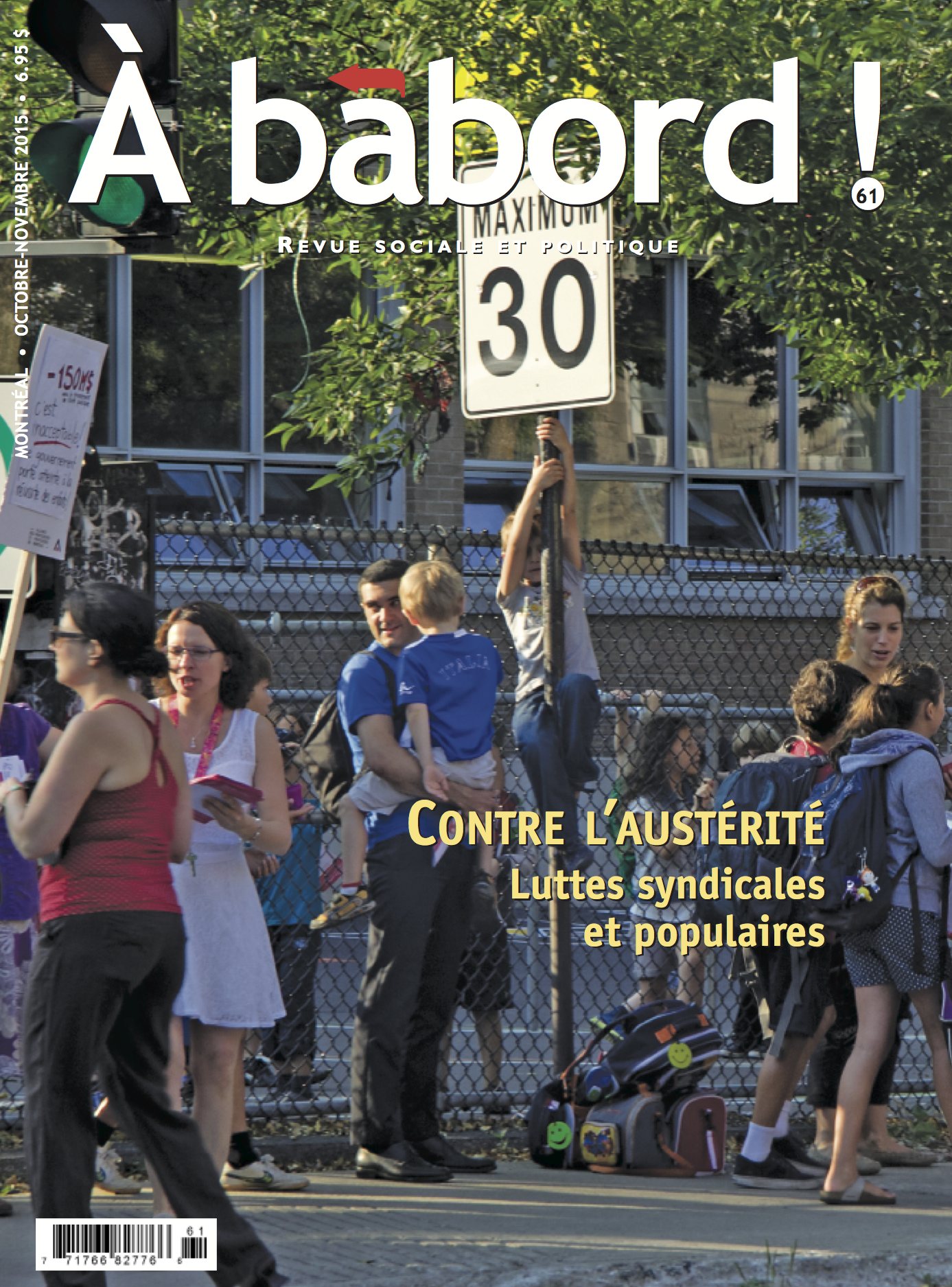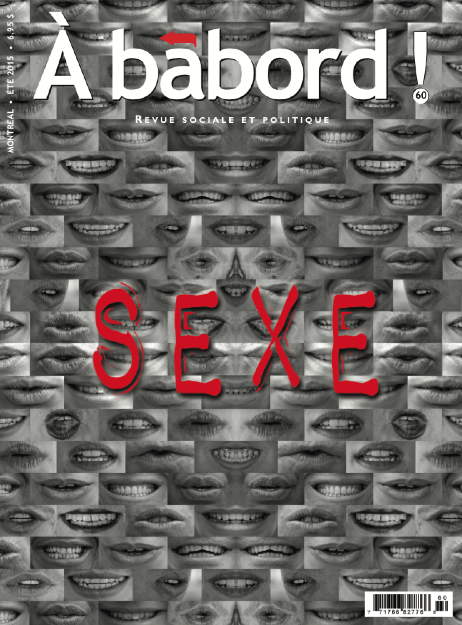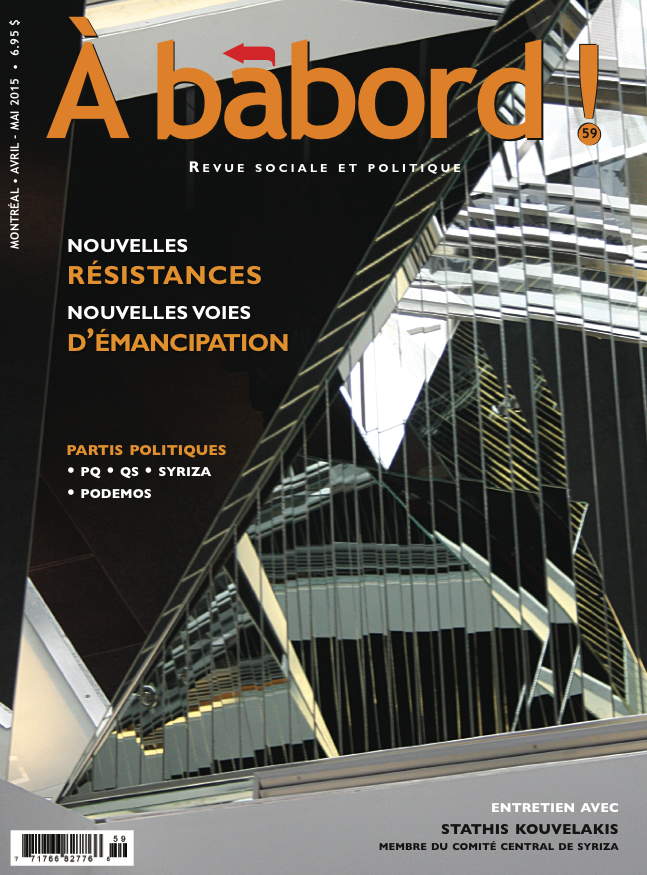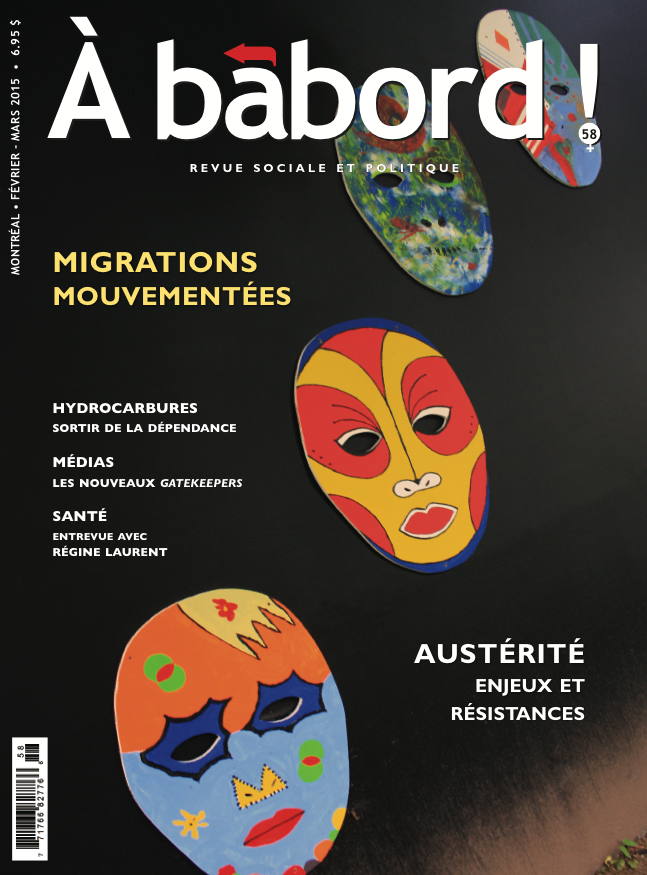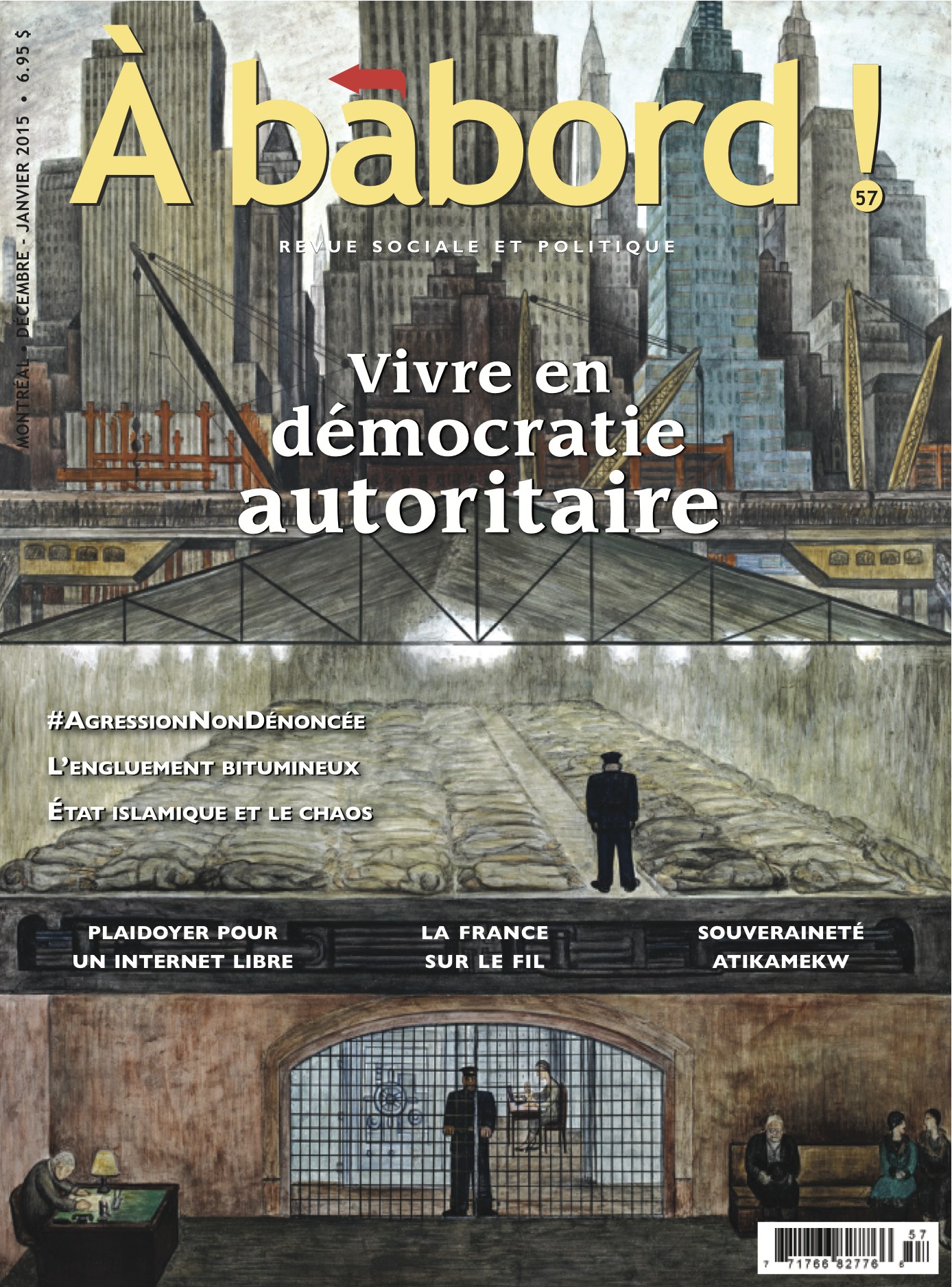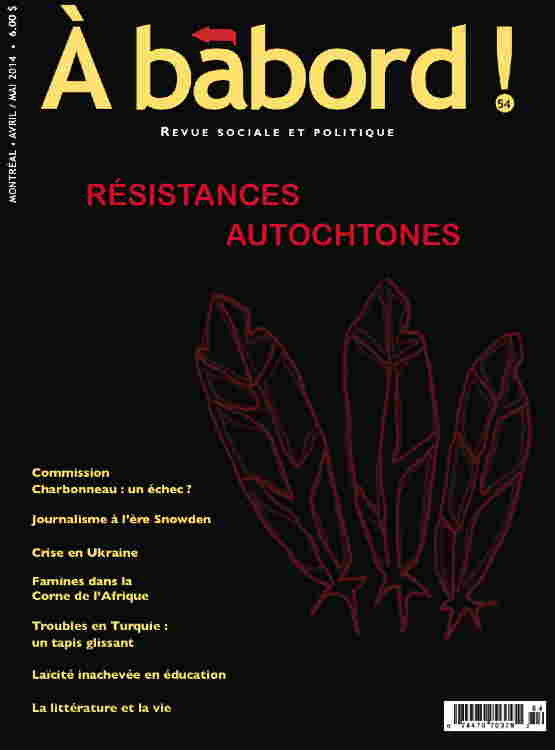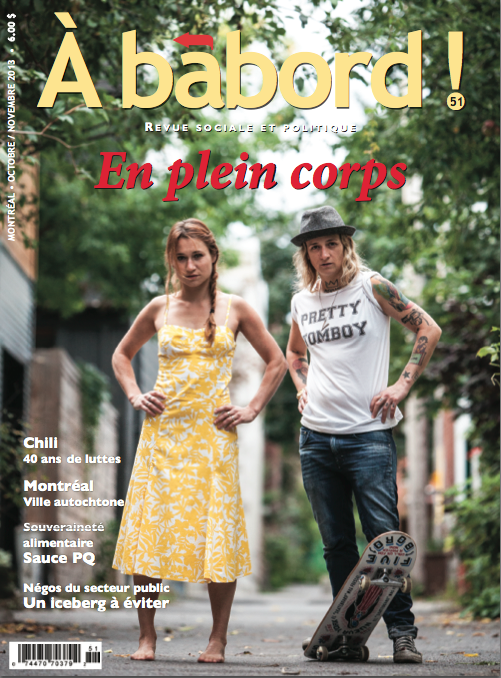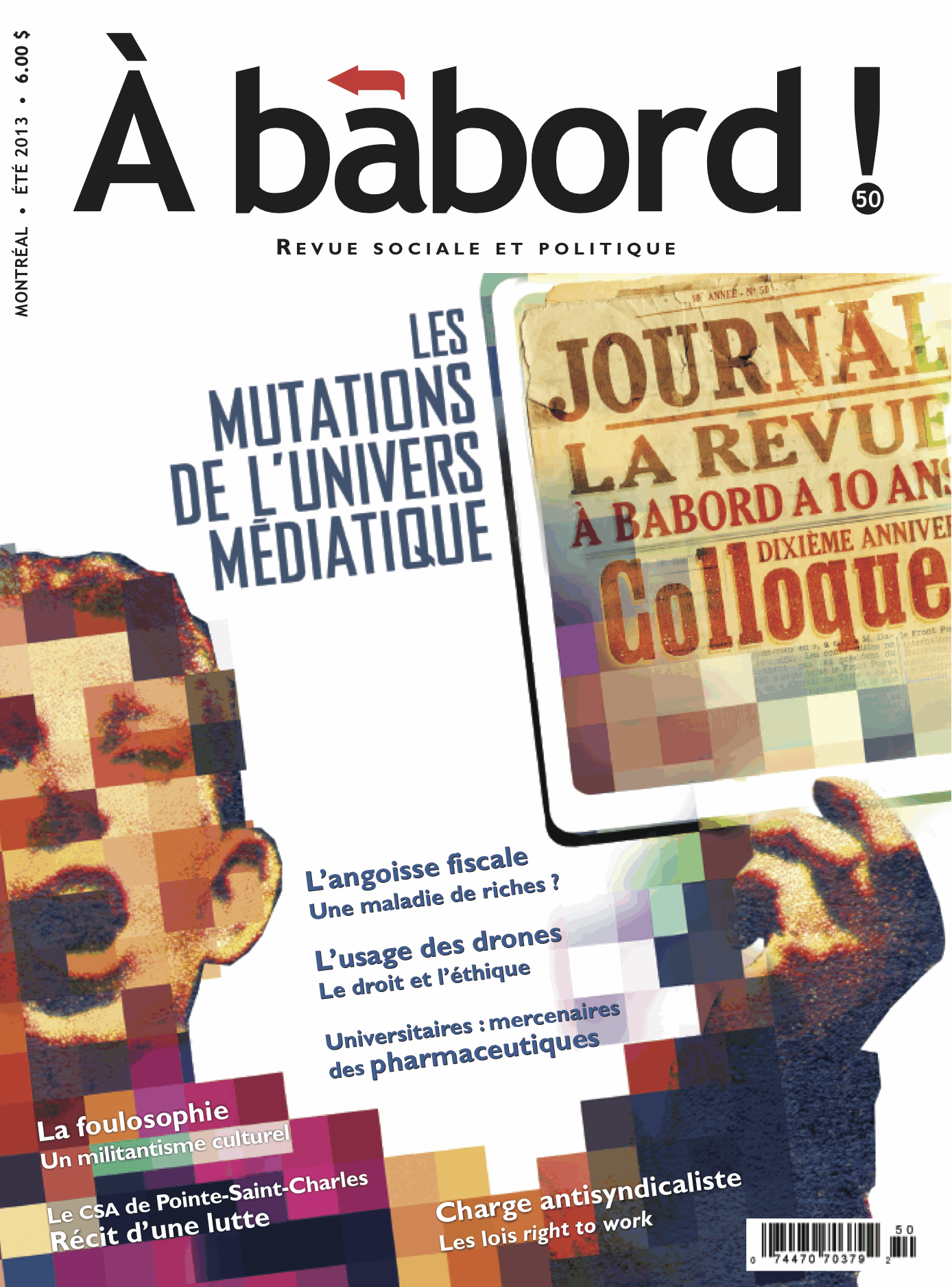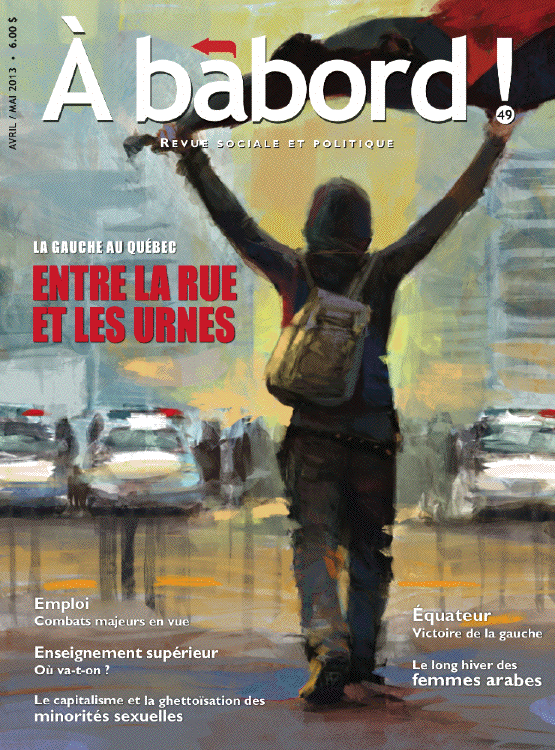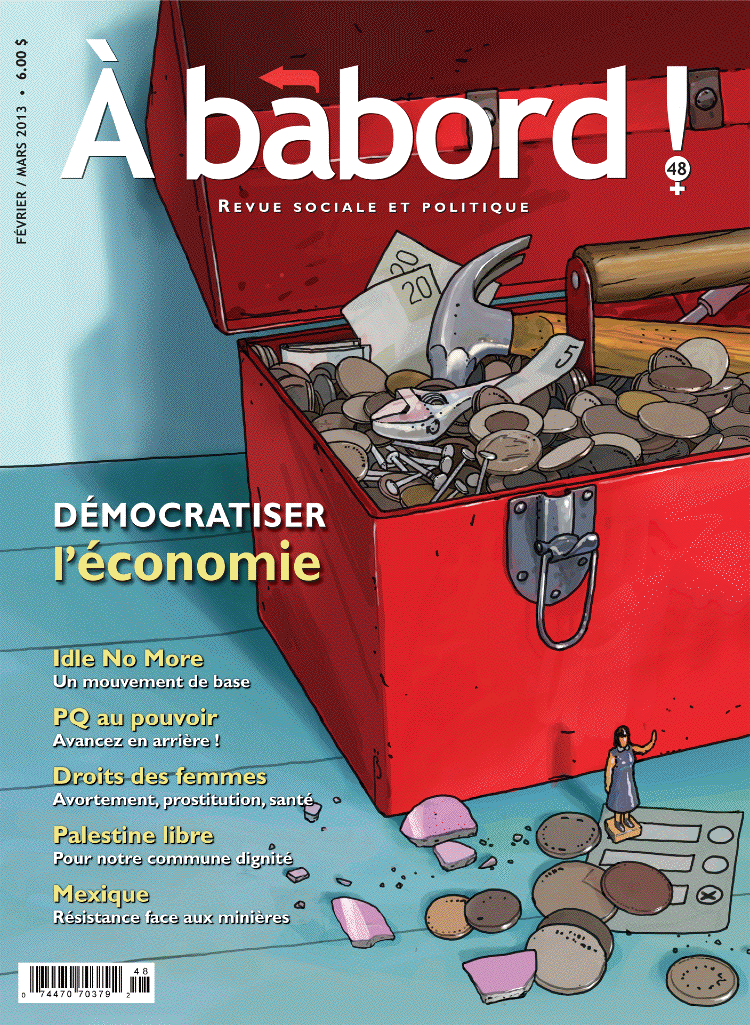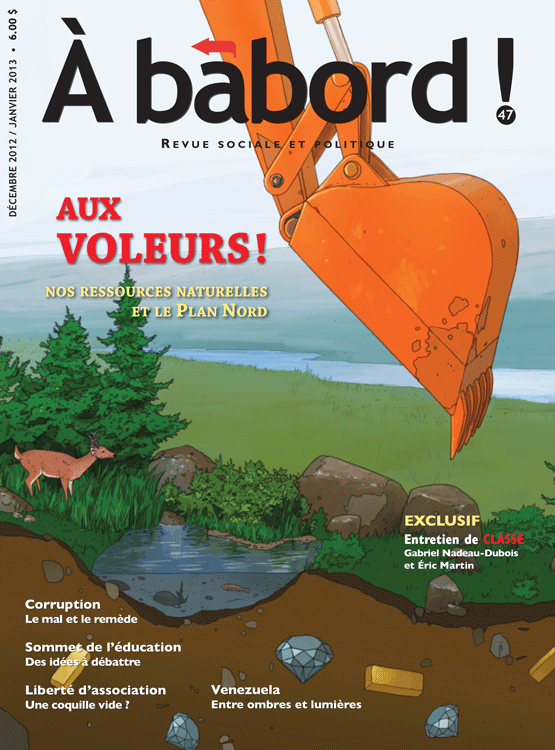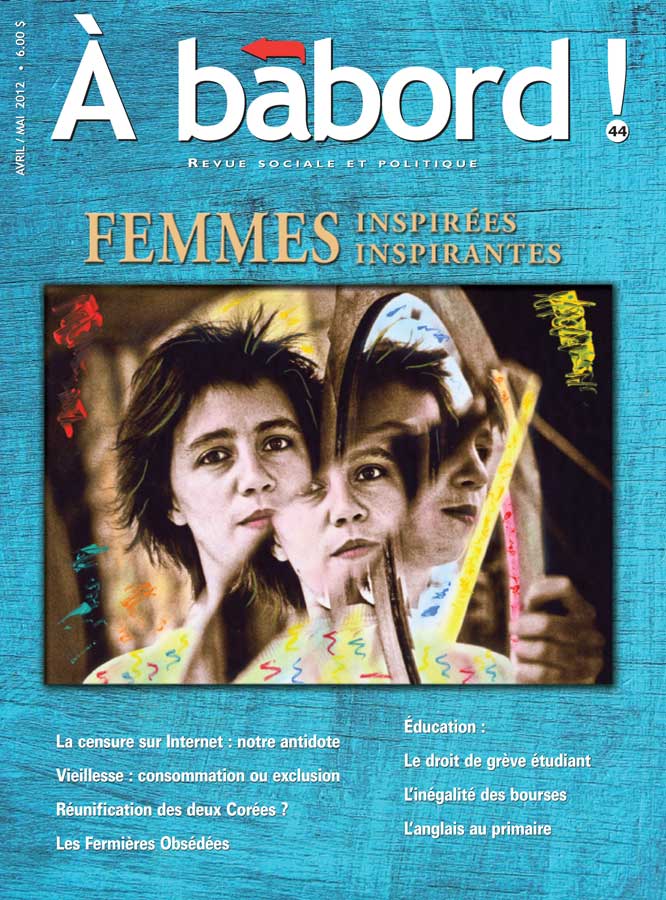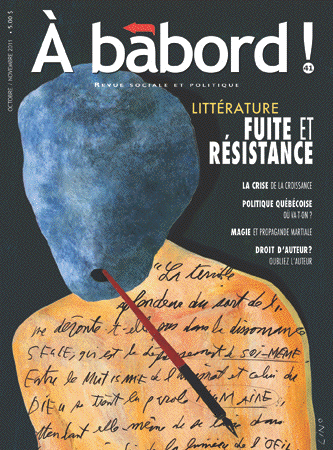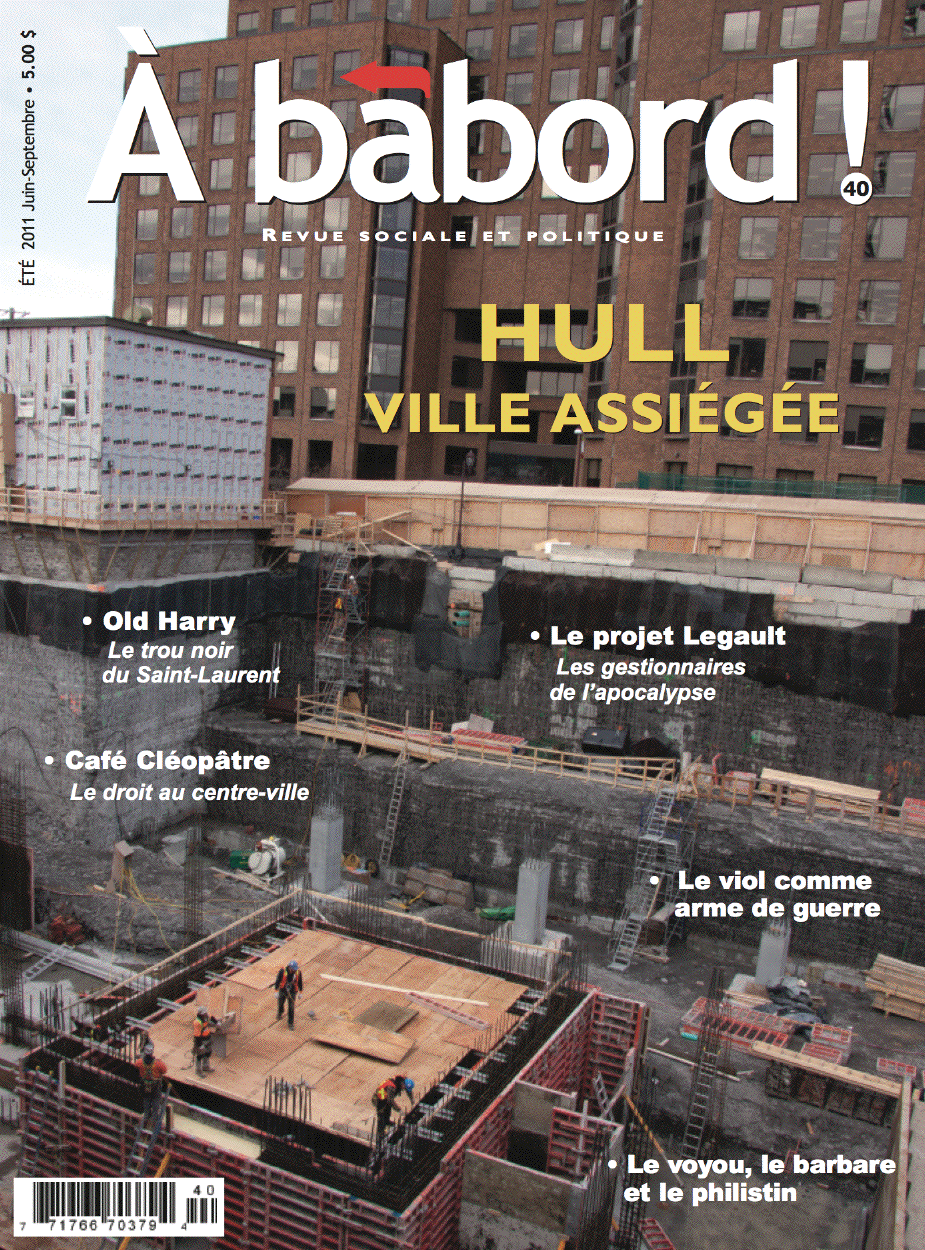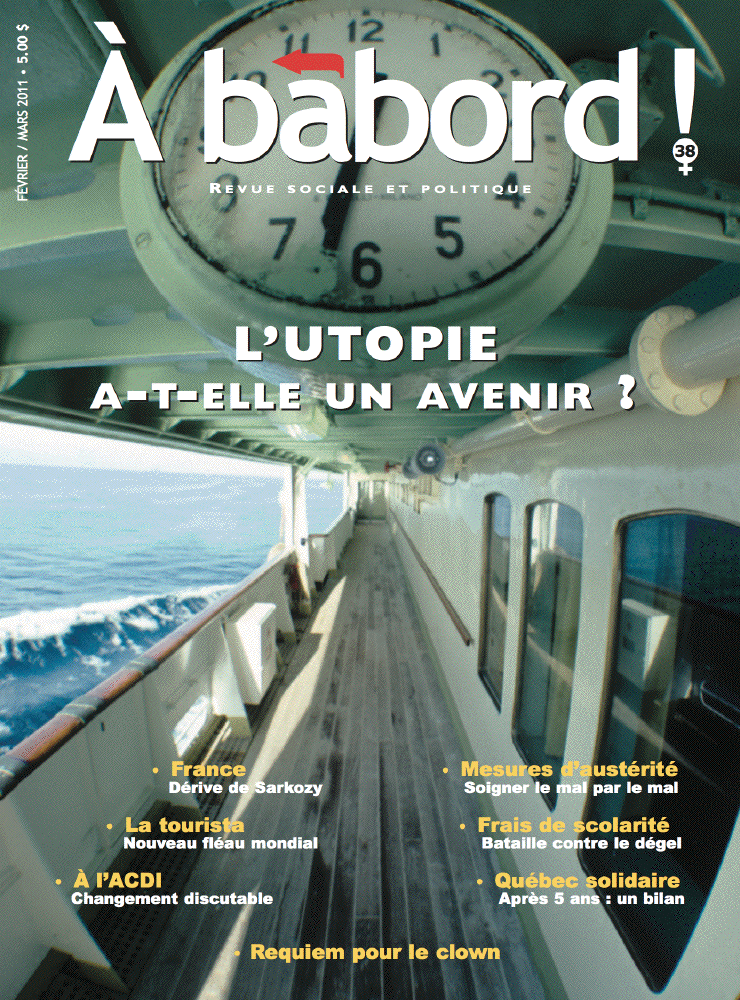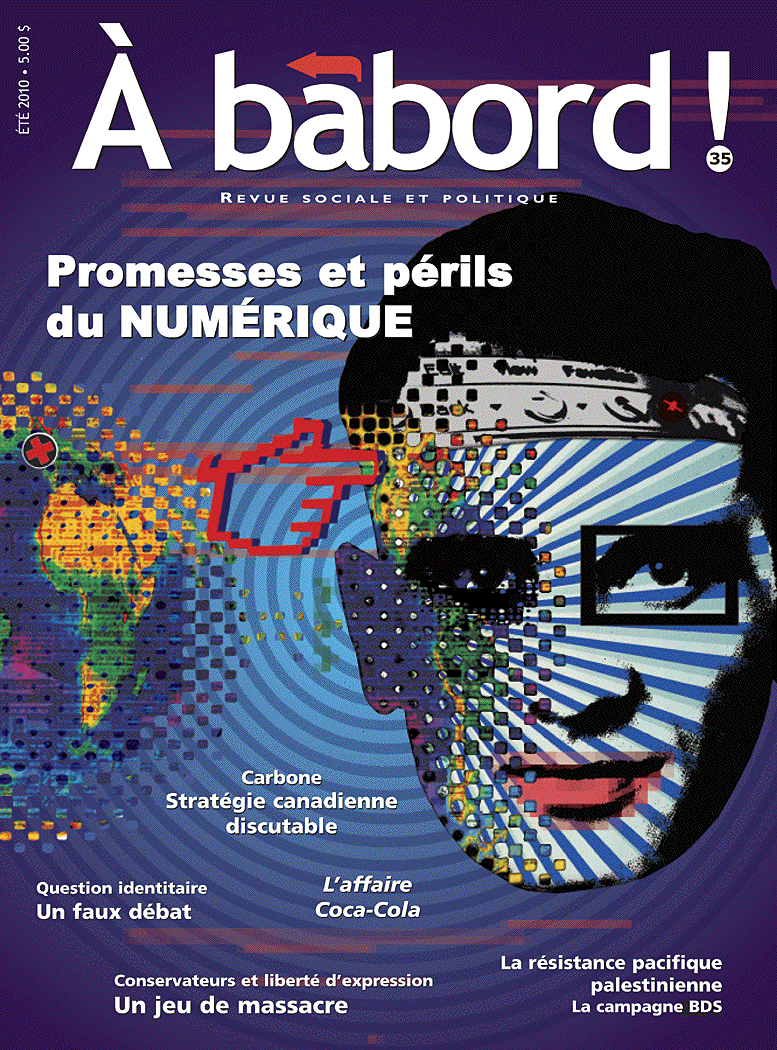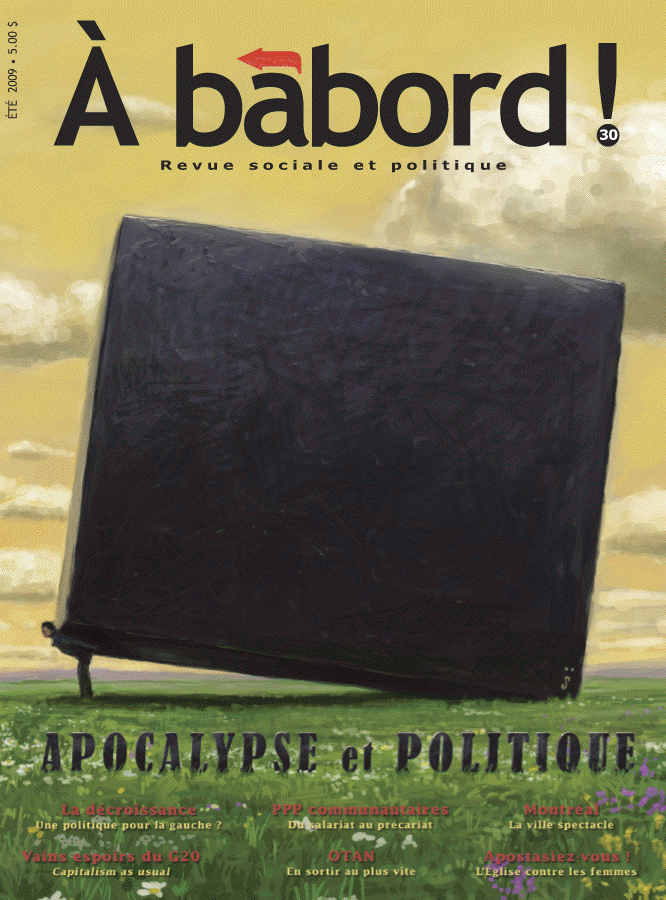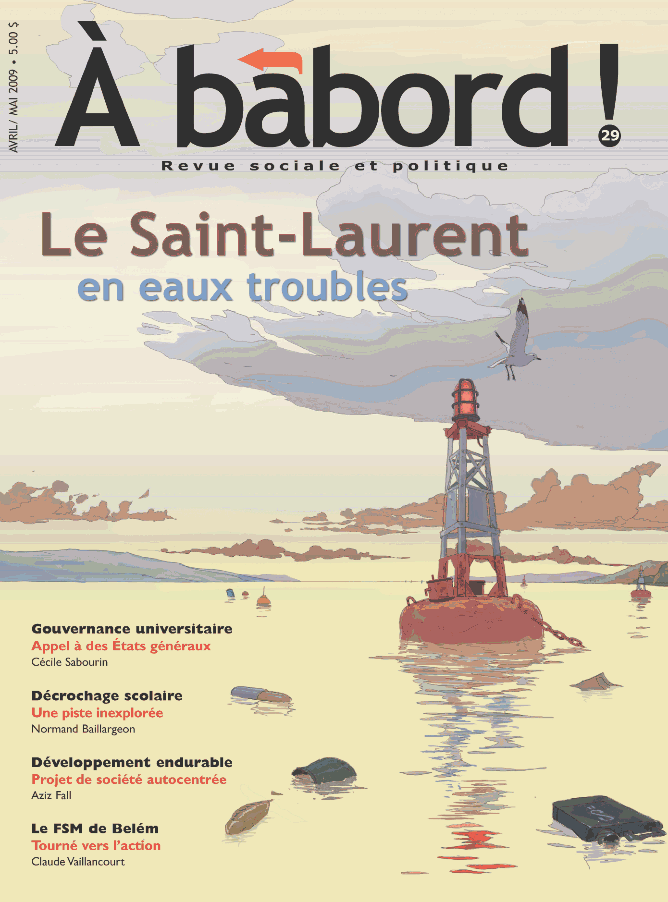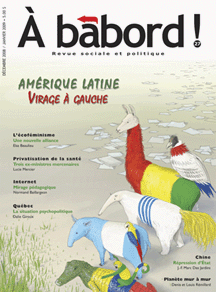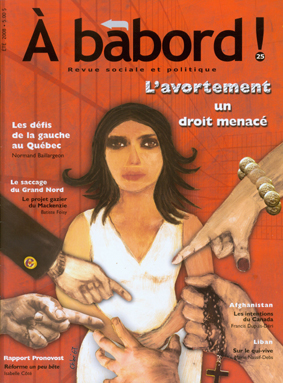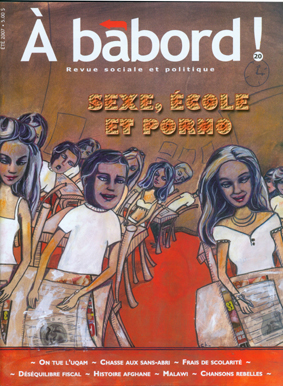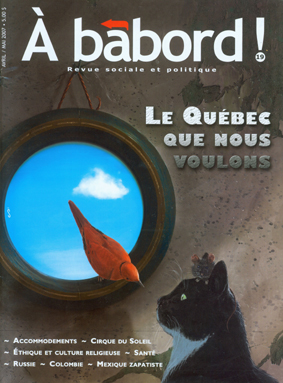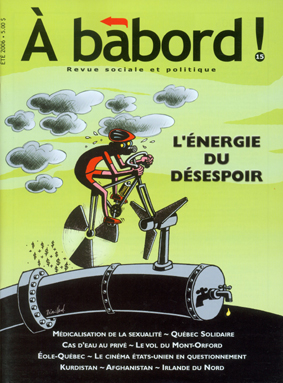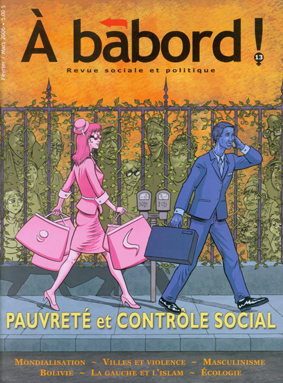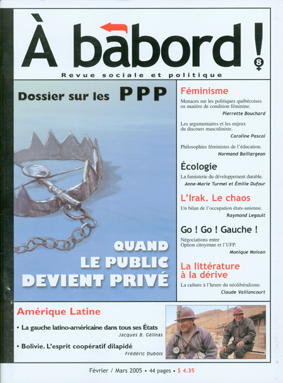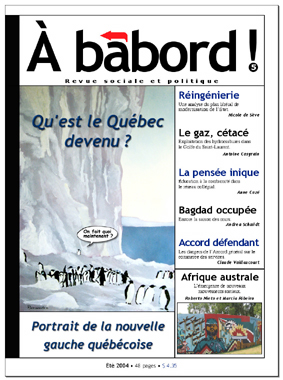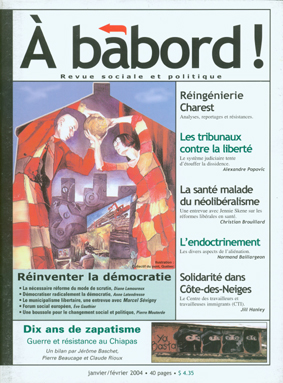Syndicalisme en France
Bataille des retraites
Chronique Travail
Le mouvement social qui a secoué la France cet hiver contre le projet de réforme du système public de retraite a soulevé intérêts et interrogations au Québec. Afin de mieux le comprendre, penchons-nous sur les raisons de cette colère sociale et politique ainsi que sur ses implications pour le mouvement syndical.
Ce n’est pas la première fois que la question des retraites soulève les passions en France. Vue d’ici, où le sujet est rarement débattu, cette situation peut sembler incongrue. Il y aurait pourtant un intérêt à ce que, partout, la dimension profondément politique des régimes de retraite soit remise de l’avant, plutôt que de les traiter comme des sujets techniques ou encore sous l’angle de la « responsabilité individuelle » à se constituer un pécule personnel pour ses « vieux jours ».
Plus que des retraites, un acquis social
Mais revenons à la France. La première chose à garder en tête est que, contrairement au Québec, la vaste majorité des revenus des personnes retraitées provient des pensions du régime public. Quand des régimes complémentaires existent, ils ne sont pas proposés entreprise par entreprise, mais concernent l’ensemble d’un secteur économique ou d’un corps de métiers. On est donc dans un système plus uniforme, où la part des régimes publics est très importante.
Autre caractéristique majeure : le système de retraite français est par répartition, plutôt que par capitalisation. Cela signifie que les cotisations payées au régime une année donnée vont directement servir à verser les retraites cette même année. Les personnes actives paient donc les pensions des personnes retraitées, tout en accumulant par là même des droits à en recevoir une quand leur tour sera venu. Ceci a l’avantage de ne pas faire passer les sommes dédiées aux retraites par le système financier et boursier, et donc de ne pas les exposer à ses soubresauts. Le régime français repose sur un principe de solidarité intergénérationnelle qui est toutefois régulièrement testé par les évolutions démographiques. Si la proportion de personnes retraitées augmente trop par rapport au nombre de personnes actives, court-on le risque d’un déséquilibre ?
Cette question revient régulièrement dans le débat public français, au point où l’on a mis en place, en 2000, un Conseil d’orientation des retraites (COR) censé fournir des données objectives sur la question. Seulement, voilà, même sur les chiffres du COR et leur interprétation, il y a débat. À droite, on envisage un scénario catastrophe où le système s’effondrerait sans un allongement de la durée de cotisation (d’où la fameuse proposition de faire passer l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans). À gauche, on souligne que les prévisions ne sont pas si alarmantes et on insiste sur le fait que si un effort doit être fait pour assurer la pérennité du régime, c’est au capital qu’il faut le demander, plutôt qu’au travail. On fait également remarquer que, malgré ses imperfections, le système français fait en sorte que le taux de pauvreté chez les personnes retraitées y est l’un des plus bas en Europe, et que plutôt que de faire du nivellement par le bas, on devrait encourager les autres à s’en inspirer [1].
Au-delà de l’impact matériel que ces enjeux ont sur la vaste majorité des personnes salariées en France, le régime de retraite par répartition revêt une forte dimension symbolique. Il est l’une des pierres d’assise du « modèle social » mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et auquel la plupart des Français·es sont très attaché·es. Avec l’assurance maladie et les allocations familiales, les retraites sont l’incarnation de ces « acquis sociaux » conquis de haute lutte. L’âge de départ à la retraite, et en particulier sa baisse, est devenu un indicateur du progrès social et des volontés d’émancipation des travailleuses et travailleurs. C’est dans ce contexte économique et politique qu’il faut comprendre les manifestations de cet hiver.
Et le syndicalisme, dans tout ça ?
Si la France est connue pour quelque chose, c’est bien sa capacité à voir ses rues s’emplir de manifestant·es lorsque la situation sociale ou politique l’exige. Le présent mouvement ne fait pas exception. Avec plus d’une dizaine de journées nationales d’action et des millions de personnes venues manifester, il s’agit d’une des plus fortes mobilisations que la France ait connues dans les dernières décennies. Fait notoire, ce ne sont pas seulement les grandes villes qui ont participé, mais aussi les régions moins densément peuplées, signe de la grande popularité du mouvement. Au cœur de ces dynamiques : les organisations syndicales qui, situation relativement inusitée, ont réussi à maintenir une unité presque sans failles depuis les débuts de cette lutte.
Le contraste est toujours frappant entre cette forte capacité de mobilisation et le taux de syndicalisation famélique (autour de 10 %) que connait la France. Cet apparent paradoxe s’explique avant tout par le cadre juridique des relations du travail. Si les syndicats sont bien les agents négociateurs des conditions de travail, celles-ci s’appliquent à l’ensemble des salarié·es, quel que soit leur statut syndical. Il n’y a donc pas d’avantage individuel immédiat à la syndicalisation, qui prend plutôt la forme d’un geste militant. Le taux de syndicalisation ne résume pas non plus à lui seul la situation. Le fait de se syndiquer étant un choix individuel, ces 10 % peuvent être répartis dans plusieurs milieux de travail, assurant une présence syndicale plus importante que les chiffres ne peuvent le laisser penser.
Difficile de ne pas mentionner également que la mobilisation a pris une nouvelle ampleur chaque fois que le gouvernement y répondait de façon autoritaire, une dynamique qui n’est pas sans rappeler celle du Printemps érable de 2012. Le recours à l’article 49.3 de la Constitution pour faire cesser les débats à l’Assemblée nationale (peu ou prou l’équivalent du « bâillon » au Québec), la répression policière et les limitations au droit de manifester n’ont fait qu’attiser la colère des Français·es qui finirent par… sortir les casseroles !
C’est bien sur ces bases que les syndicats ont réussi à faire lever le mouvement exceptionnel dont nous avons été témoins cet hiver. L’intersyndicale a réussi à conserver son unité notamment du fait que la Confédération française démocratique du travail (CFDT), habituellement plutôt frileuse à contester les réformes néolibérales, a décidé cette fois-ci de se joindre au mouvement. De son côté, la Confédération générale du travail (CGT), considérée comme plus combative, s’est engagée de plain-pied dans la mobilisation tout en tenant son 53e congrès au cours duquel les courants internes se sont affrontés de façon parfois houleuse [2]. Au final, c’est une candidate inattendue, Sophie Binet, qui est devenue nouvelle secrétaire générale de la CGT, la première femme à occuper ce poste. Elle semble porteuse à la fois d’espoir d’un renouveau démocratique de sa centrale, et d’une approche ouverte et innovante du syndicalisme (à l’image de l’organisation dont elle est issue, qui a notamment été en pointe des propositions sur le droit à la déconnexion, et ce bien avant la pandémie).
Ce mouvement aura incontestablement permis de réaffirmer non seulement la résilience, mais aussi la pertinence politique des syndicats français. Au dire de trois sociologues rompus à l’analyse du mouvement syndical, celui-ci s’est fait « “parti” des classes populaires, porte-parole d’un monde du travail de moins en moins représenté dans et par les partis politiques » [3]. S’il est une leçon à retenir de ce mouvement, c’est bien celle-ci : les retraites, c’est politique. Et les syndicats peuvent et doivent jouer un rôle dans l’arène politique, au sens le plus noble du terme.
[1] Laurent Jeanneau, « Dix bonnes raisons de ne pas faire cette réforme des retraites, chiffres à l’appui », Alternatives économiques, 10 janvier 2023, www.alternatives-economiques.fr/dix-bonnes-raisons-de-ne-faire-cette-reforme-retraites-chiffres-a-l/00105748
[2] Sophie Béroud, « Le 53e congrès de la CGT, nouvel épisode d’une profonde crise de direction », Contretemps, 12 avril 2023, www.contretemps.eu/congres-cgt-crise-syndicalisme-binet-martinez
[3] Baptiste Giraud, Maxime Quijoux et Karel Yon, « Le front syndical défend les classes populaires de moins en moins représentées », Le Monde, 3 mars 2023, p. 23.