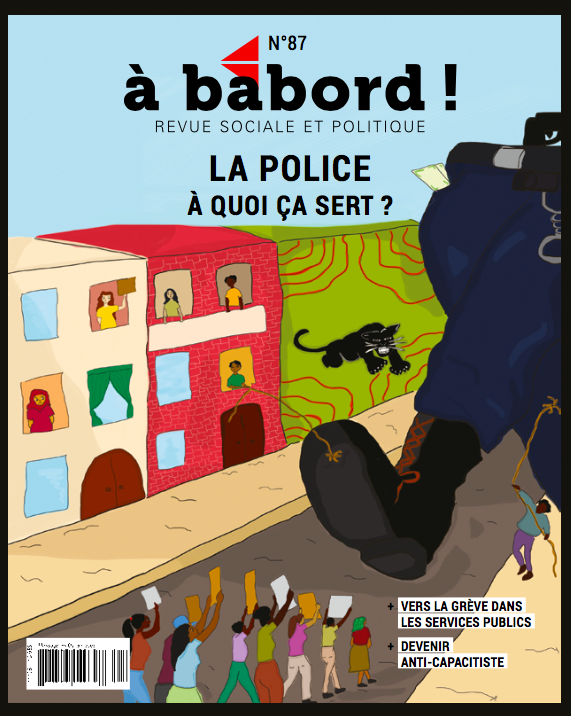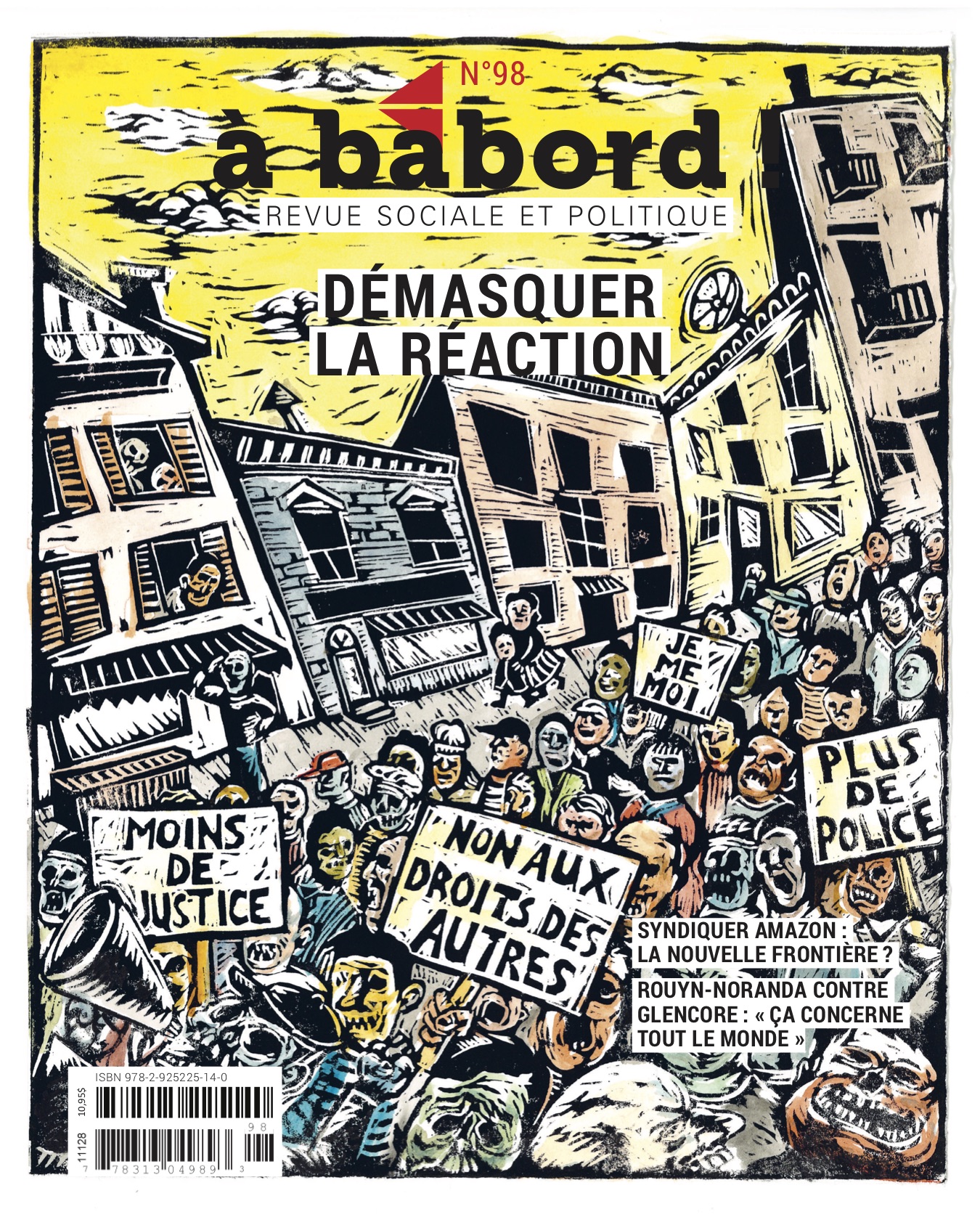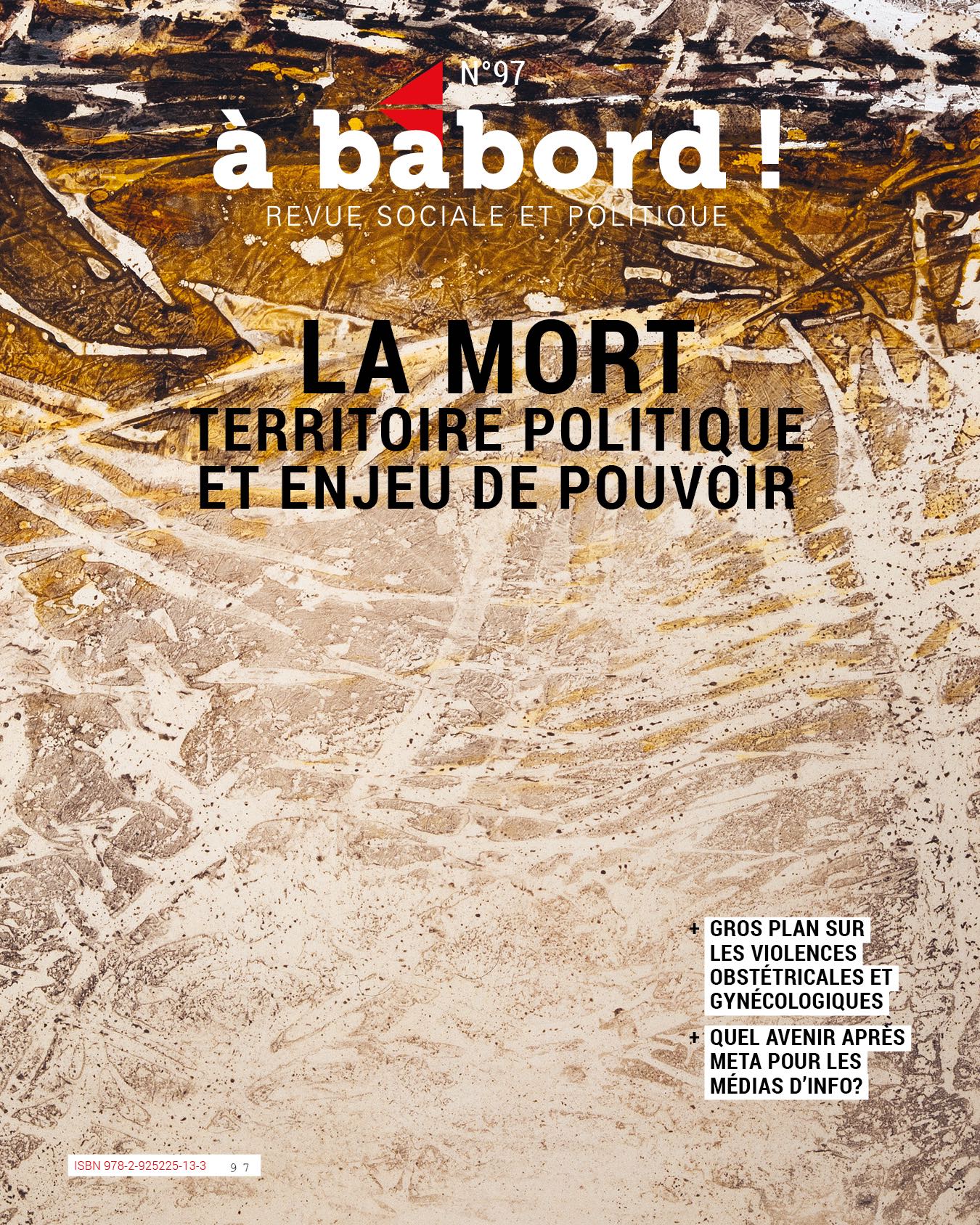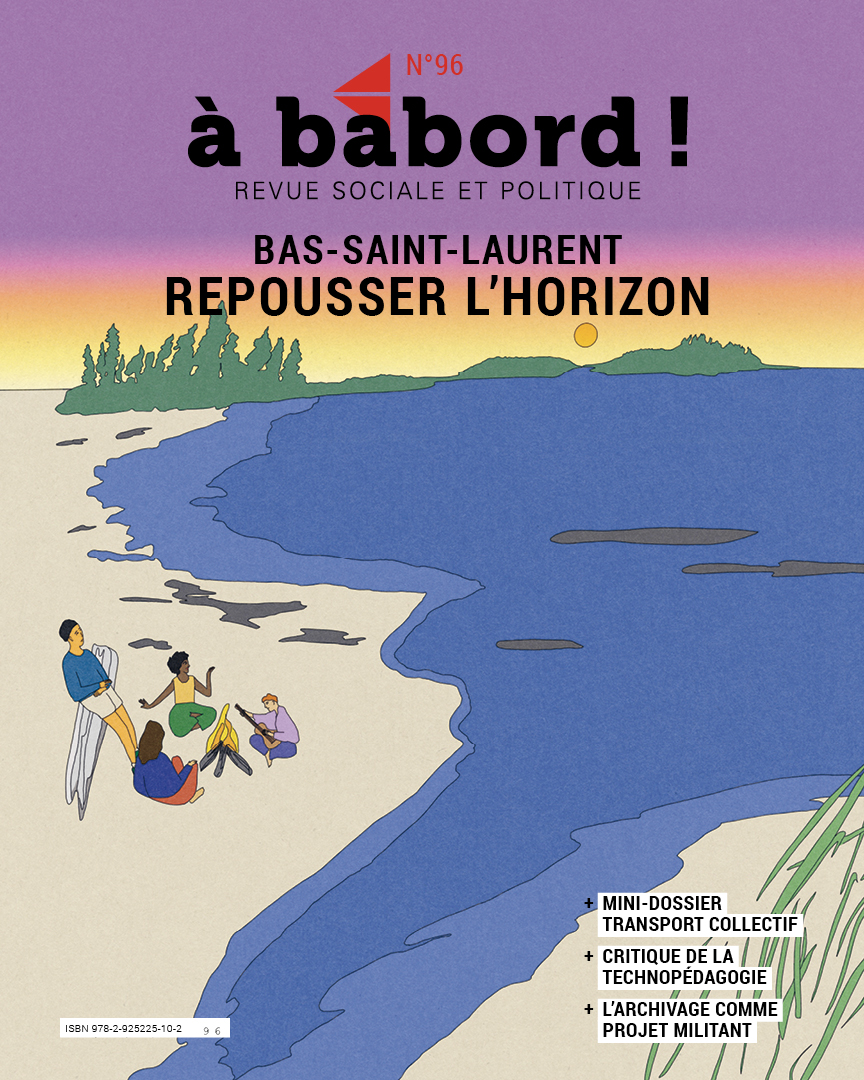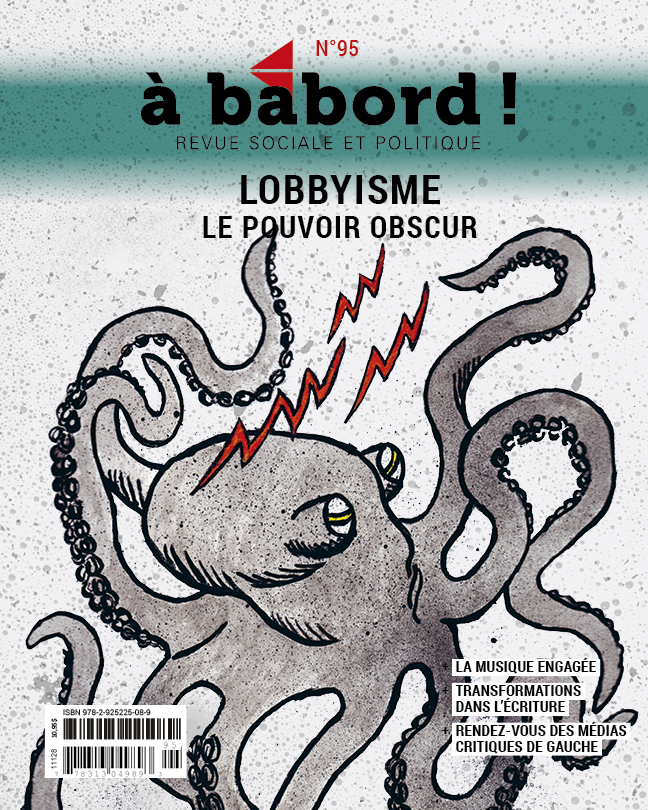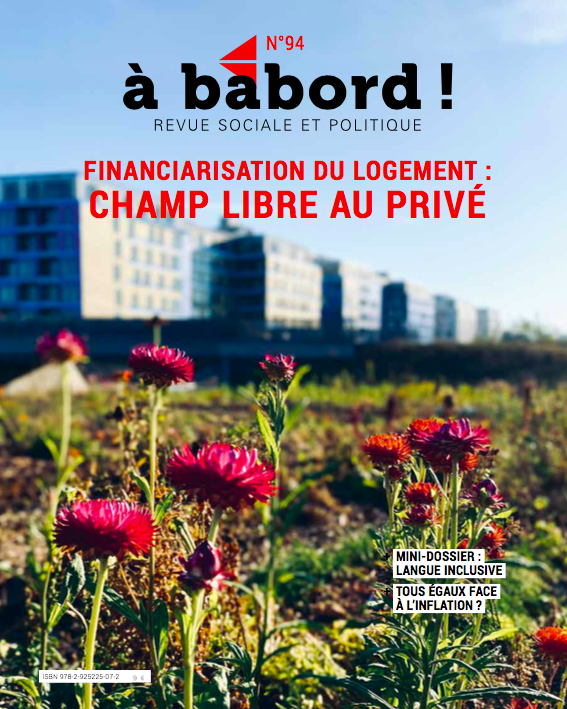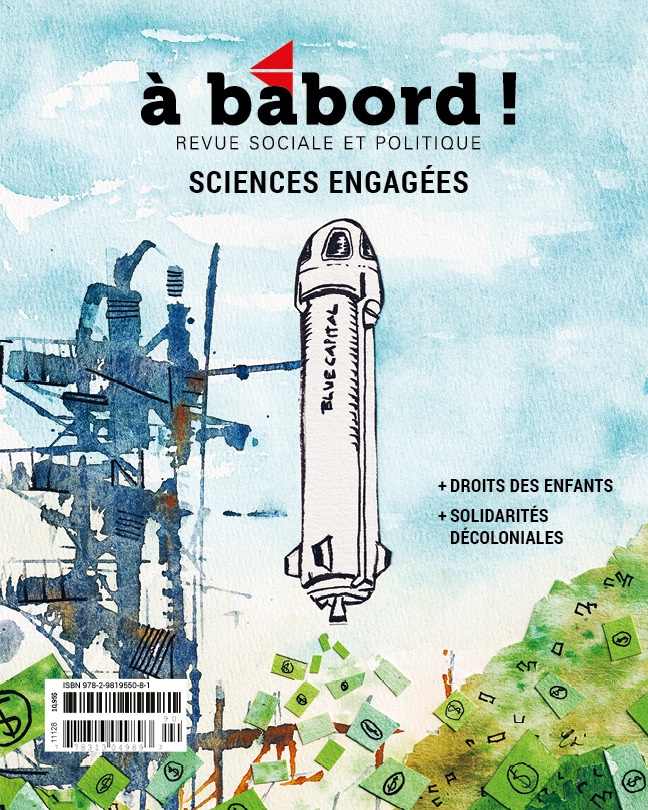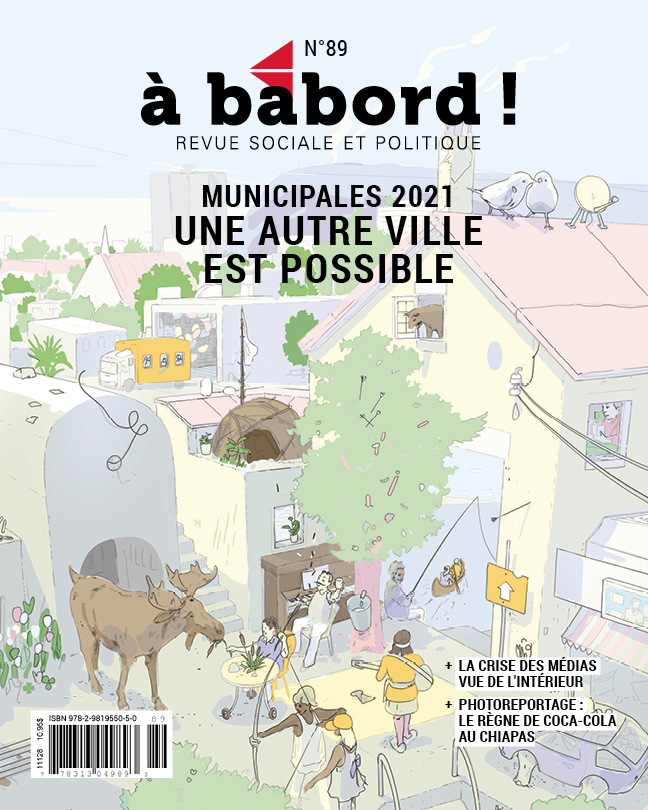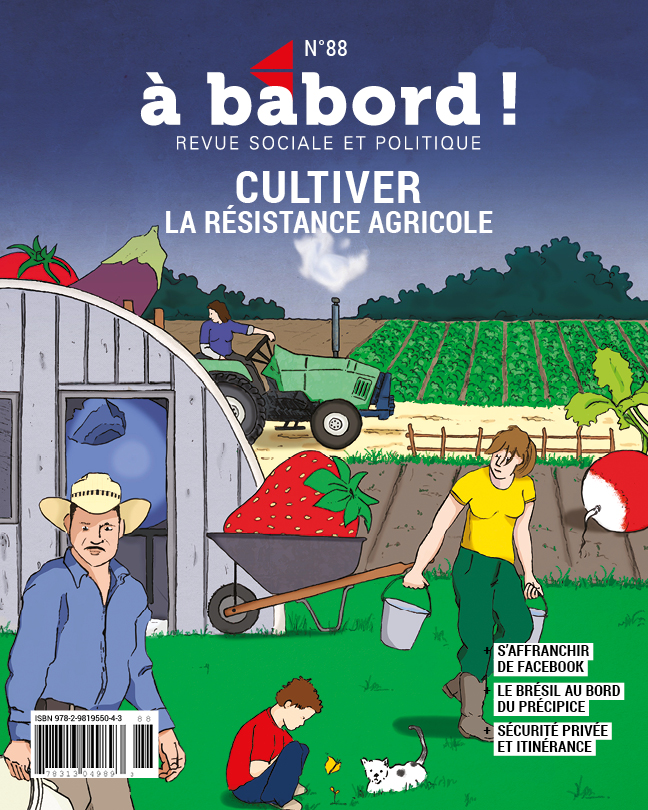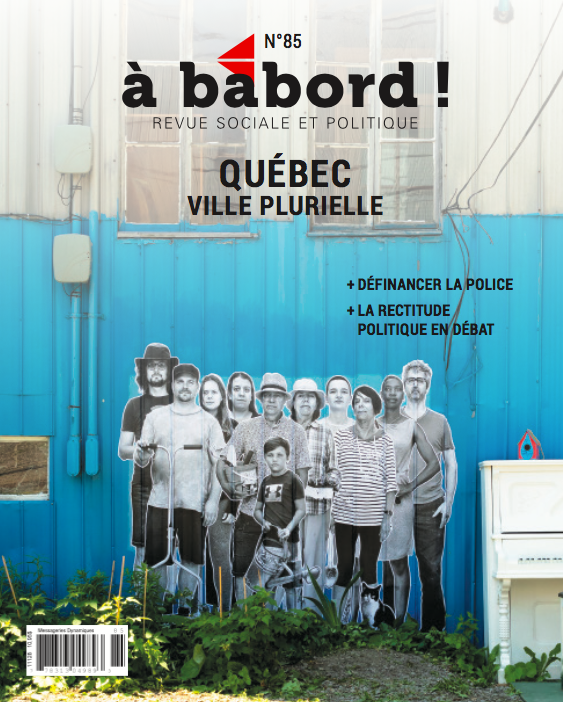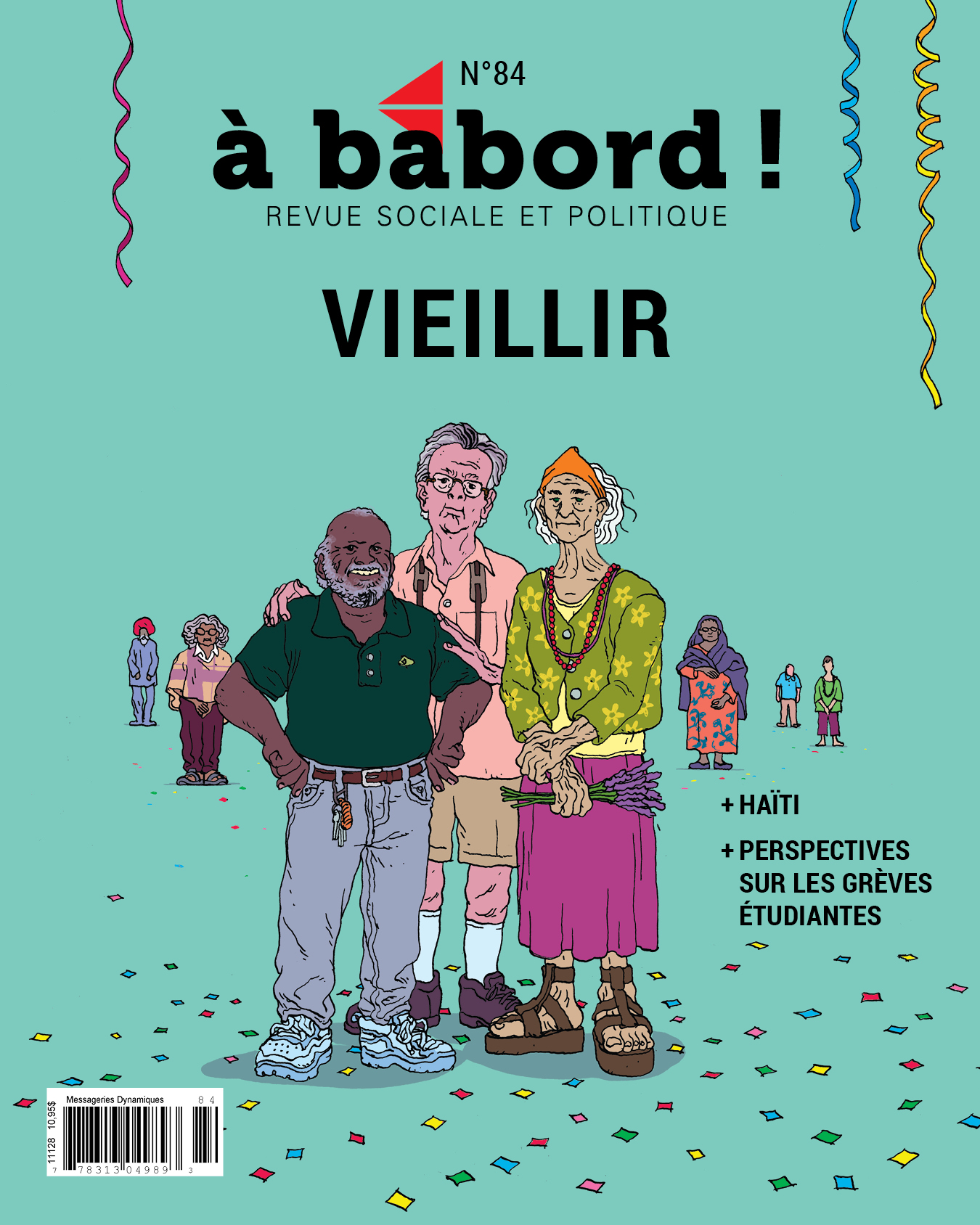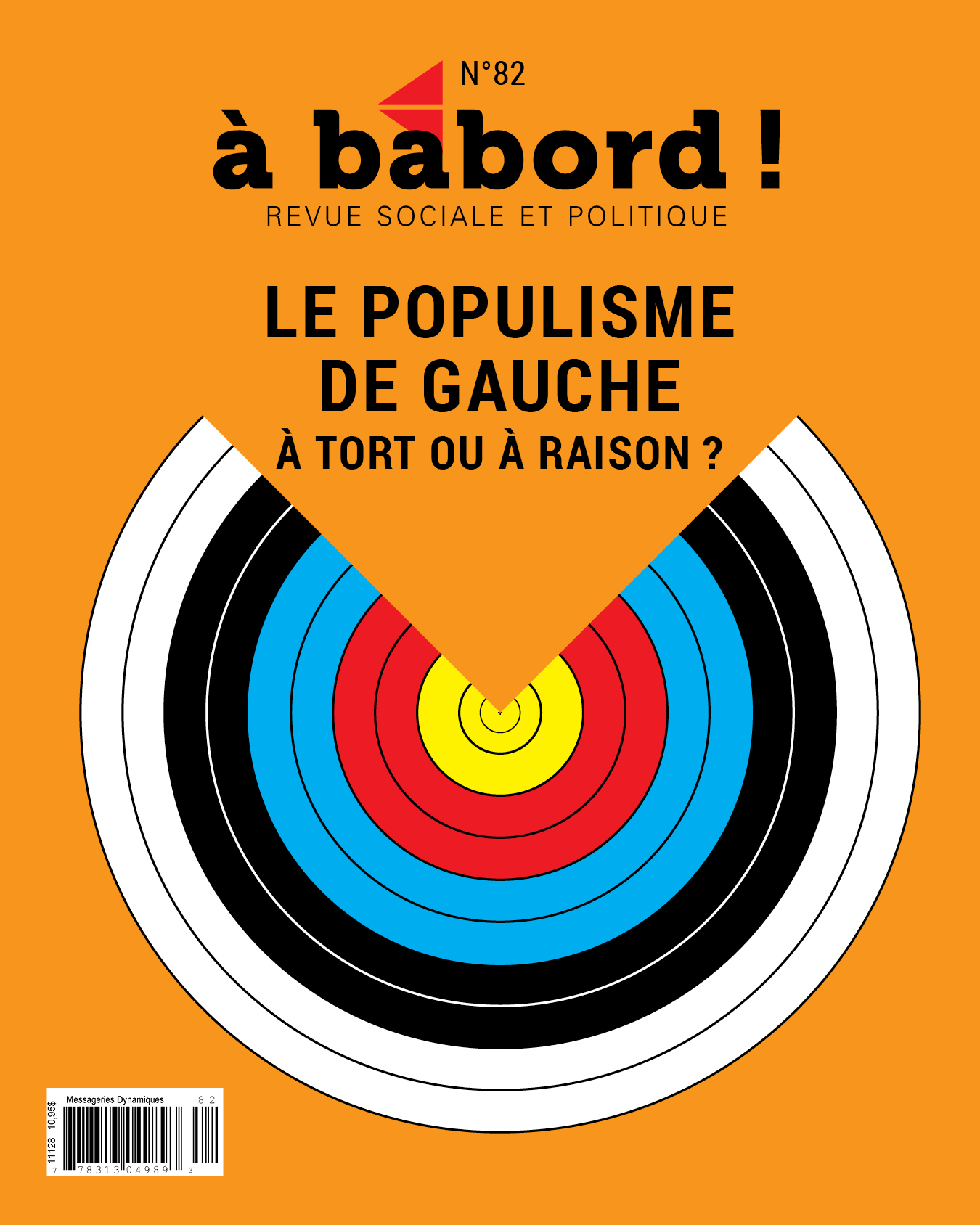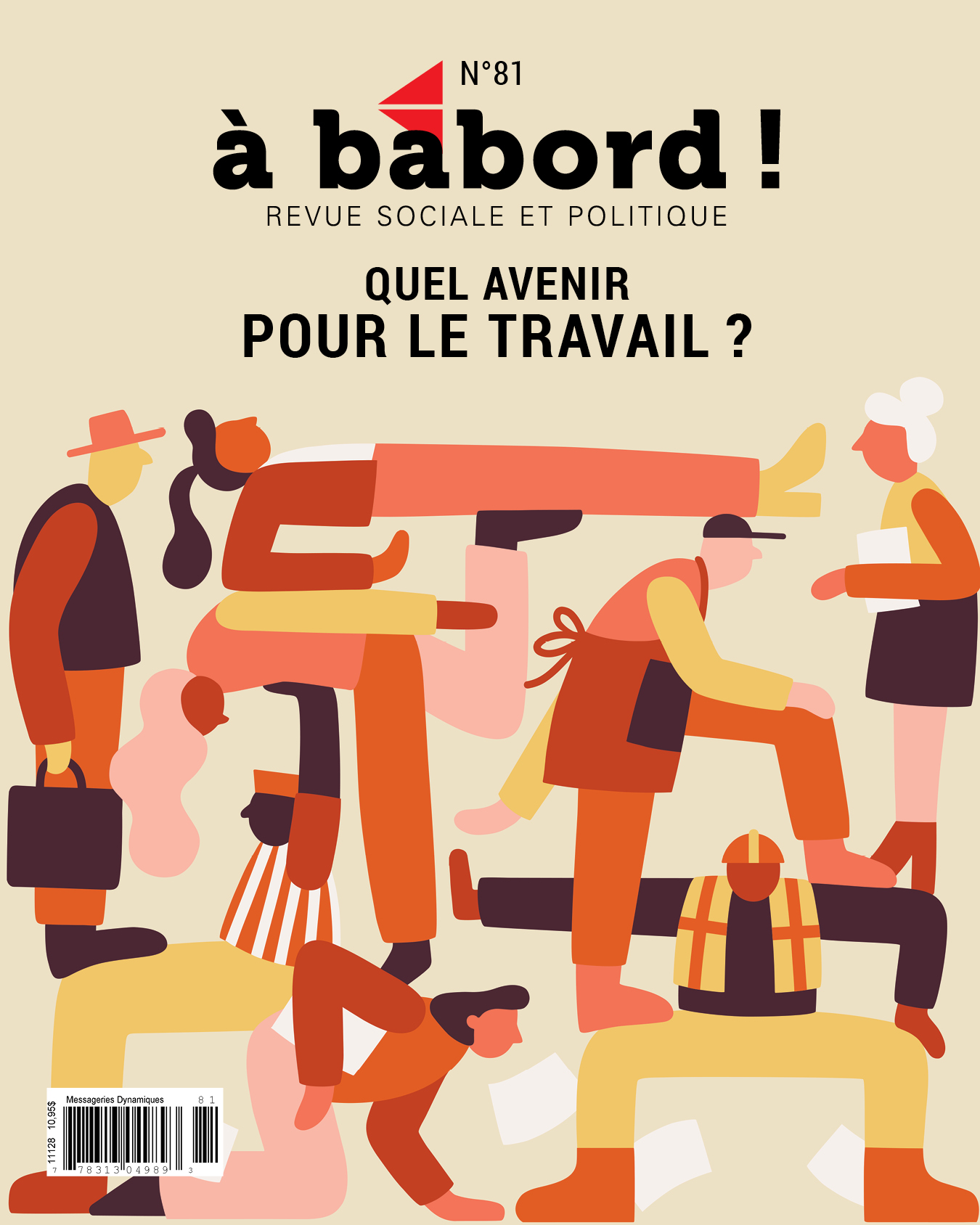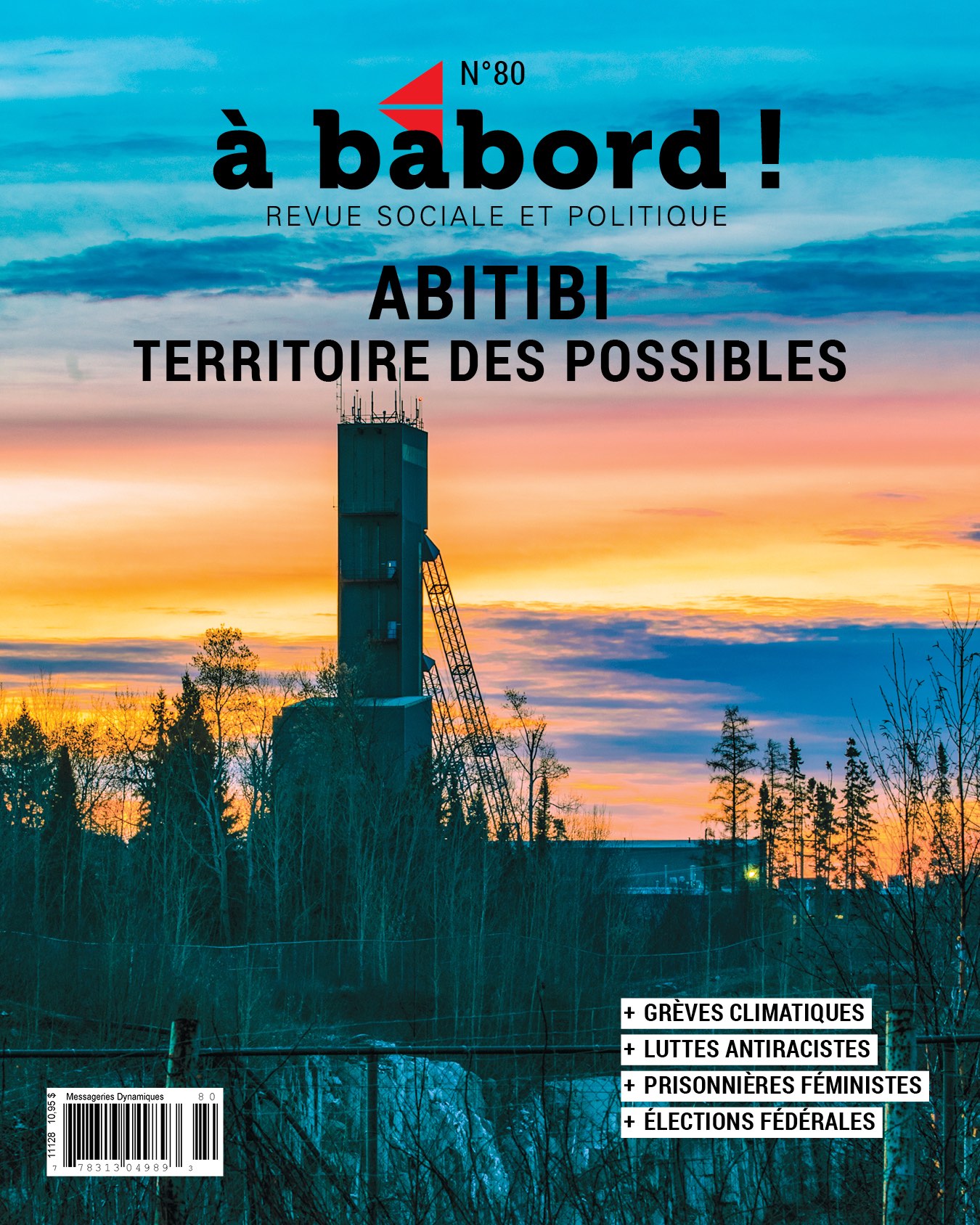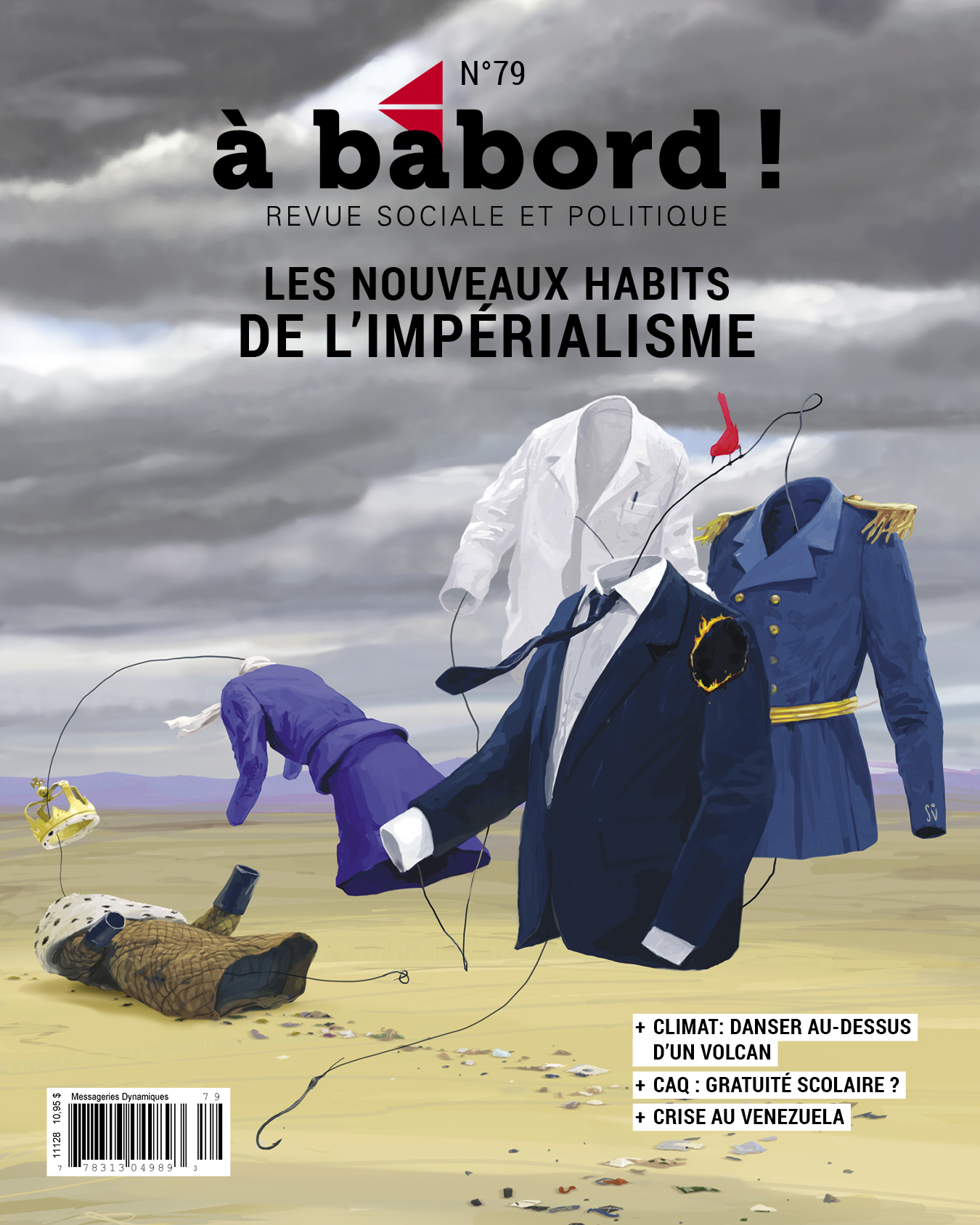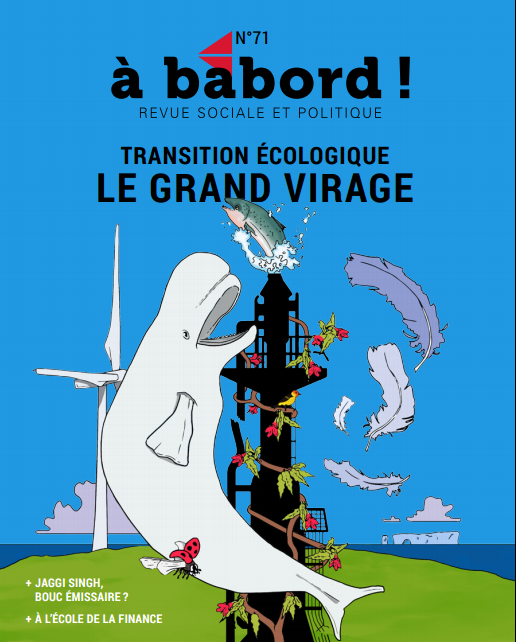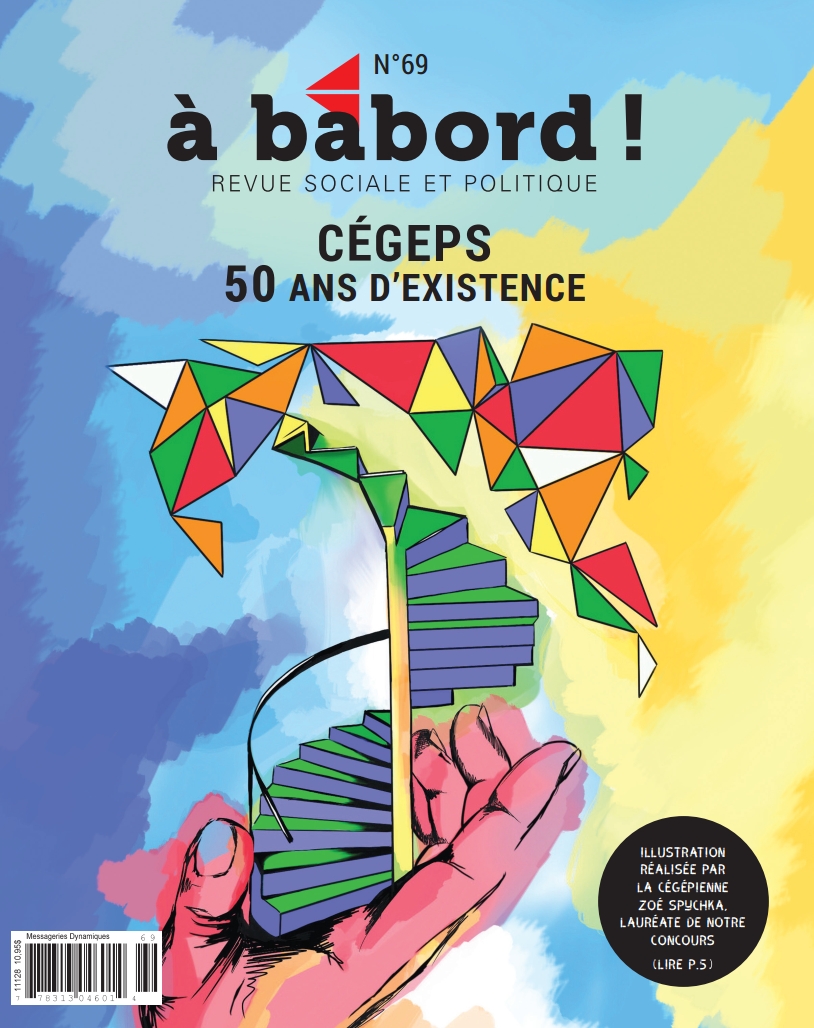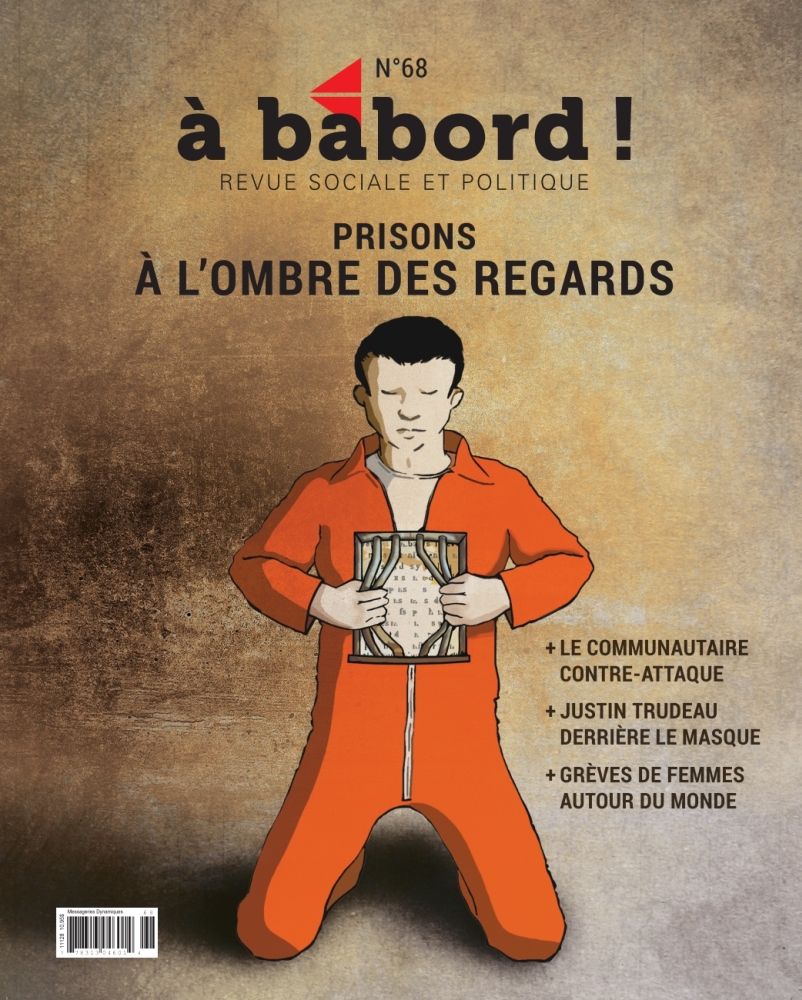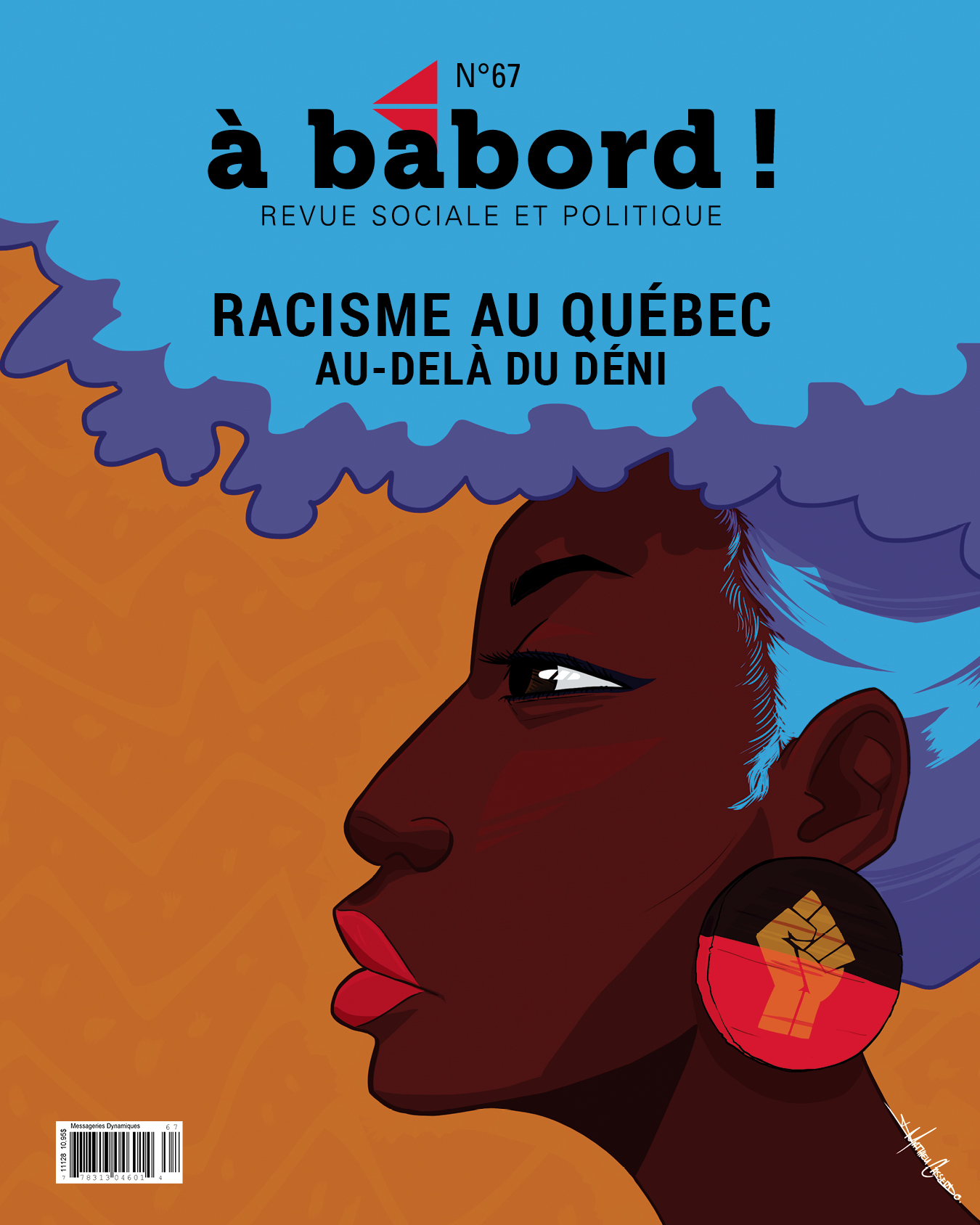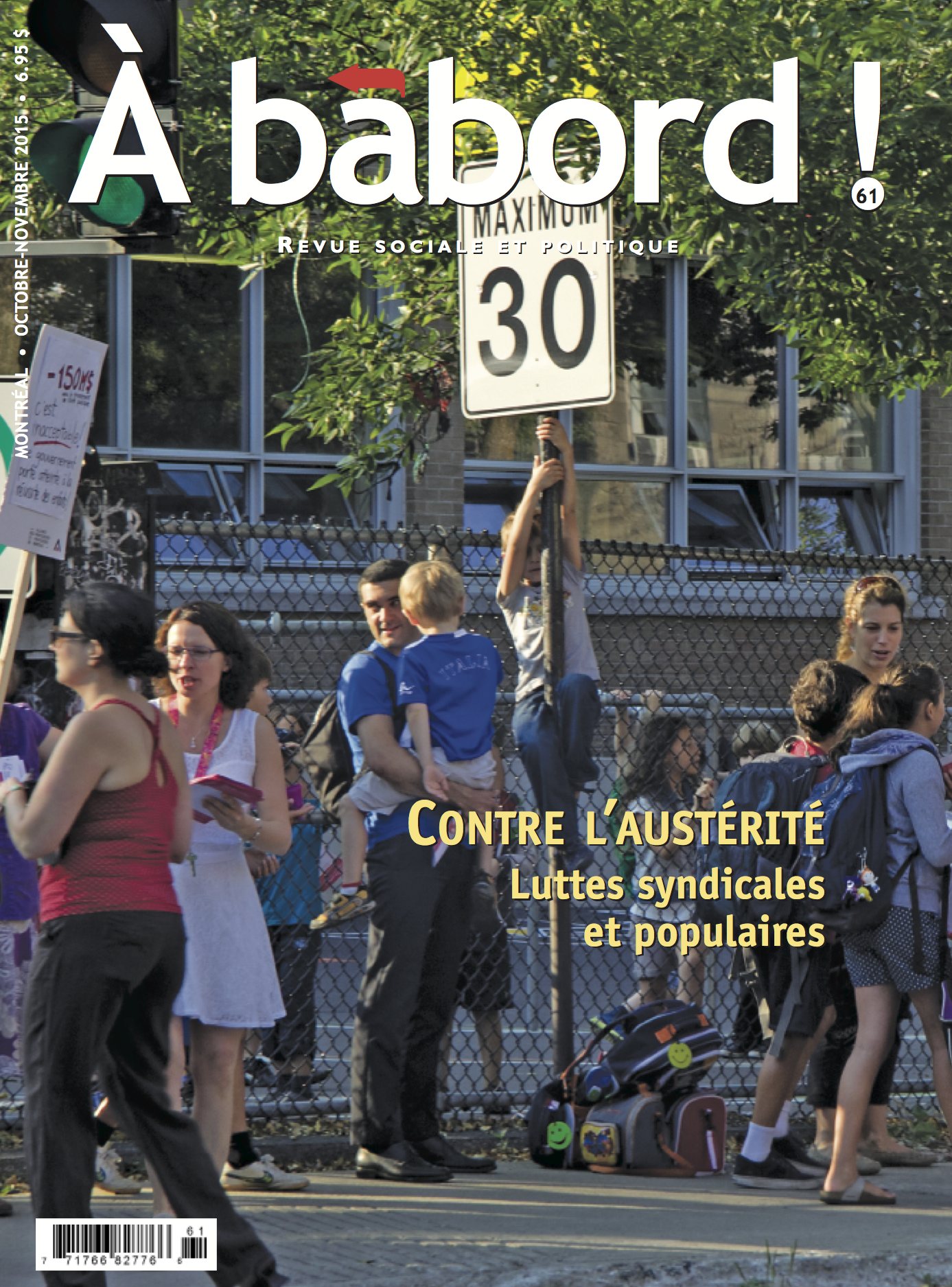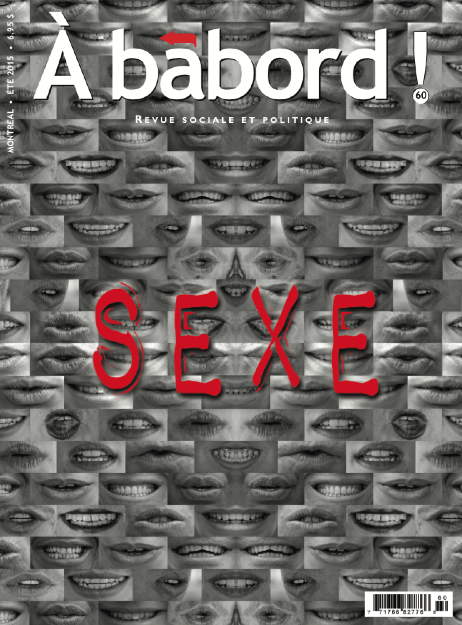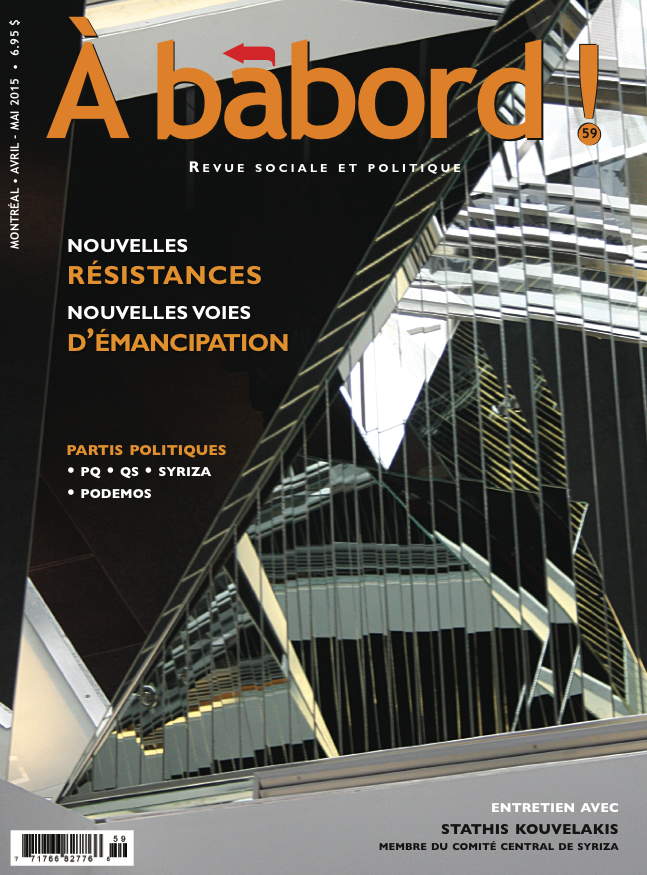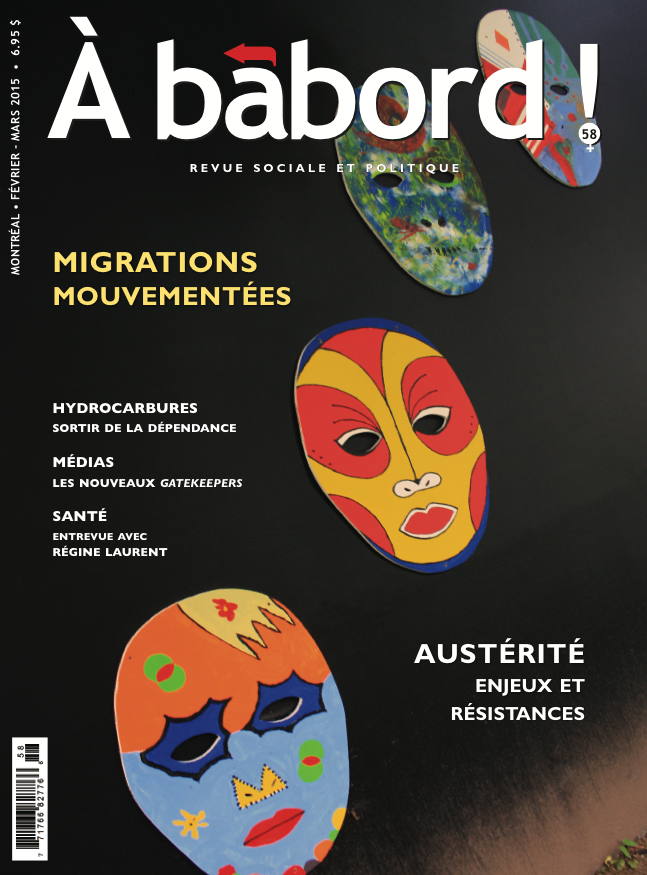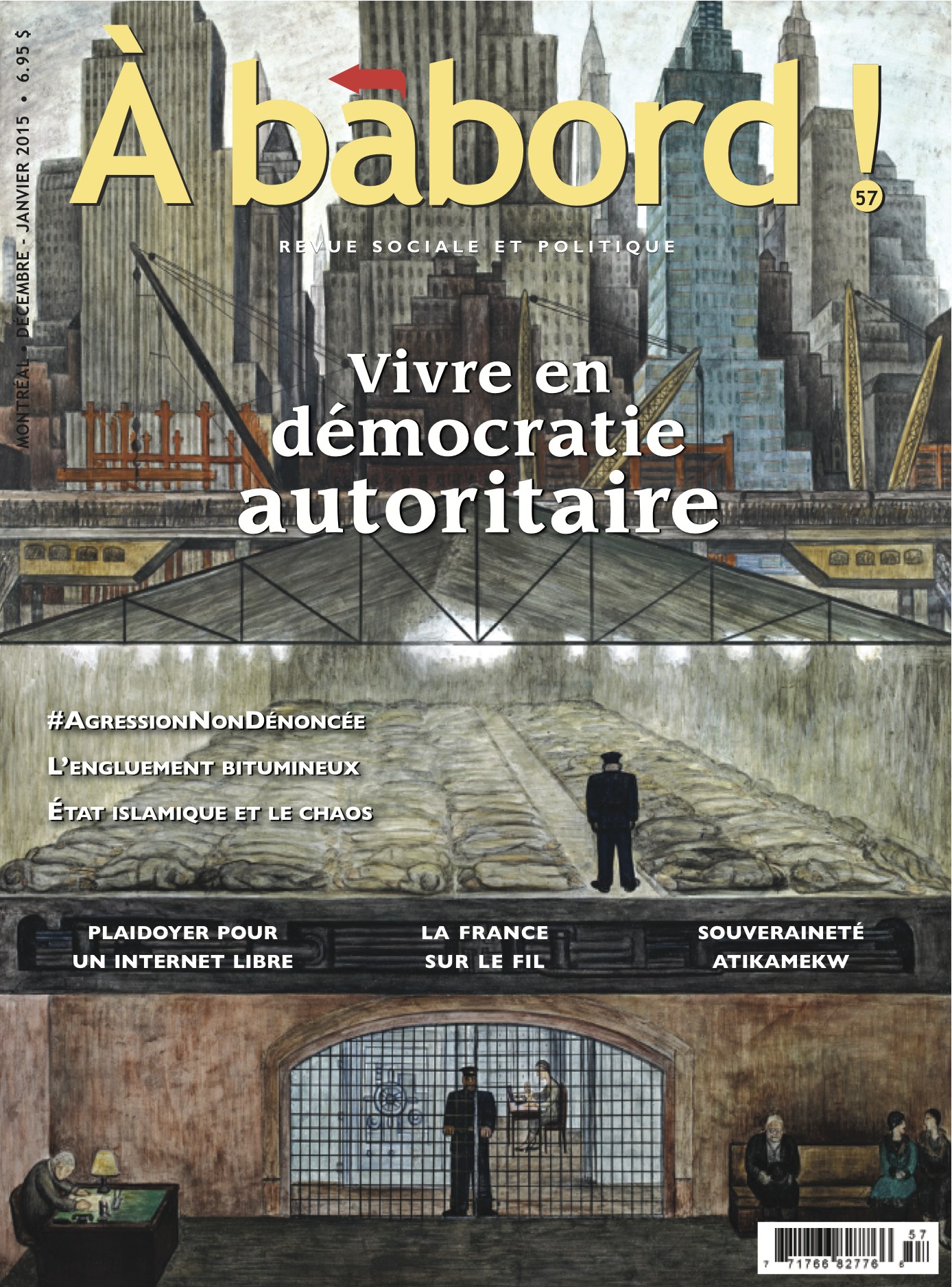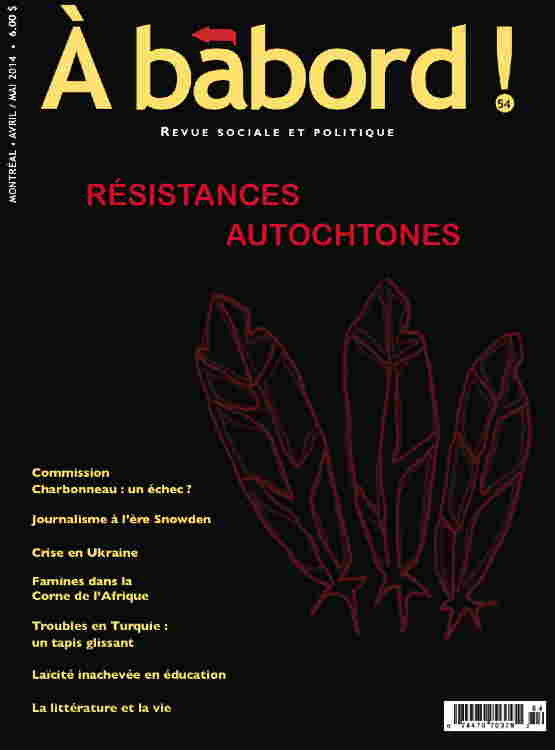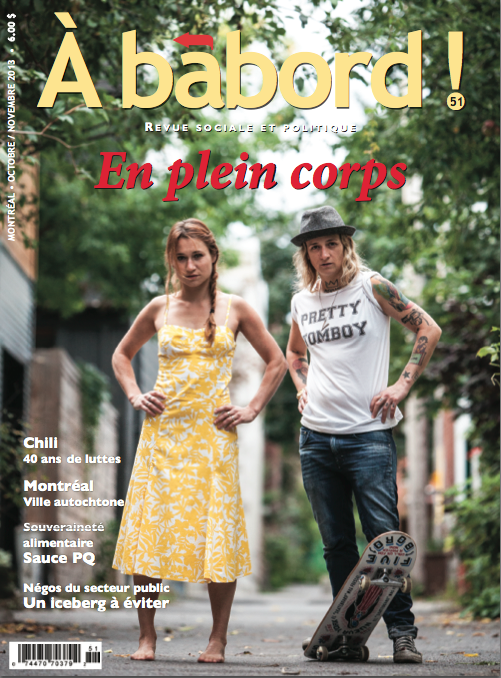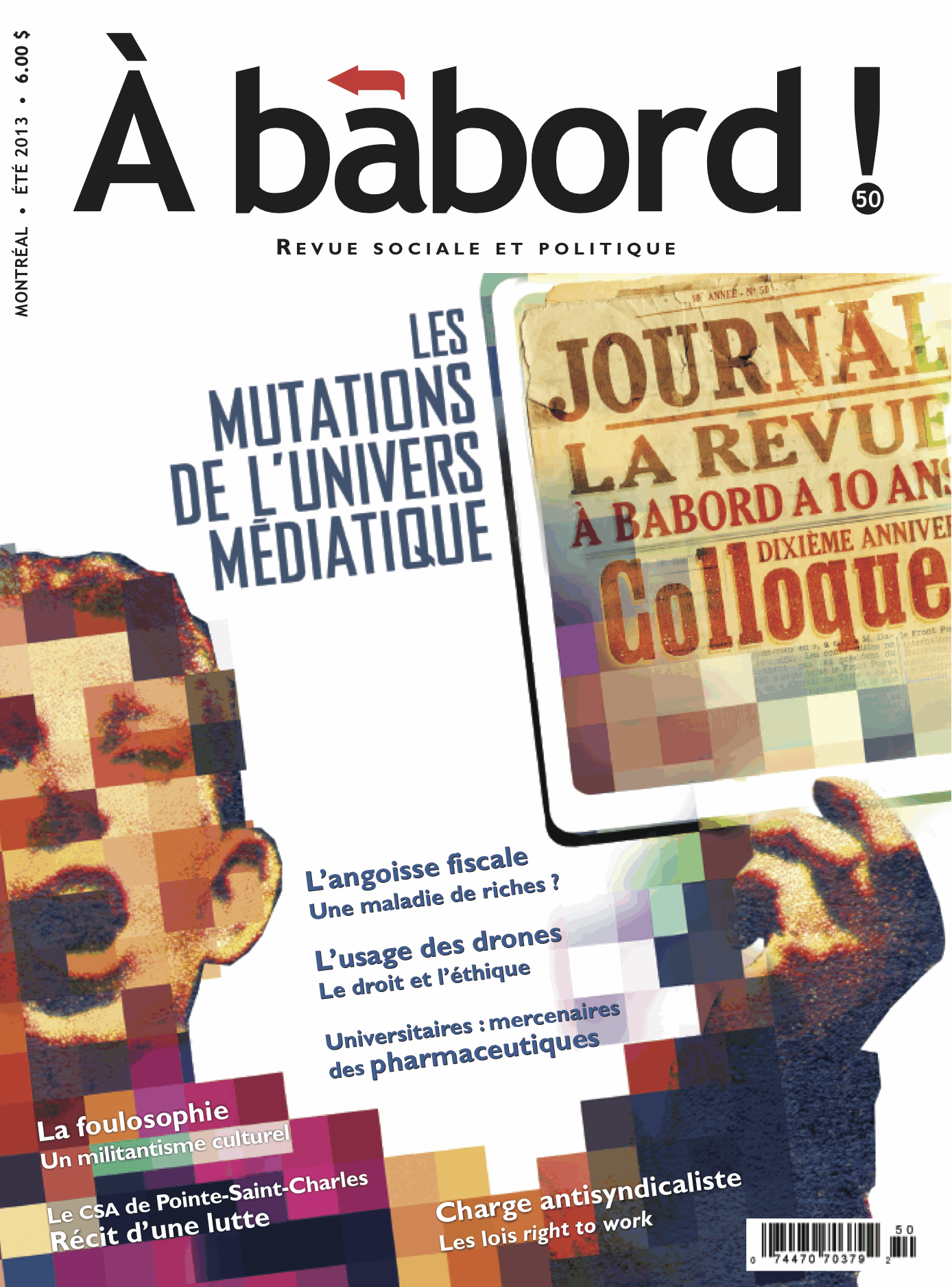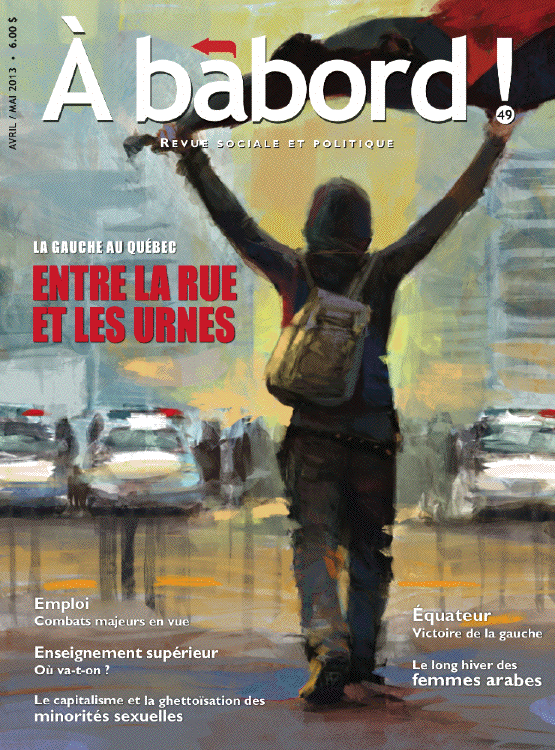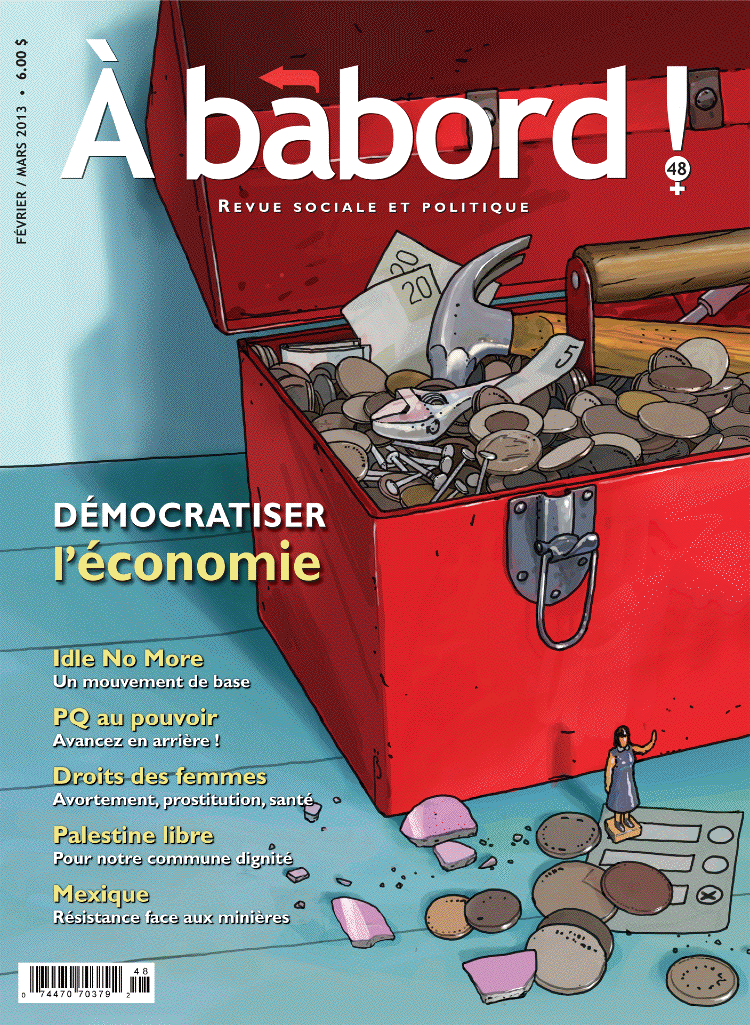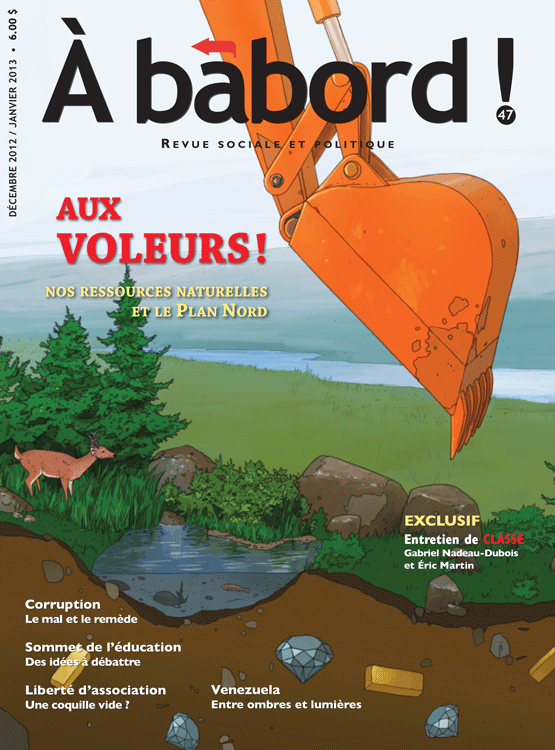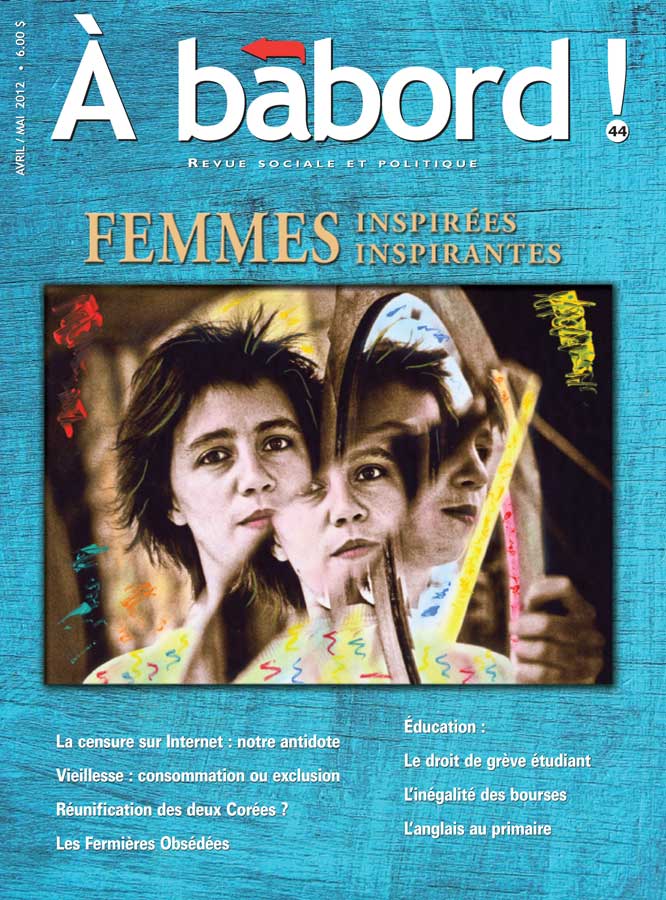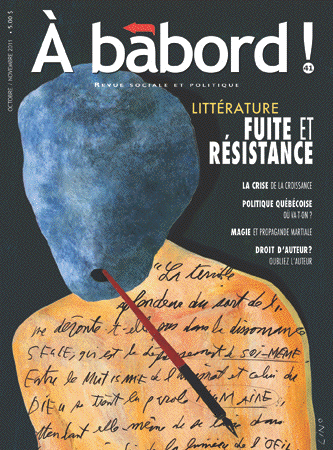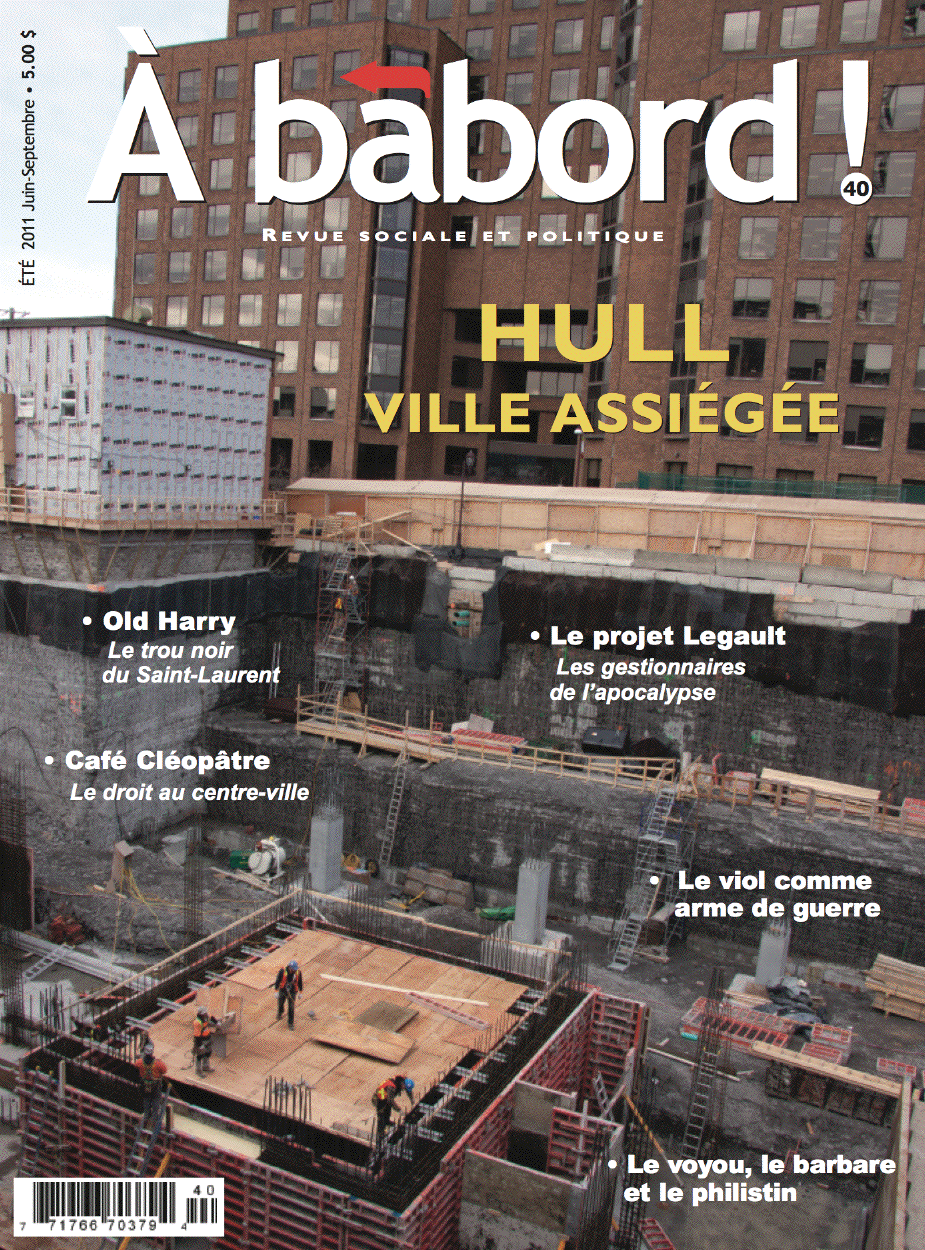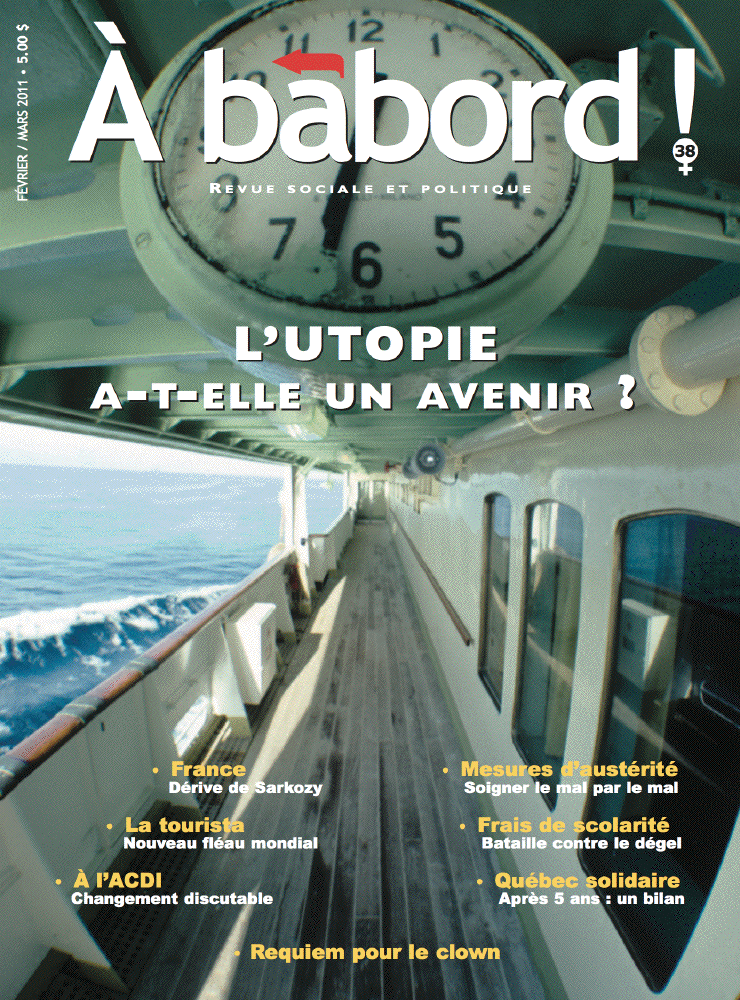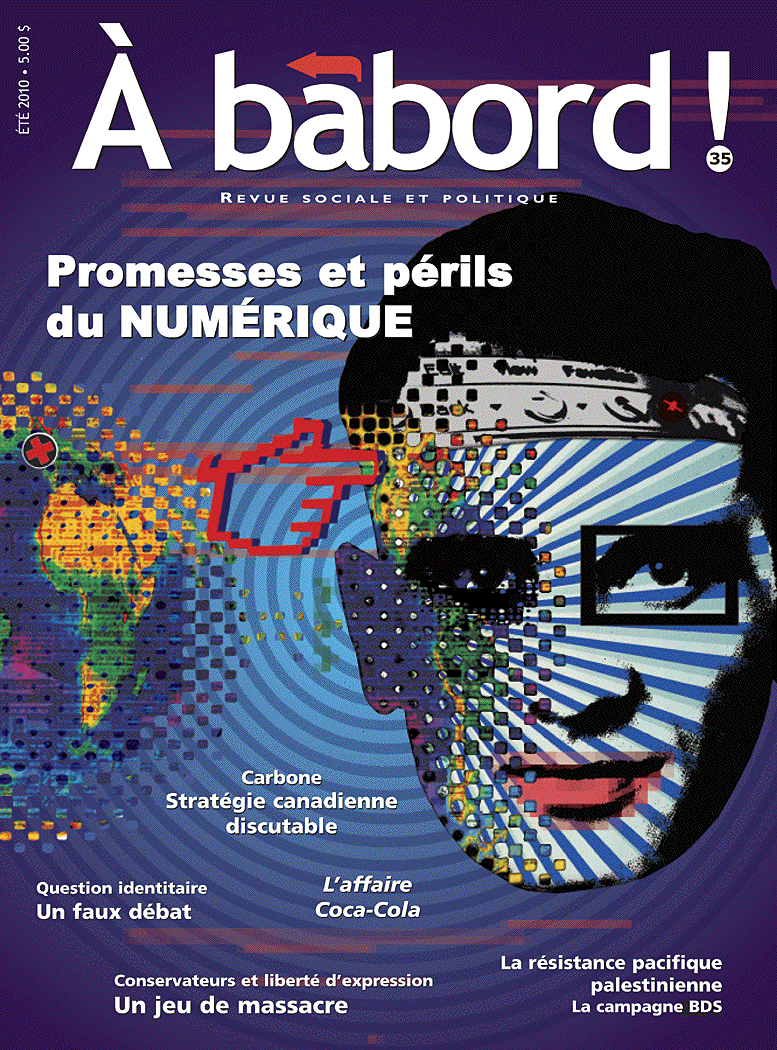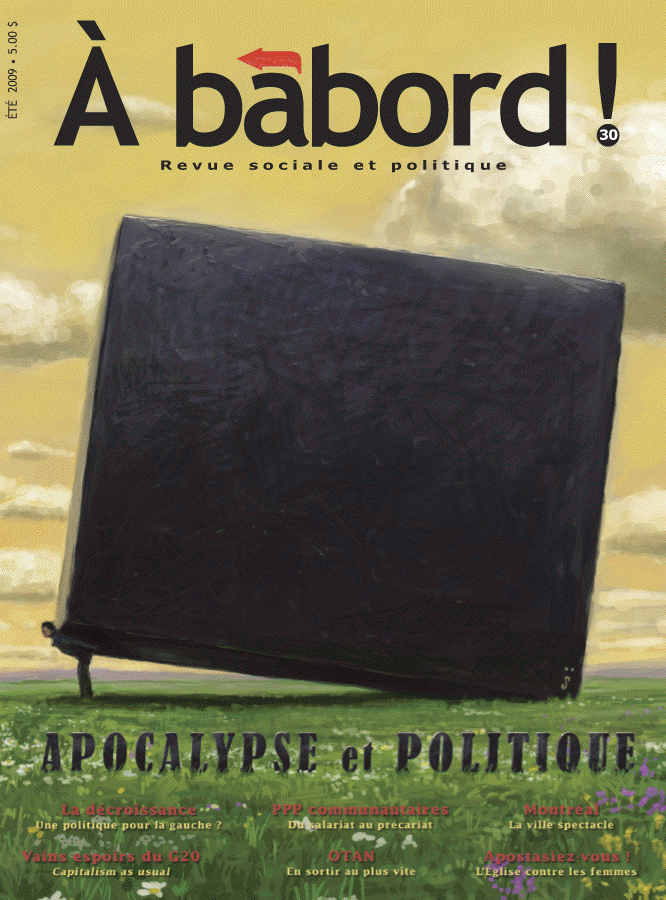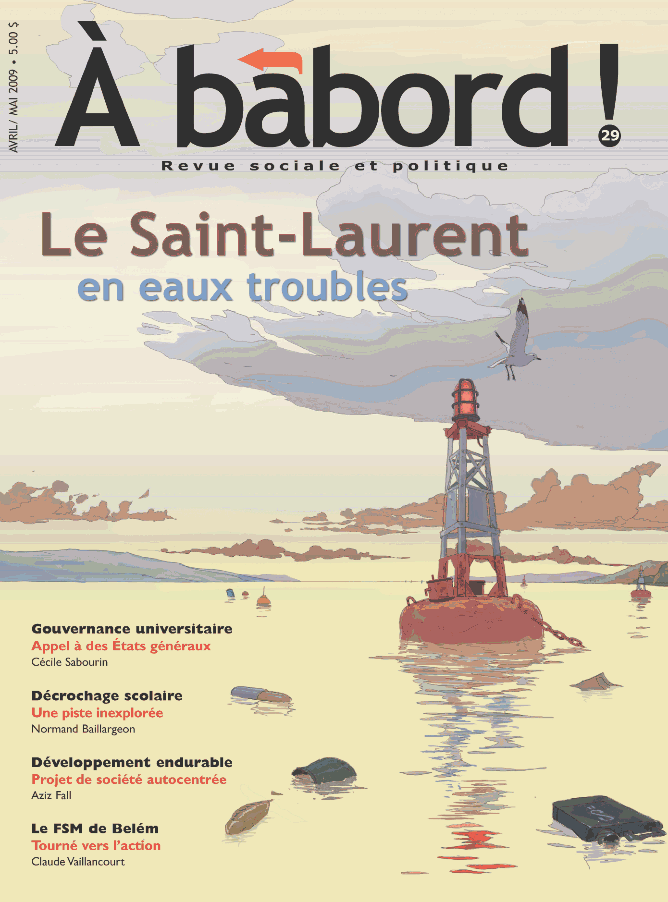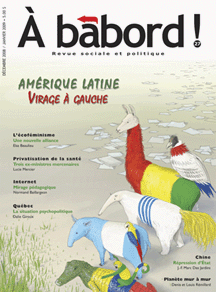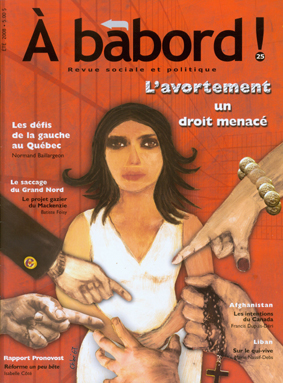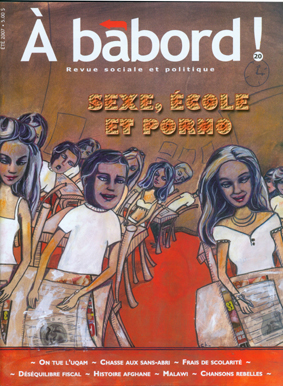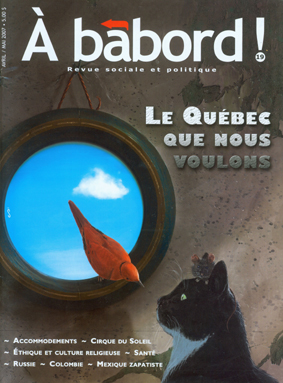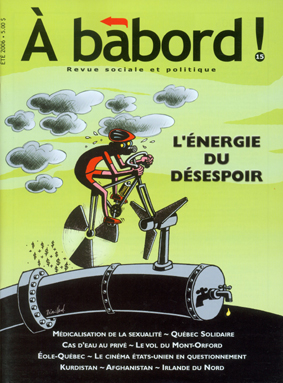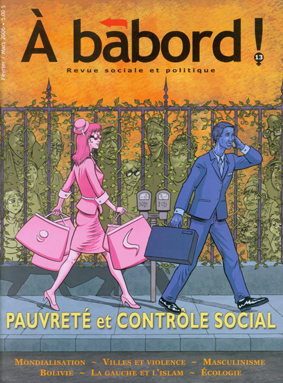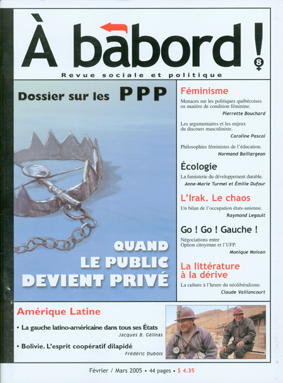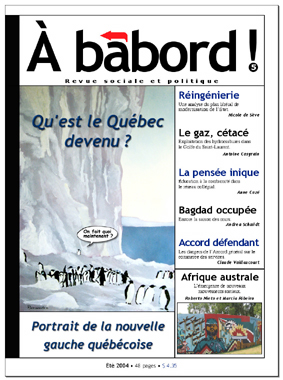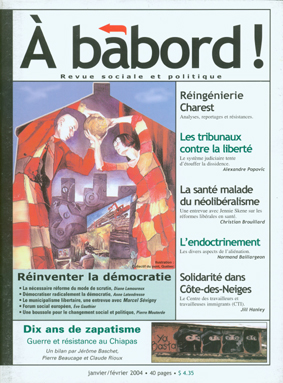La littérature et la vie
Portraits de femmes
Dans leurs livres récemment publiés, Catherine Mavrikakis et Valérie Lefebvre-Faucher esquissent des portraits de femmes on ne peut plus contrastés. La première décrit la condition d’une femme de la petite bourgeoisie dont le destin se déroule sous le signe d’un ennui profond, de nature quasi ontologique. La seconde évoque celui des femmes de la maison Marx, marqué par la lutte, aspect longtemps négligé par les historiographes de la famille au profit de la célèbre figure paternelle.
Dans La ballade d’Ali Baba [1], Catherine Mavrikakis avait évoqué, sur le mode fictionnel, la figure du Père sous les traits d’un aventurier, d’un personnage fantasque, extravagant, amoureux des femmes et de la vie, mais foncièrement irresponsable, en particulier à l’égard de ses proches, conjointe allégrement trompée et enfants négligés. Dans L’absente de tous bouquets [2], c’est la figure de la Mère délaissée qui est cette fois au cœur d’un récit « vrai », du témoignage d’une narratrice qui est aussi la fille de la personne récemment en allée.
Le travail du deuil
Le travail de deuil emprunte donc la voie du chant funèbre, porté par un dédoublement de la voix narrative. Une première voix, identifiée en italiques dans le texte, s’offre comme une adresse, une interpellation directe de la mère, dont elle instruit d’une certaine manière le procès. La seconde, légèrement décalée, se présente comme un commentaire autoréflexif sur l’apostrophe qui la précède, lui apportant des nuances qui atténuent souvent le caractère tranché des jugements premiers. C’est ainsi que dans ce « journal de deuil », le portrait de la mère se transforme insensiblement en autoportrait de la fille consciente de « réinventer » celle-ci pour en savoir quelque chose, et donc d’en représenter une facette, forcément subjective.
Le portrait se déploie d’une manière pointilliste, par touches successives, marquées par un incident ou un trait de caractère, révélateurs d’une identité fuyante, insaisissable au premier abord tant cette femme paraît avoir vécu hors du monde. Confinée dans sa maison, dans sa chambre, puis à son lit king size sur lequel elle passe une large partie de ses journées, l’œil tourné vers une télé toujours allumée, elle rumine des pensées et des désirs qui demeurent des virtualités, plongée dans un état de « dépression infinie » qui sera son lot jusqu’à sa disparition pour cause de vieillesse.
La vie comme fatalité
L’évocation de la fille est implacable. D’origine française, venue s’établir au Canada, et plus précisément à Montréal dans les années 1950, Denise Marchand, devenue madame Mavrikakis, ne cessera d’entretenir une nostalgie insatiable pour son pays d’origine, et surtout pour Paris dont elle conserve une image idéalisée : celui d’une société régie par des codes et des rites stables, des manières de parler et de faire qui en font une culture irremplaçable. Elle en cherche des prolongements qui ne peuvent être que des succédanés décevants dans une société américanisée, profondément différente, à laquelle elle demeure réfractaire et étrangère, contrairement à ses enfants qui y construiront leur présent et leur avenir.

Ce qui caractérise et distingue le mieux cette femme c’est l’absence, un rapport problématique, pour ne pas dire inexistant au monde et à soi. Absence à l’amour auquel elle ne croit guère et auquel elle renonce très tôt. Absence aux enfants et à leur univers de contes et de magie qui occupe à ses yeux désillusionnés une trop grande place au détriment de la sienne propre. Absence au dehors, aux paysages qui la laissent indifférente. Absence à l’art et particulièrement à la littérature, dont la fille croit qu’elle aurait pu « sauver » sa mère par le regard critique qu’elle incline à porter sur le monde. Absence de passion propre, si ce n’est de manière fugace pour le piano sur lequel elle se laisse aller à jouer en de rares moments de grâce.
Cultiver son jardin
Pour reprendre la formule lapidaire de la fille narratrice, cette femme « n’aimait rien, sauf les fleurs coupées » promises à une mort prochaine, préférées aux fleurs vivantes d’un jardin qu’elle ne cultivait pas, premier et ultime reproche que lui adresse vivement sa fille, prisonnière d’un « présent infini » qui la garde dans un « ennui fondamental que rien ne peut divertir » dont sa fille craint d’avoir malheureusement hérité. Ce qui la rassure un peu, et c’est là-dessus que le récit se boucle, c’est d’avoir réussi elle-même à cultiver son jardin et aussi, ajoute-t-elle avec un clin d’œil complice à ses lecteur·trice·s, celui des autres.
Entrepris sur le mode du réquisitoire, le récit fait place en cours de narration à une certaine complicité entre la mère et la fille. Convaincue au départ de n’avoir jamais reçu la « moindre affection » par une mère dont la « dureté » envers elle a été « exemplaire », la fille constate qu’elle est devenue également sévère pour elle-même et pour autrui. Elle observe de même qu’elle est aussi portée par une conception pessimiste du monde, qui lui paraît voué au néant, et qu’elle est d’une certaine manière, bien qu’à un degré moindre, une sorte de double de cette figure repoussée : « Je suis ta sœur, ta semblable, note-t-elle avec un certain effarement, une mortelle qui trouvera elle aussi sa propre absence au monde ».
Ce rapprochement, cette complicité improbable, émerge au fil de la narration et du travail de deuil et aboutit à une certaine réconciliation fondée sur la constatation que cet anti-modèle qu’est la mère porte aussi un héritage à assumer dans sa négativité comme dans sa positivité. La chaîne de la filiation, rompue dans la dénégation, se renoue in fine dans une certaine reconnaissance, problématique mais réelle, à laquelle il est bien difficile d’échapper totalement, pour le meilleur comme pour le pire. C’est le contenu de vérité du très beau récit en forme de tombeau que nous offre Catherine Mavrikakis.
Promenade sur Marx
C’est dans un tout autre univers que nous entraîne Valérie Lefebvre-Faucher, une autre planète qui est celle de la famille et de la maison Marx, dont elle reconstitue des figures généralement laissées dans l’ombre : celles de la conjointe et de la mère des filles du grand homme, toutes reléguées, les filles comme la mère, au second plan, sinon totalement ignorées, au profit de la figure hypostasiée du grand Karl et, à un degré moindre, de celle de son complice le plus célèbre, Friedrich Engels.
Ce micro-livre [3] (dans les petits pots, les meilleurs onguents ?) est présenté d’emblée comme une « enquête », mais ajoute immédiatement l’auteure, qui « me révèle autant que les Marx ». Enquête parce qu’il s’agit de reconstituer la cartographie d’un domaine, l’arbre généalogique d’une famille élargie et son fonctionnement. Révélation de soi dans la mesure où le parcours, loin des codes et des rites académiques et de leur structure linéaire, épouse le rythme d’une « promeneuse bizarre » se baladant en toute liberté.

Un livre est une route, écrit-elle, une promenade que l’on peut faire seule, en « s’adressant à Dieu ou à la postérité », ou accompagnée par des ami·e·s qui sont ici des compagne·on·s de classe et des militant·e·s avec lesquel·le·s on échange explicitement ou implicitement. C’est à ces ami·e·s qui ont inspiré ou contribué à son essai que celui-ci est dédicacé, ce qui en fait jusqu’à un certain point une œuvre collective.
Une famille de combattantes
Dans son introduction, après avoir rendu brièvement hommage à des figures de femmes contemporaines, jugées capitales, Suzanne Césaire et Mireille Neptune Anglade, notre promeneuse fixe d’abord son attention sur Jenny Marx, conjointe de Karl dont le rôle n’a pas été que domestique, consacré à l’entretien du grand homme. Davantage qu’une simple épouse ou encore qu’une secrétaire dévouée, elle apparaît comme une véritable interlocutrice avec laquelle il échange et débat.

On peut en dire autant et davantage de ses filles. Laura, par exemple, deviendra la conjointe de Paul Lafargue – représentant d’un courant libertaire qui s’exprimera dans son fameux Droit à la paresse –, sera la traductrice du Manifeste du parti communiste en français et jouera un rôle important dans la diffusion des œuvres de Karl Marx en France. Jenny la fille sera un temps la secrétaire et collaboratrice de son père avant d’être mère de nombreux enfants qui limiteront son implication proprement politique. Quant à Eleanor, la plus jeune, que l’auteure affectionne plus particulièrement, qui la hante à la manière d’un « spectre », elle se révèle la « féministe affirmée » de la famille, celle qui militera incessamment pour la cause des femmes, entre autres comme conférencière au rayonnement international. En dépit de sa « tendance à l’autodestruction » et des contraintes liées à un mariage malheureux, elle se retrouvera dans sa période glorieuse au centre d’un réseau mondial de femmes militantes dont font partie des figures légendaires comme Clara Zetkin et Rosa Luxemburg.
En conclusion de son petit livre, Valérie Lefebvre-Faucher ouvre des pistes qui pourraient se transformer en chantiers et conduire à une autre perception de Marx, permettant de briser son isolement et ce qu’elle appelle sa « statufication ».
Cette opération de renversement, qui redistribue les places et les rangs dans la maison Marx, n’est pas complètement nouvelle : certains commentateurs de l’œuvre et du parcours de ce dernier ont déjà signalé le rôle clef joué par les femmes de sa maison, dont notamment Daniel Bensaïd dans son magistral ouvrage, Passion Karl Marx, les hiéroglyphes de la modernité [4]. Et plusieurs aperçus mériteraient des développements plus soutenus et approfondis. Ce qui est original, c’est l’approche empathique – et sympathique du coup – à l’endroit de son sujet, la familiarité dont elle témoigne qui nous rapproche de personnes éloignées qui, comme par magie, nous deviennent très proches à défaut d’être tout à fait contemporaines. Ce n’est pas un mince mérite.
[1] Catherine Mavrikakis, La ballade d’Ali baba, Montréal, Héliotrope, 2014.
[2] Catherine Mavrikakis, L’absente de tous bouquets, Montréal, Héliotrope, 2020.
[3] Valérie Lefebvre-Faucher, Promenade sur Marx, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2020.
[4] Daniel Bensaïd, Passion Karl Marx, les hiéroglyphes de la modernité, Paris, Éditions Textuel, 2001.