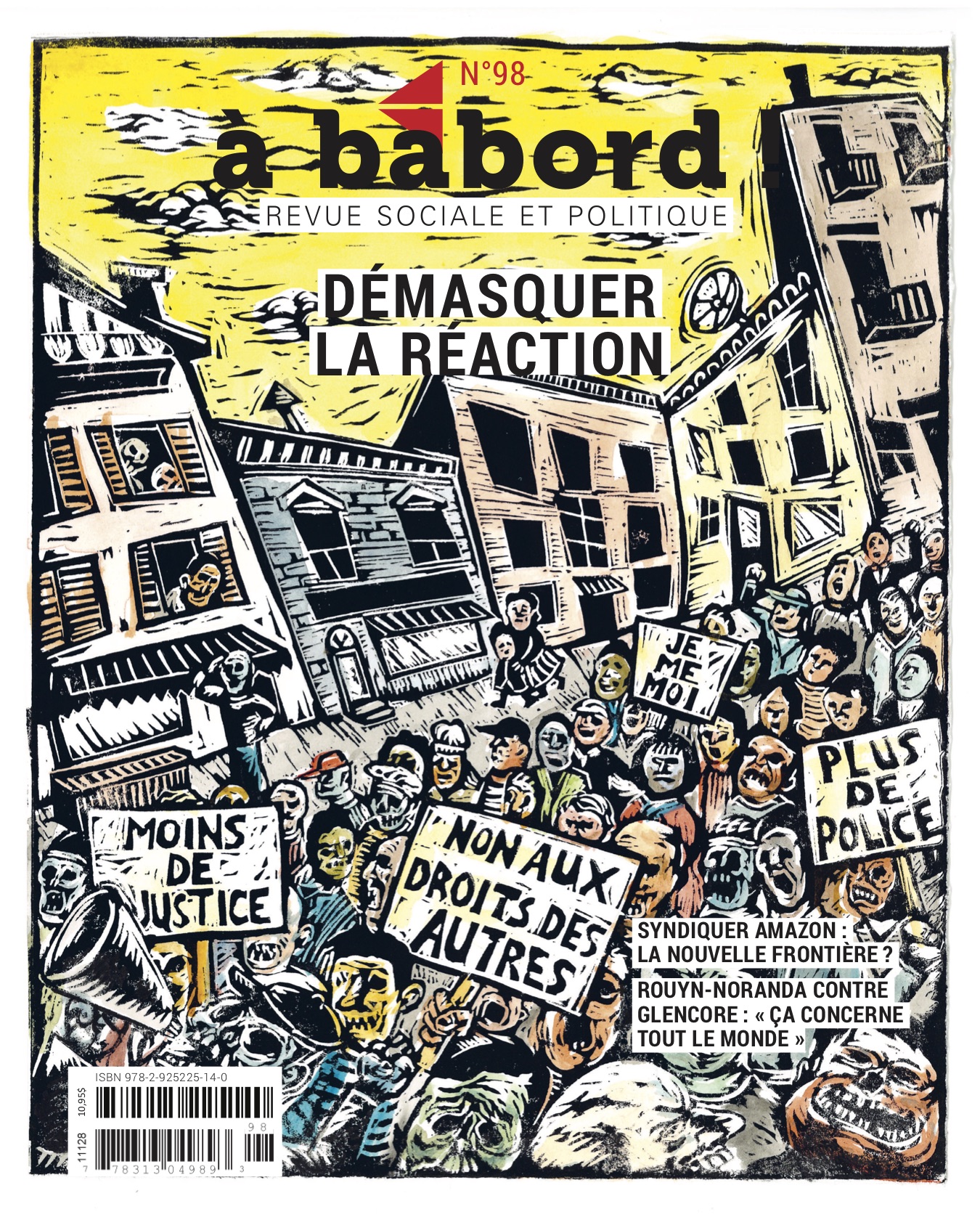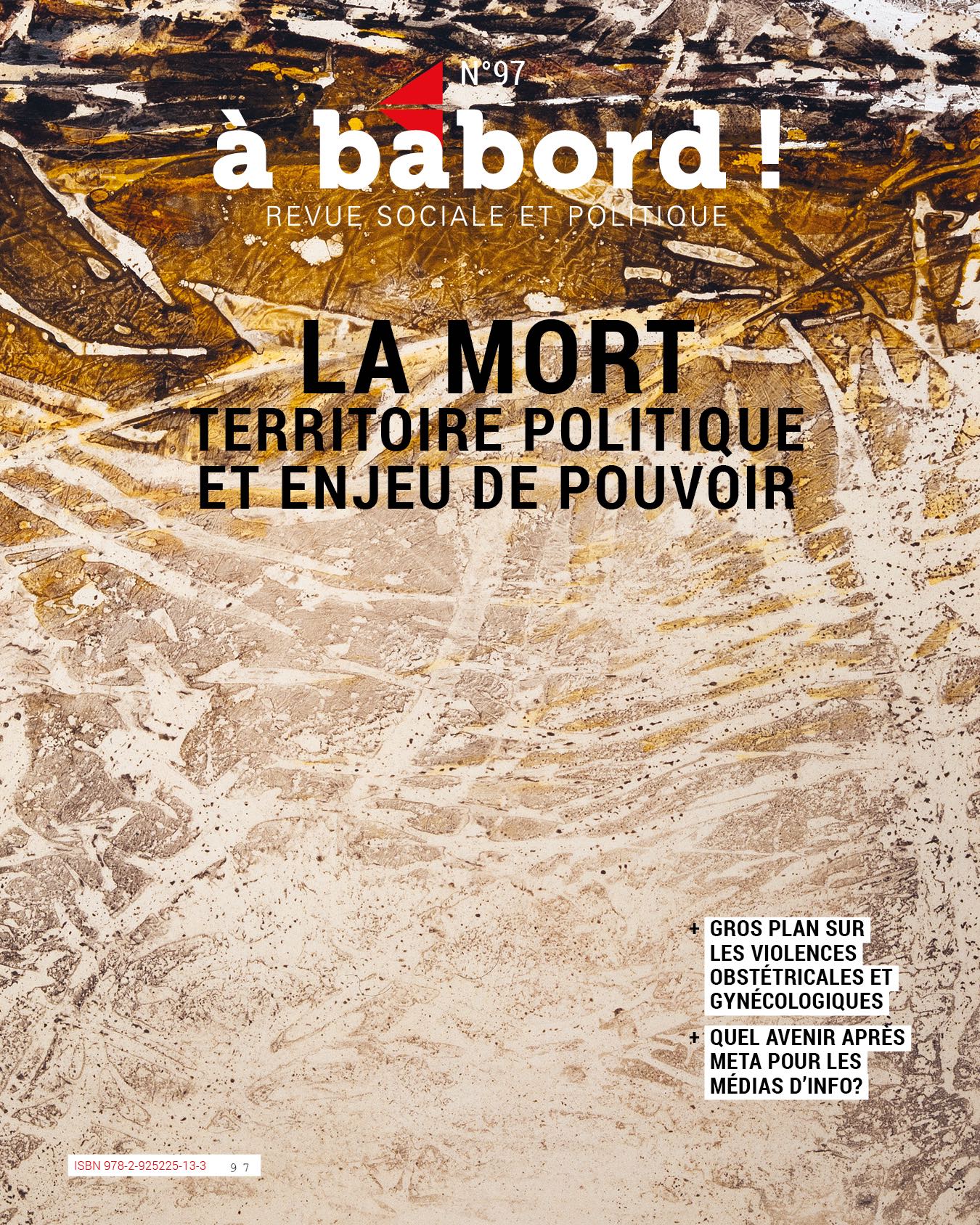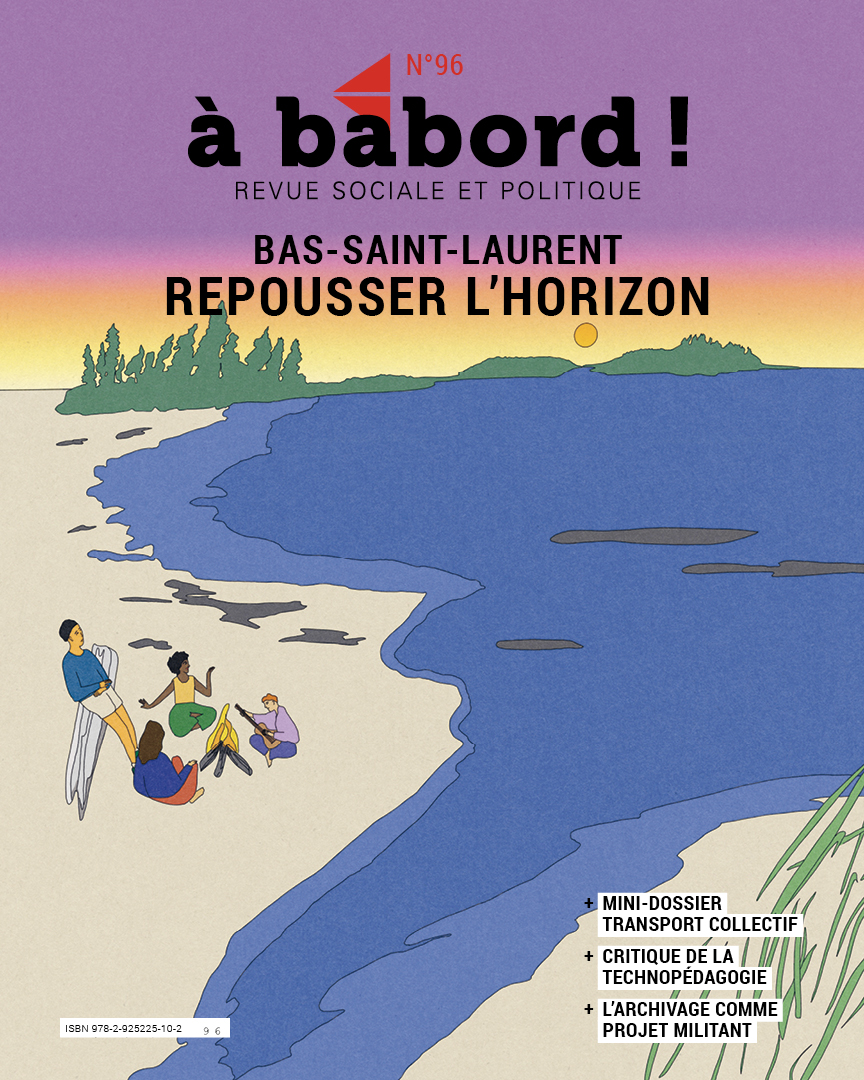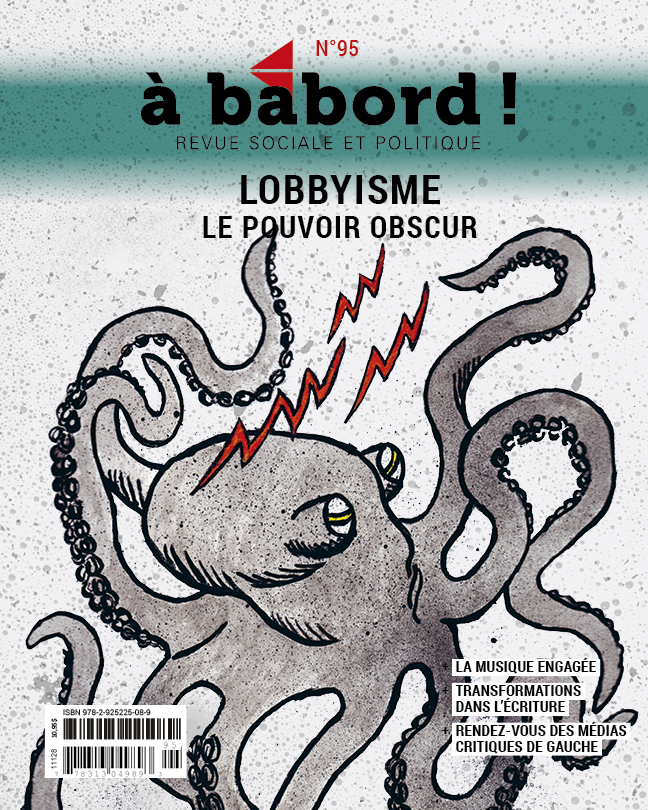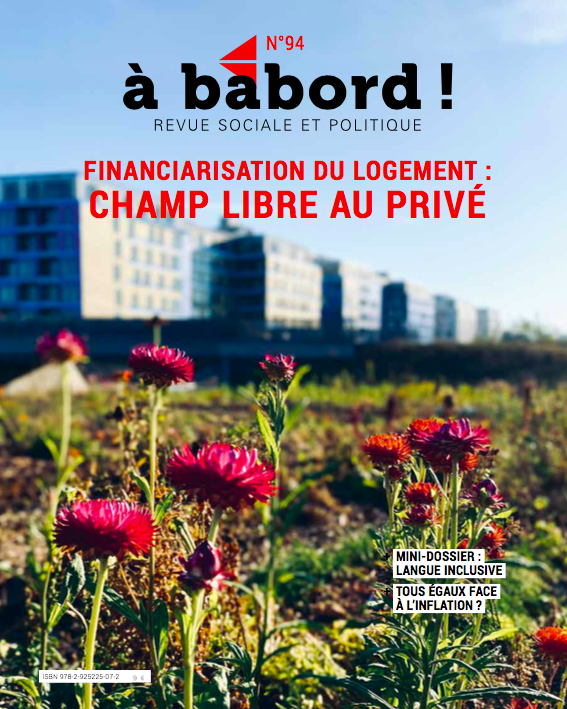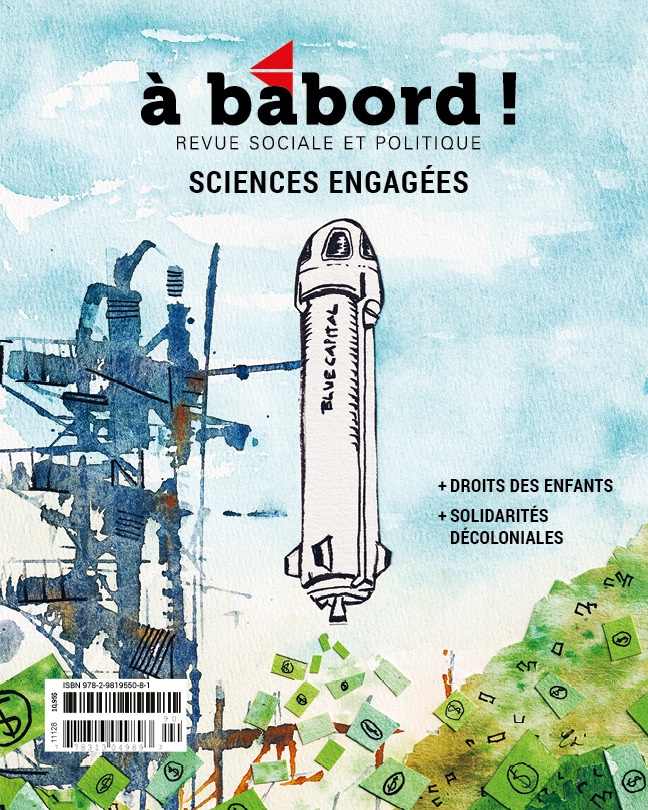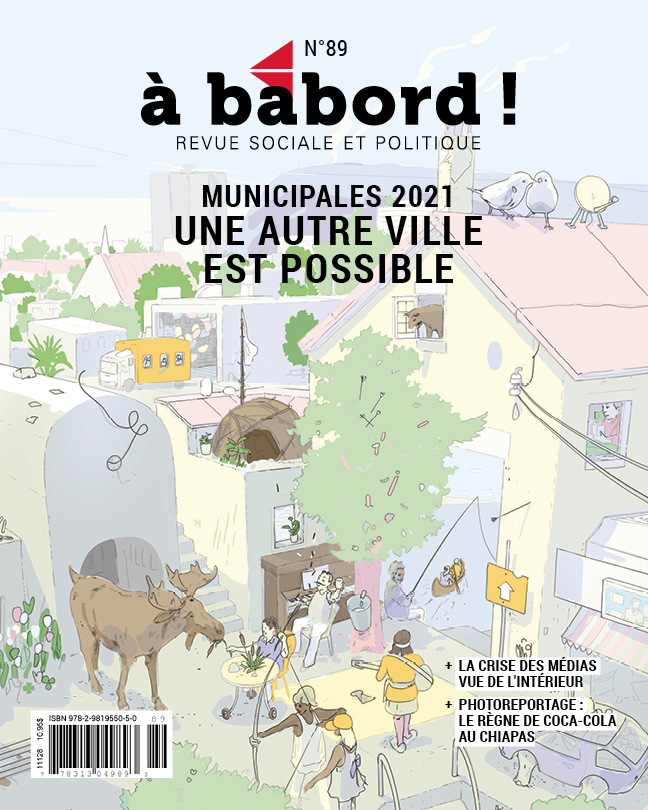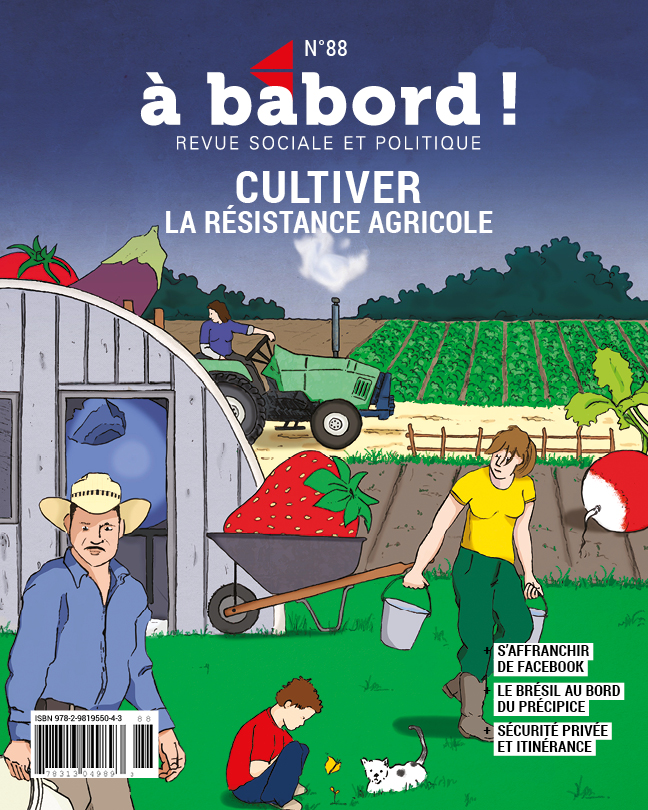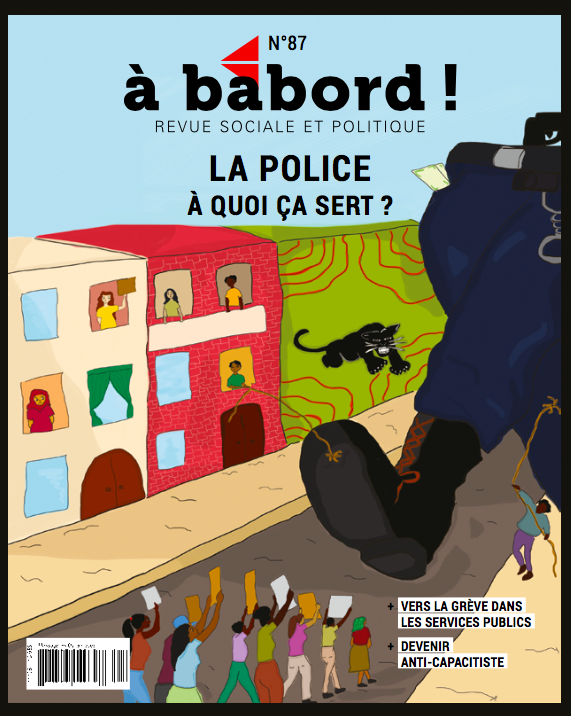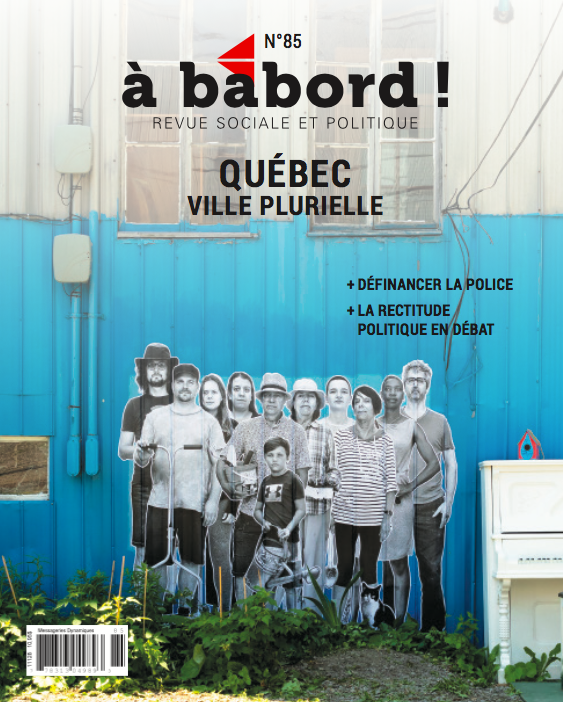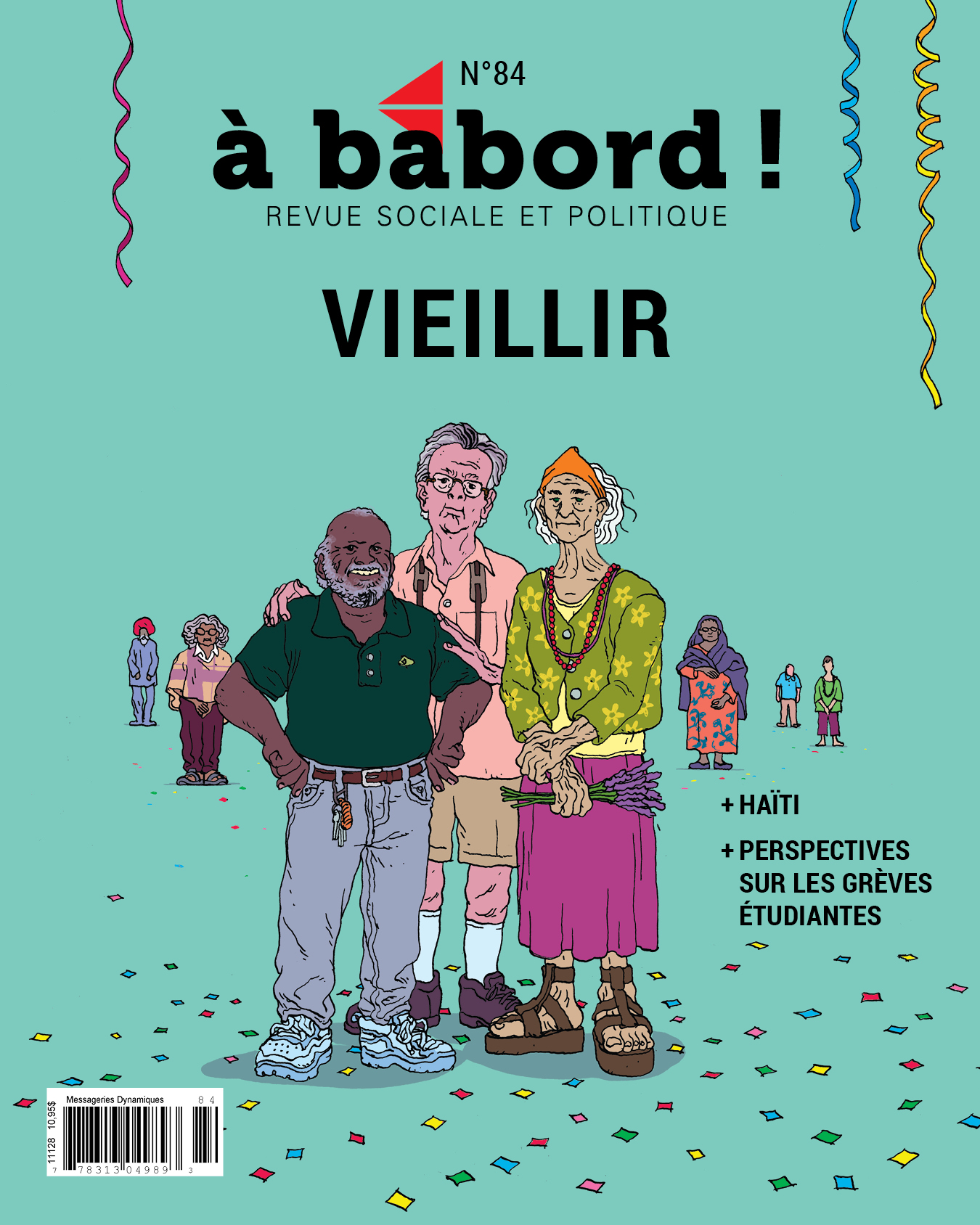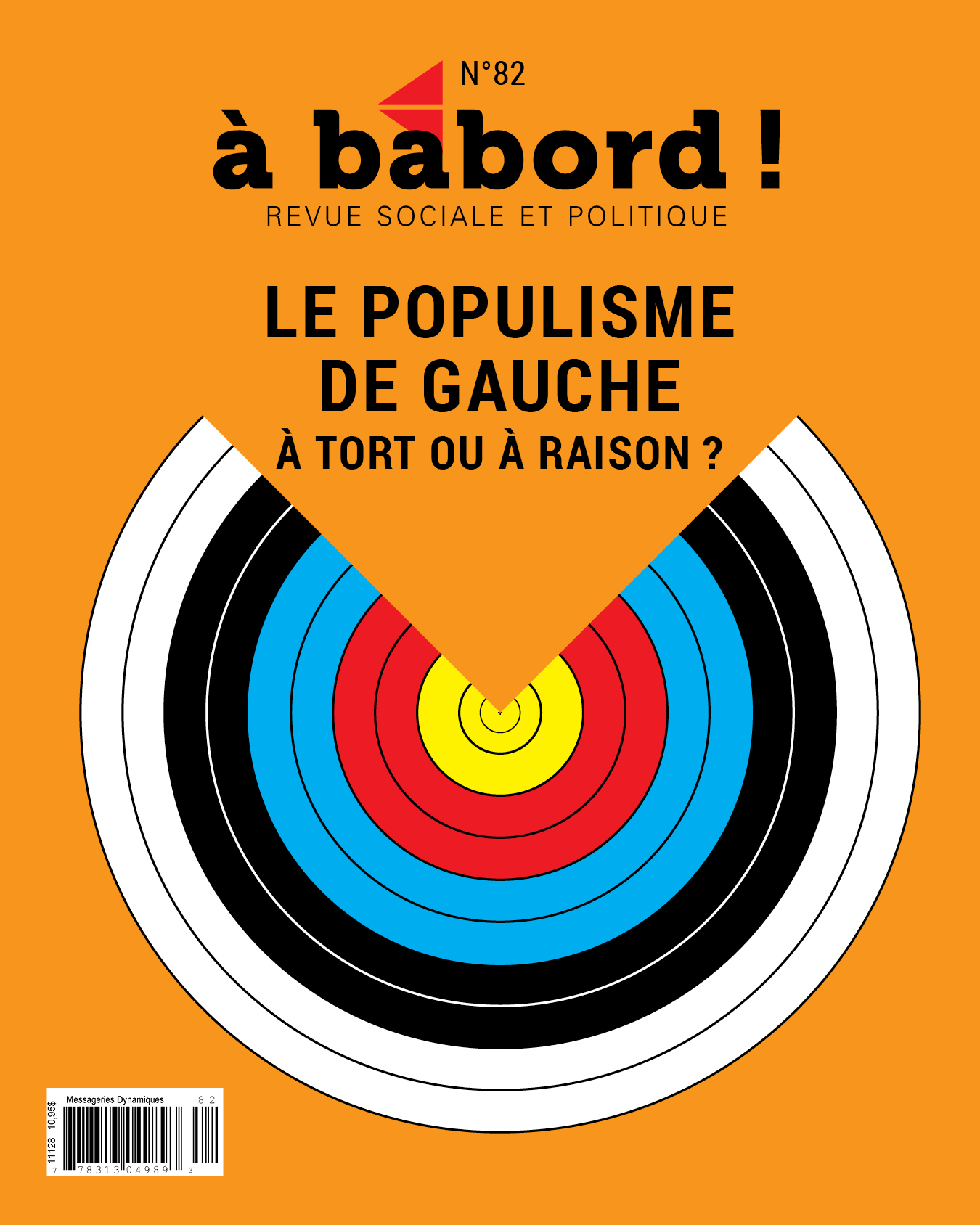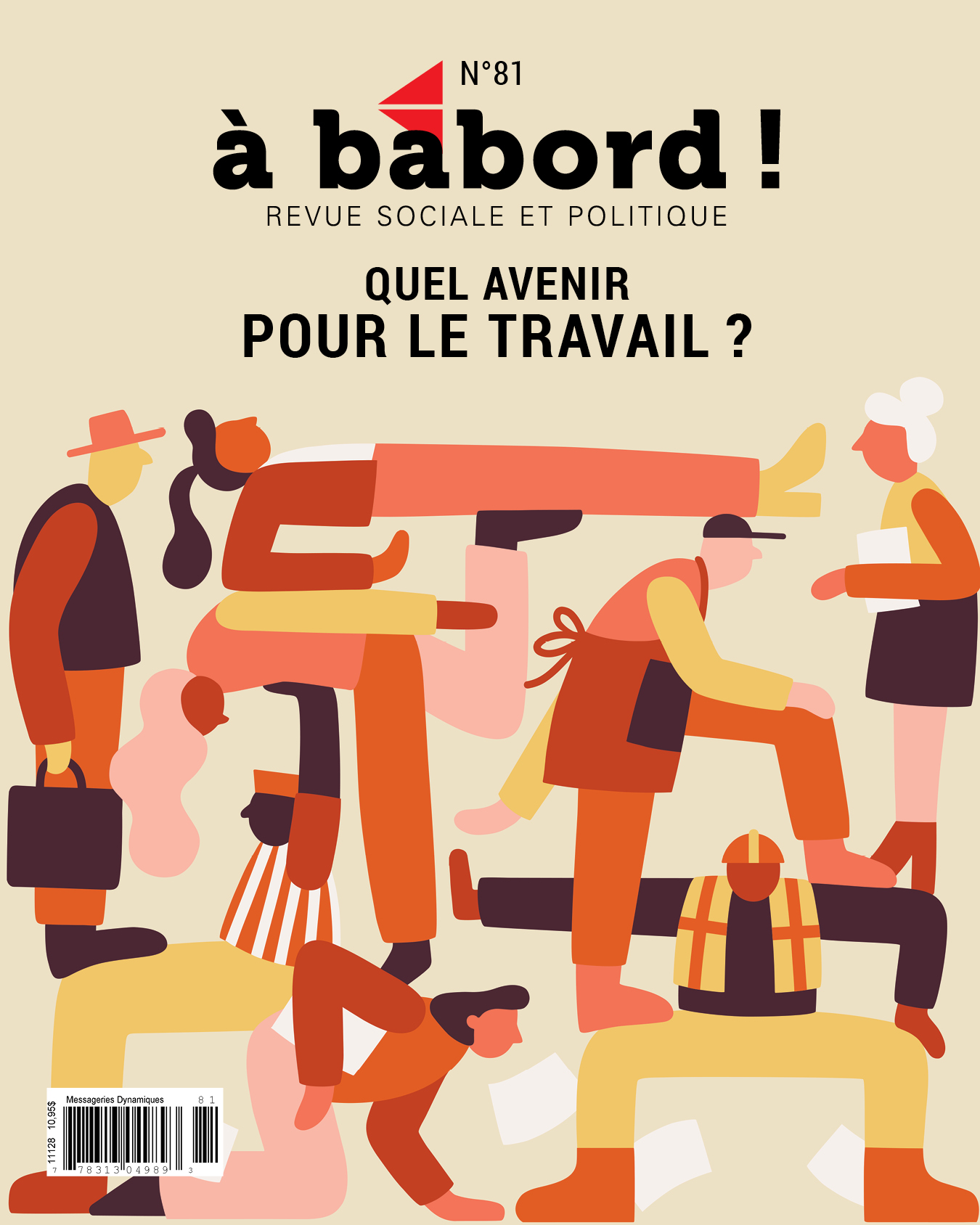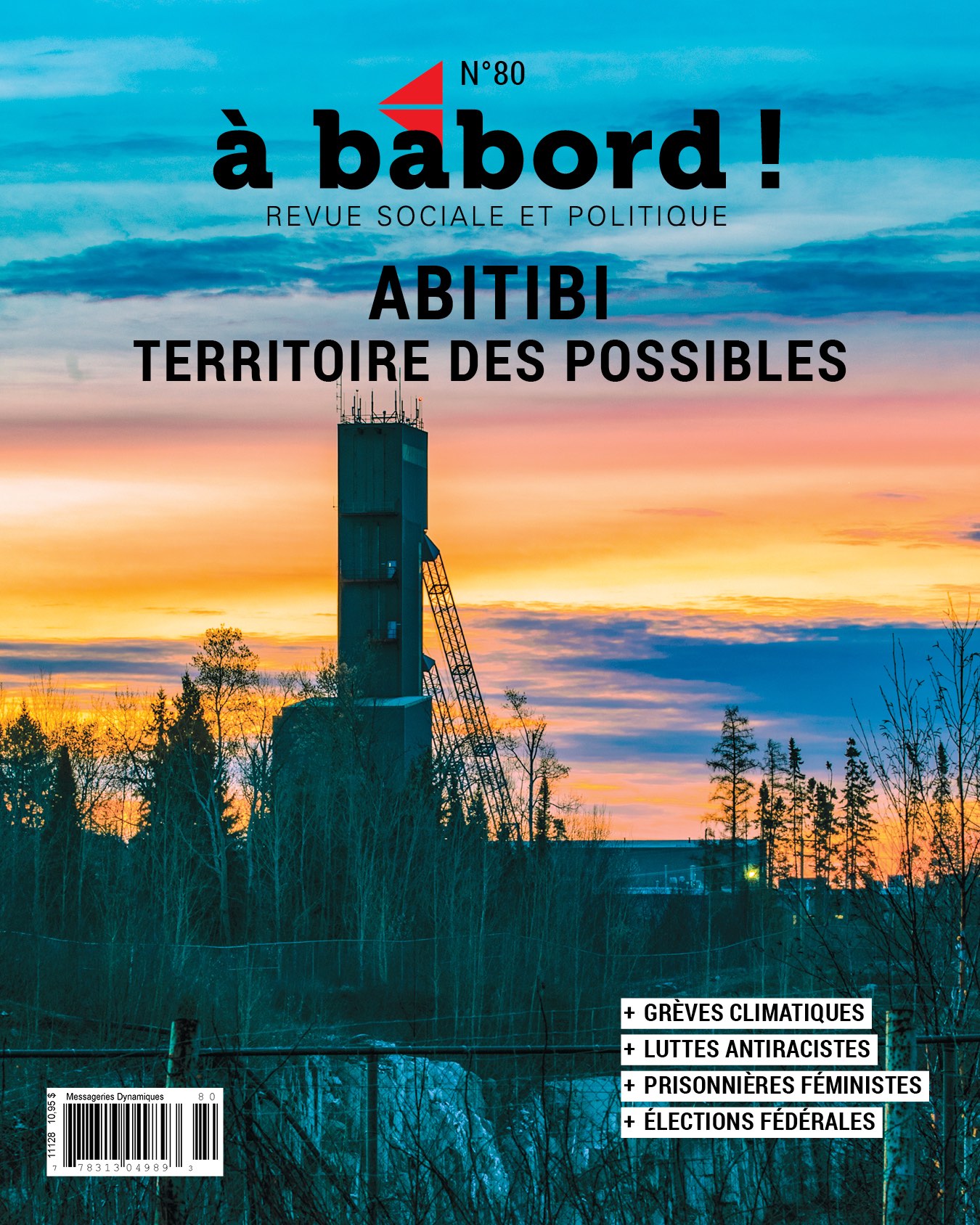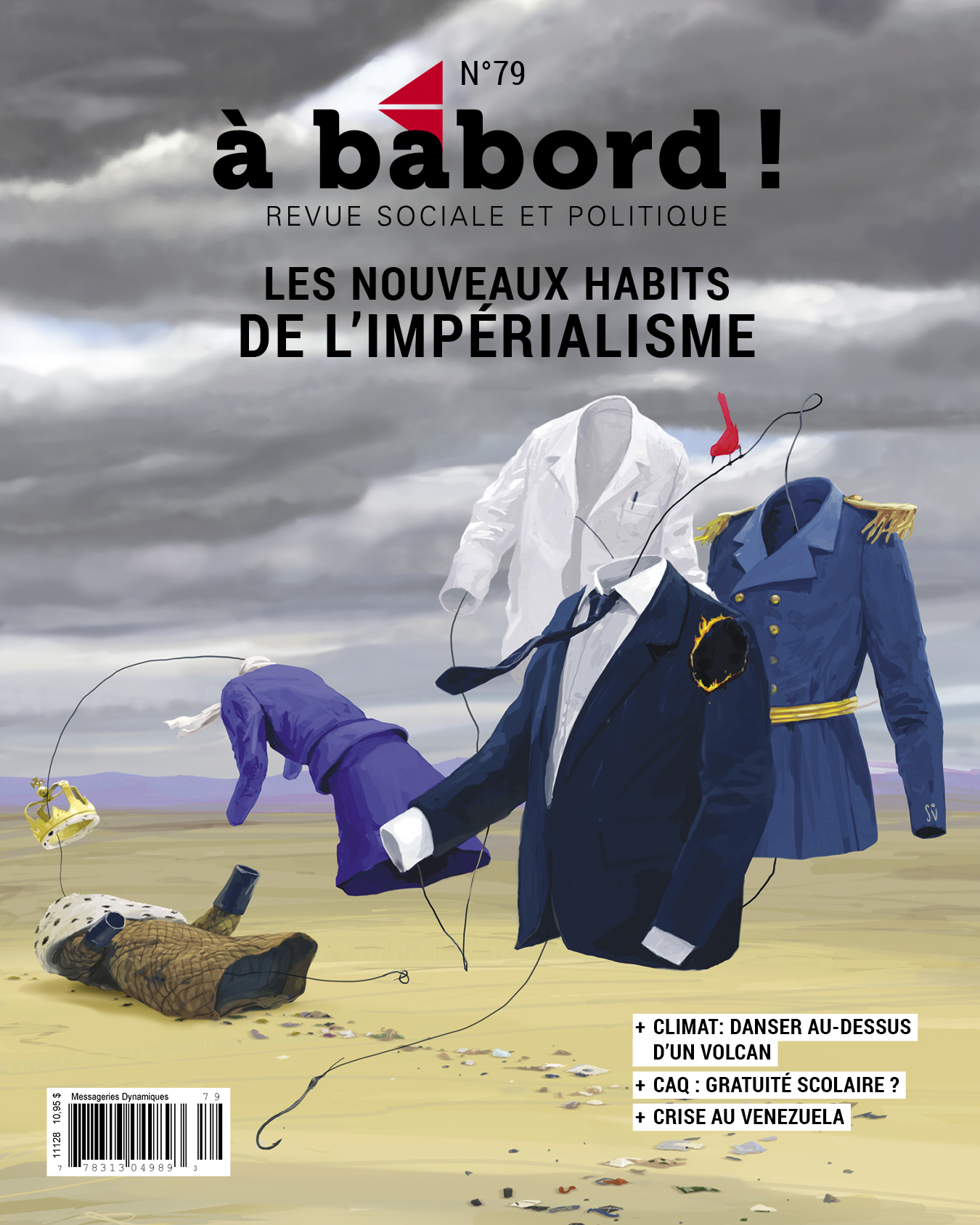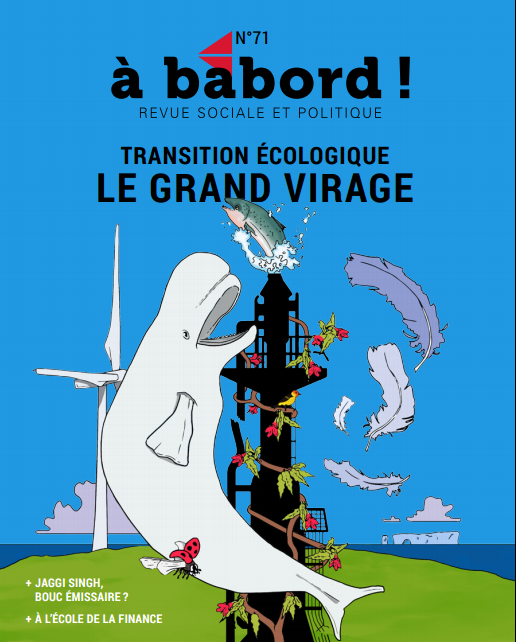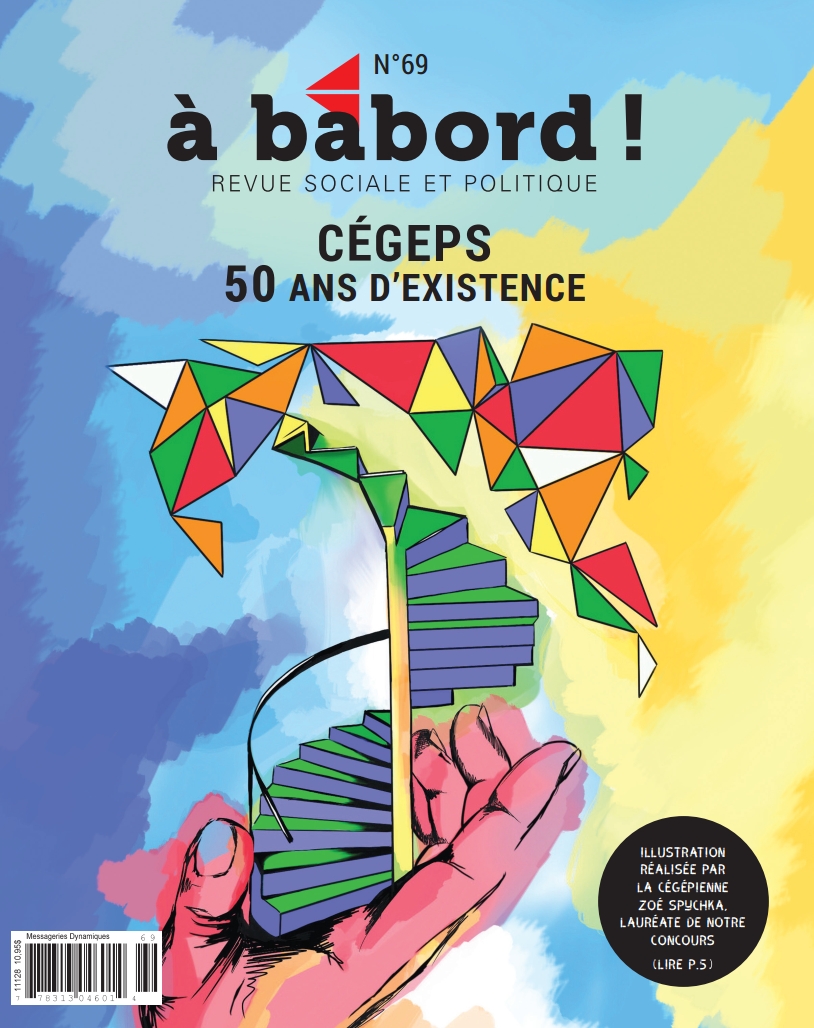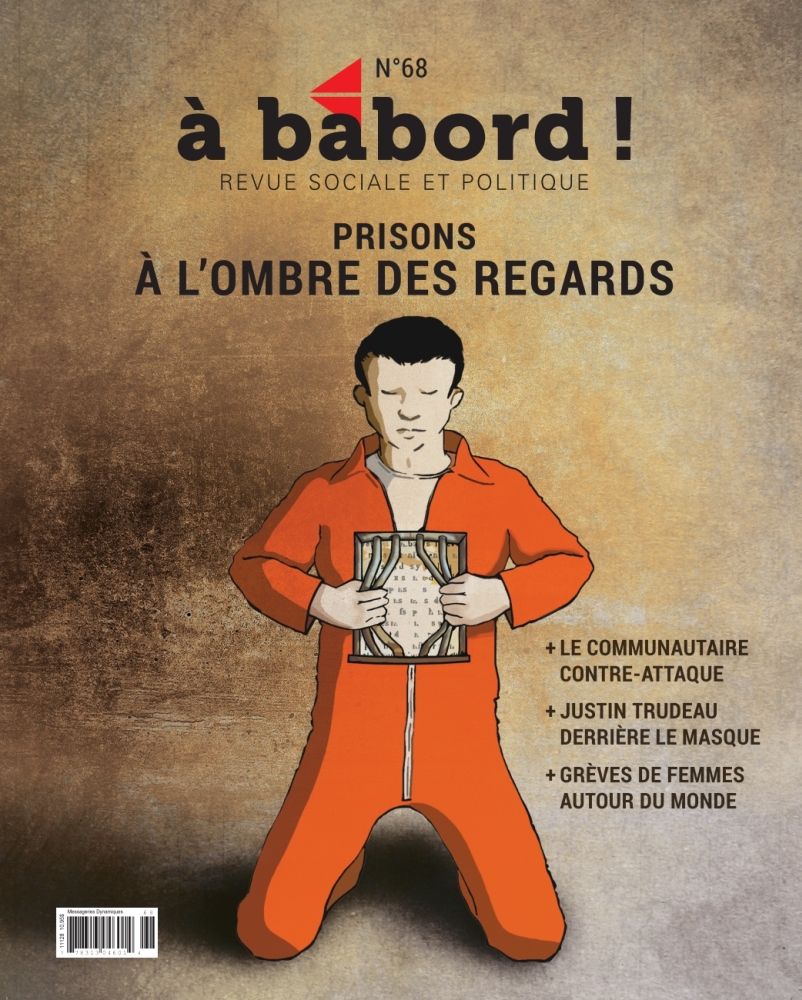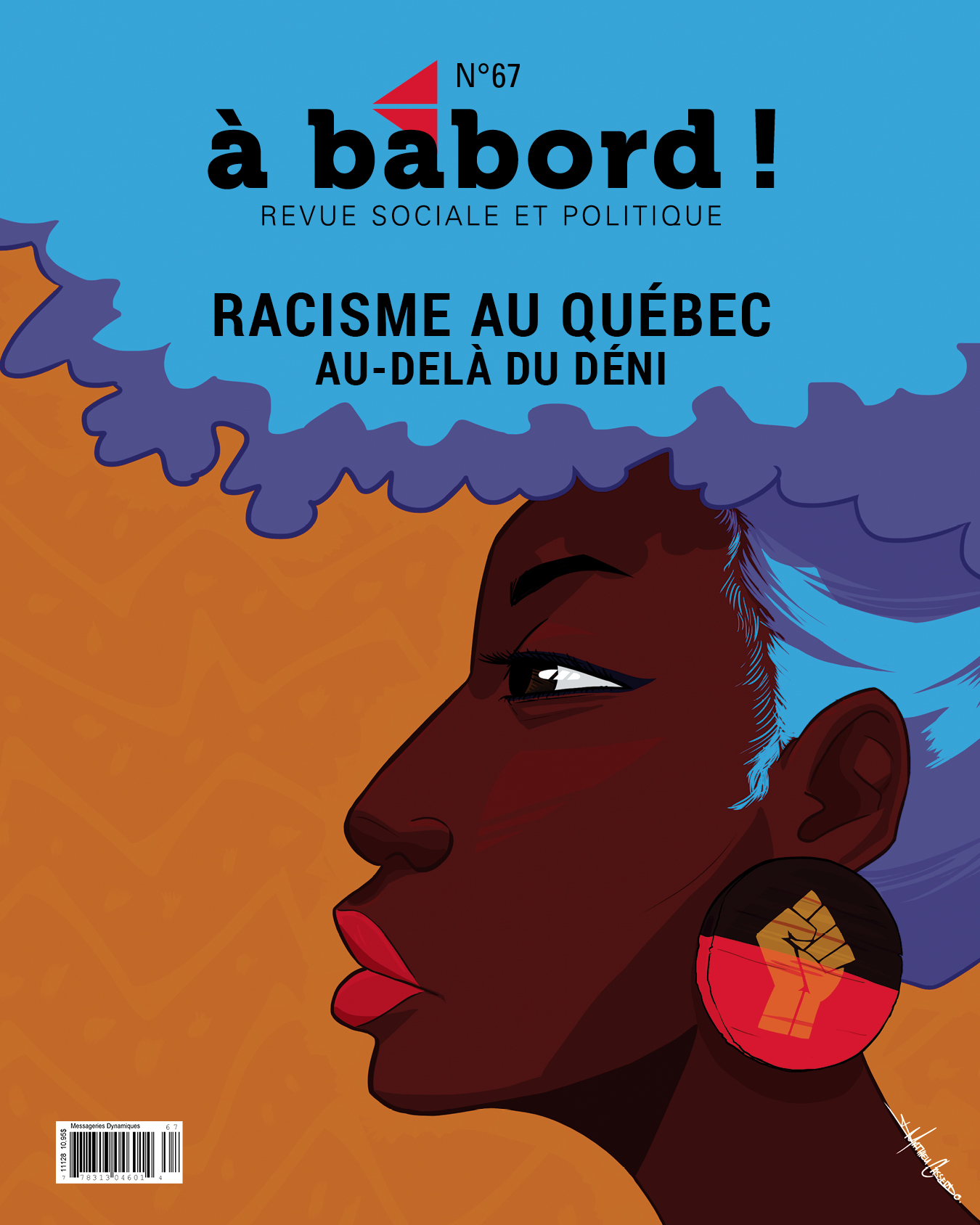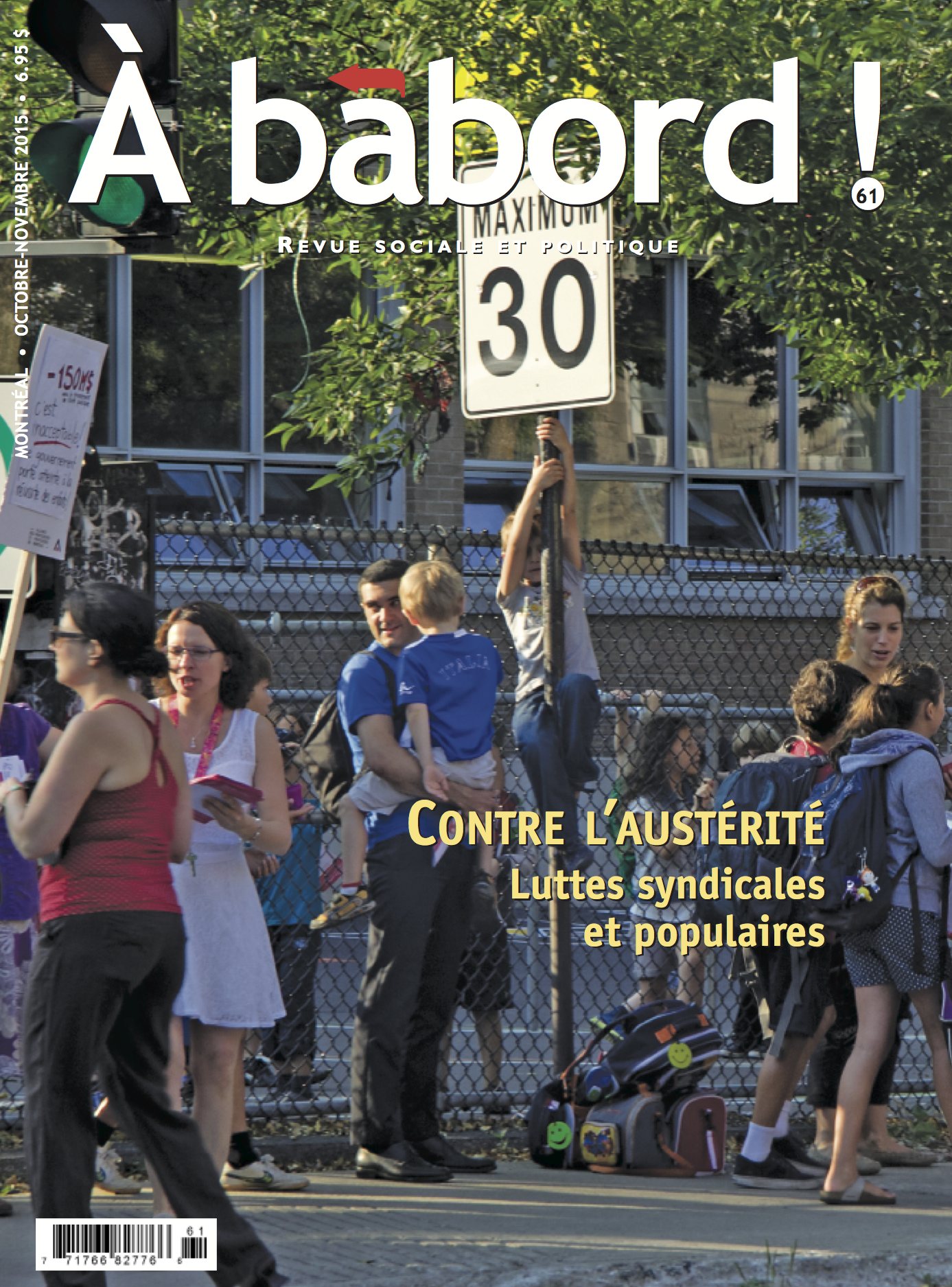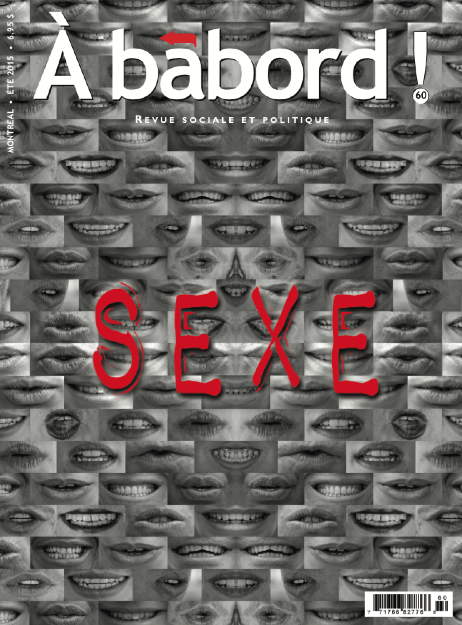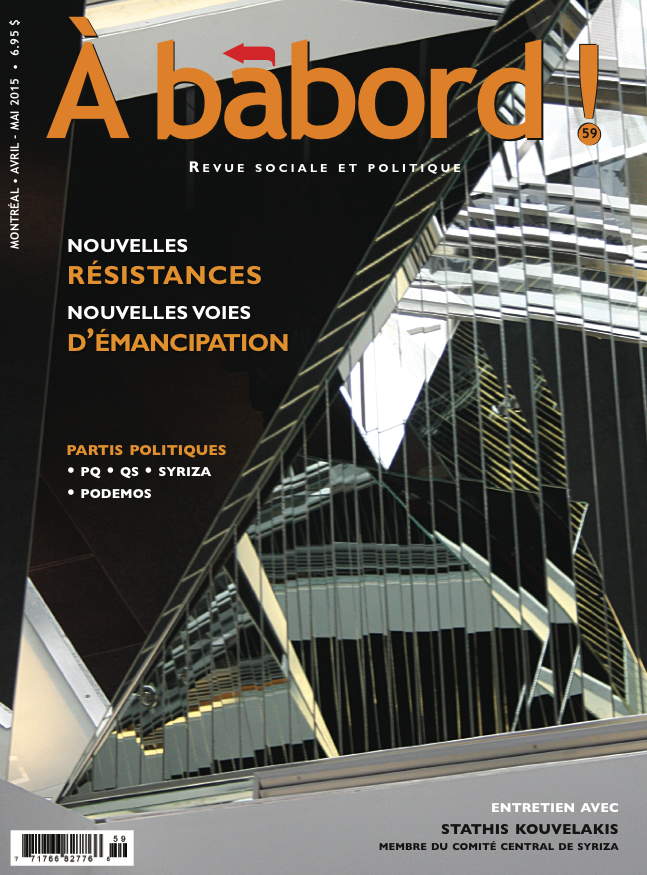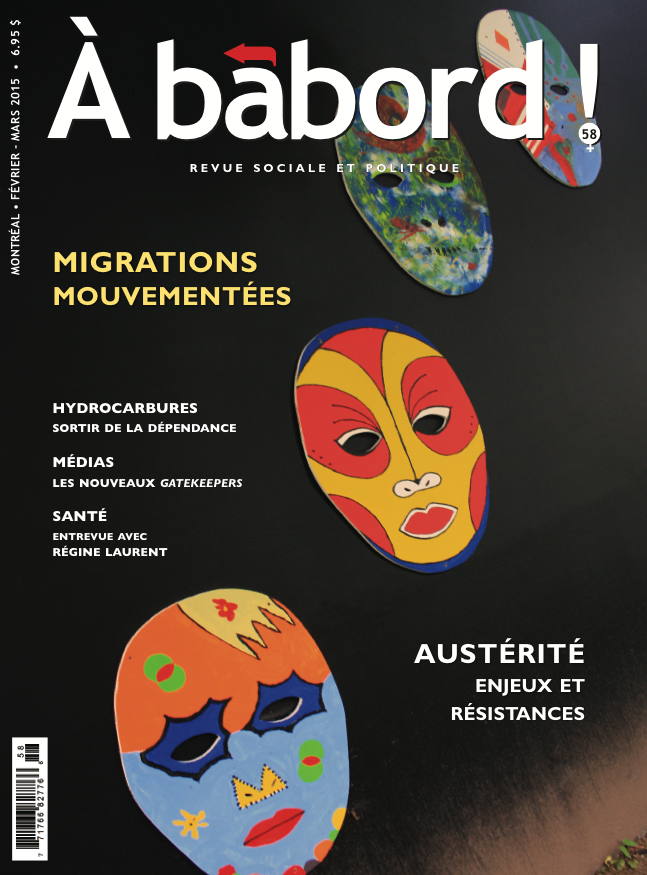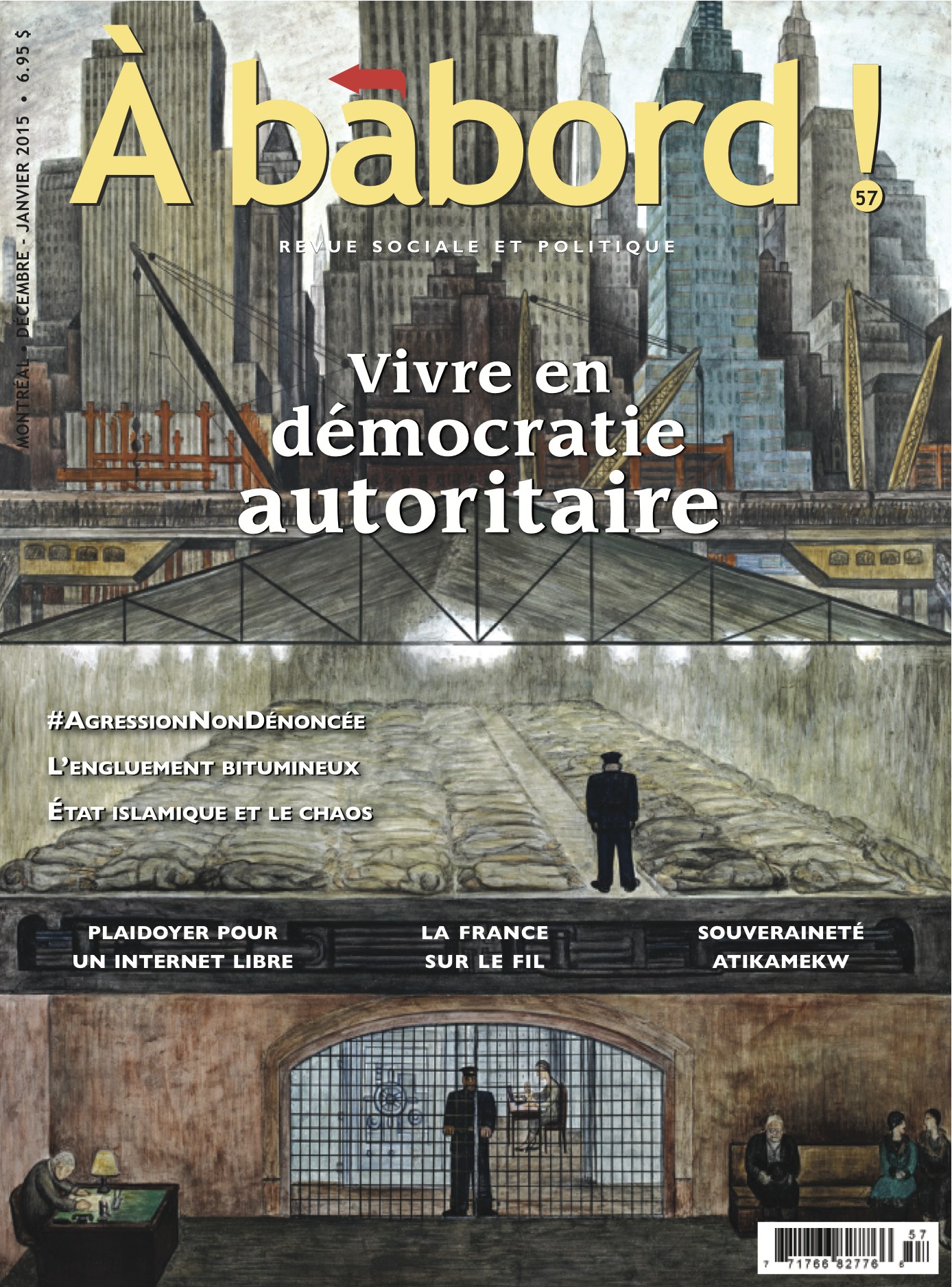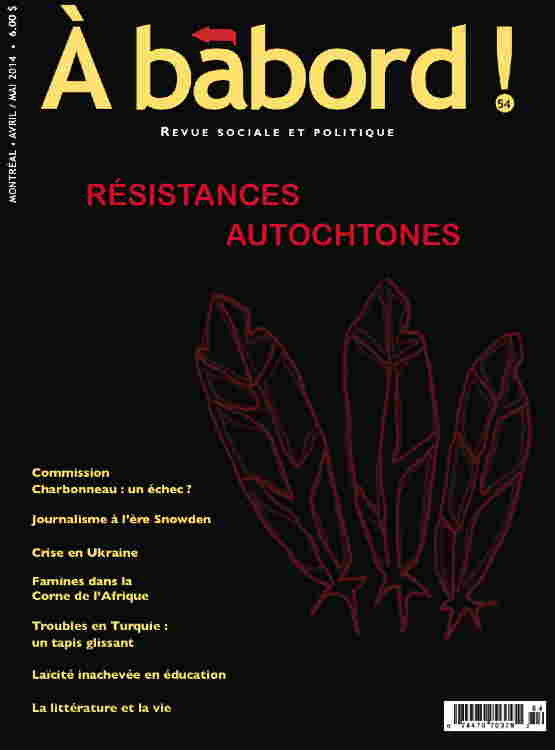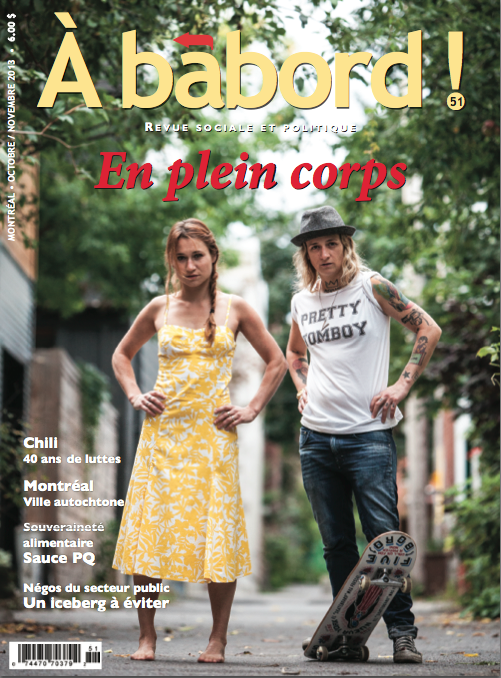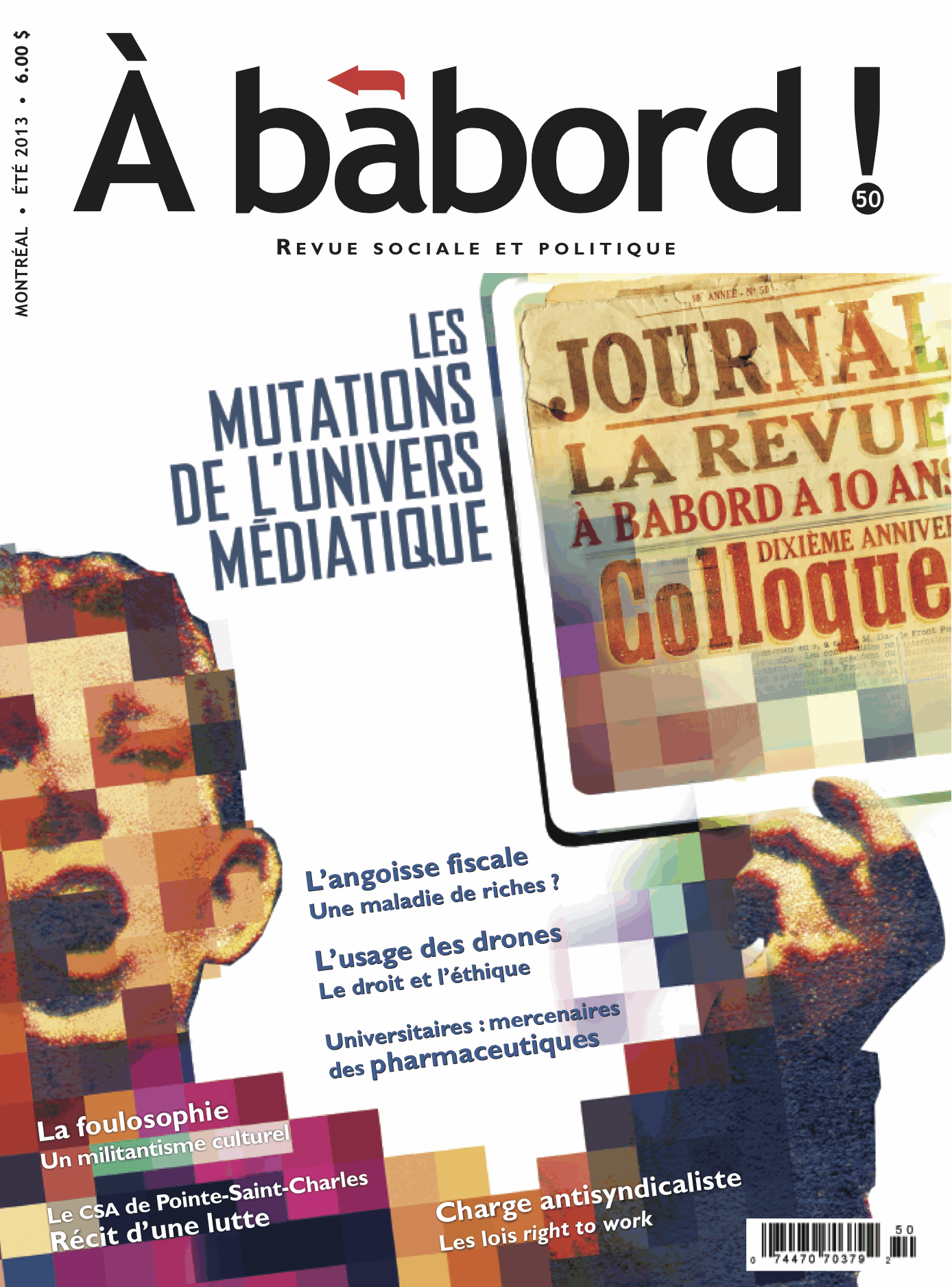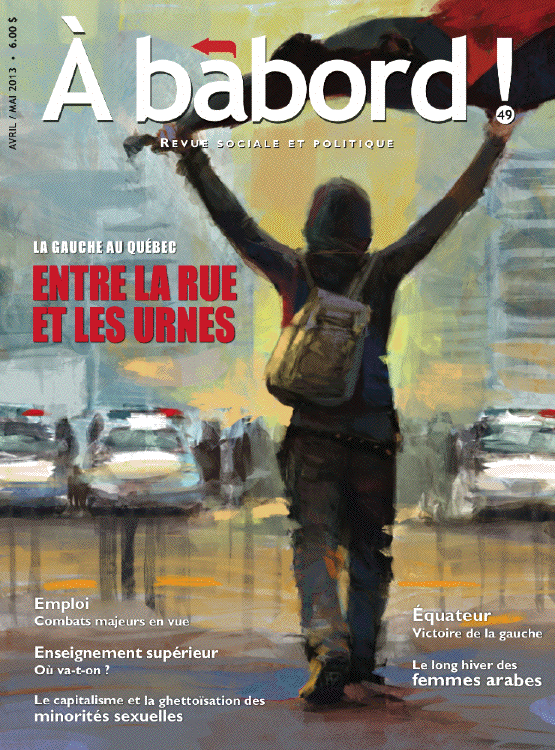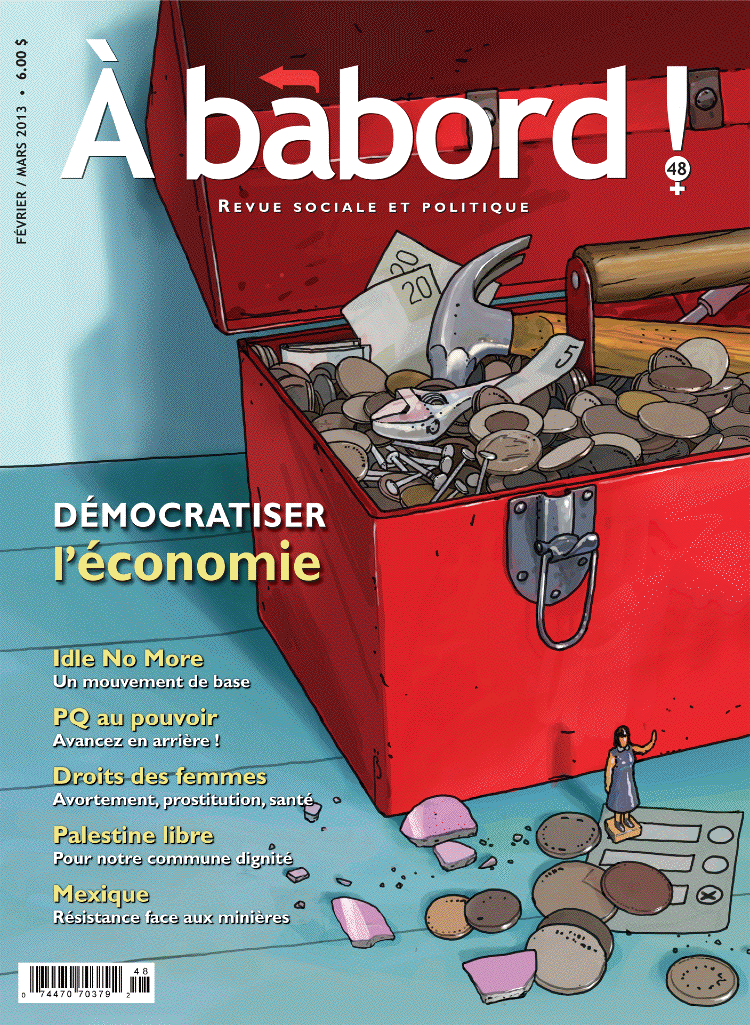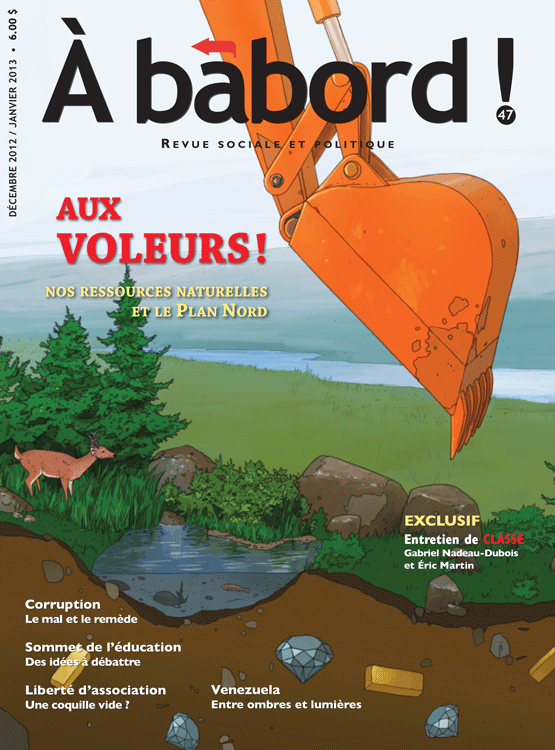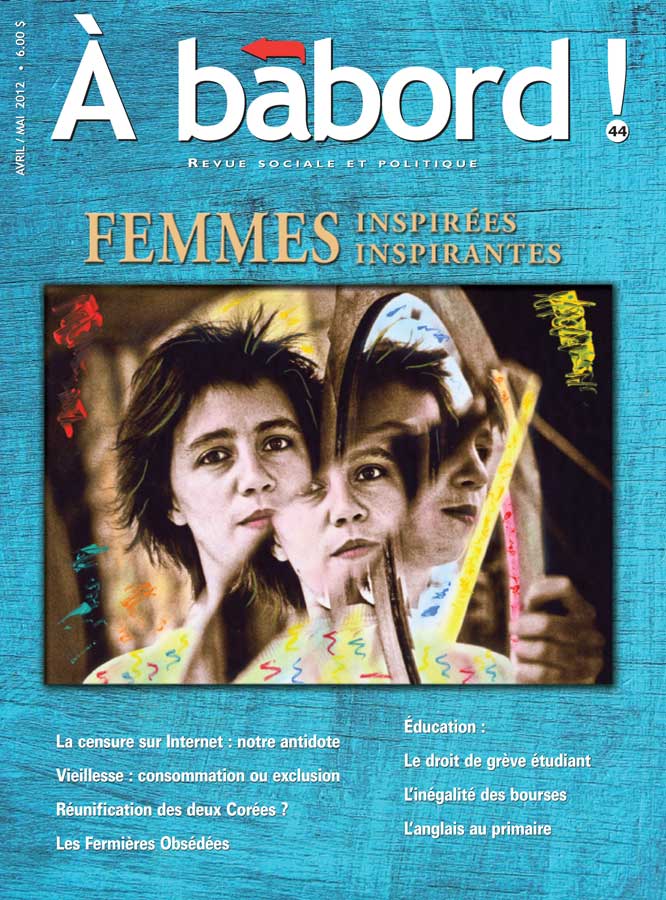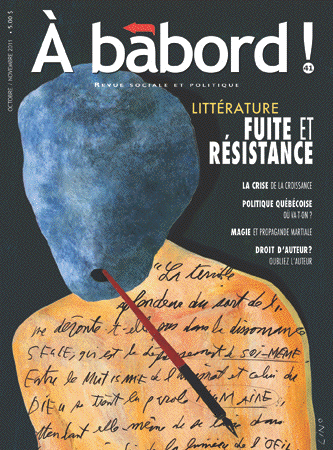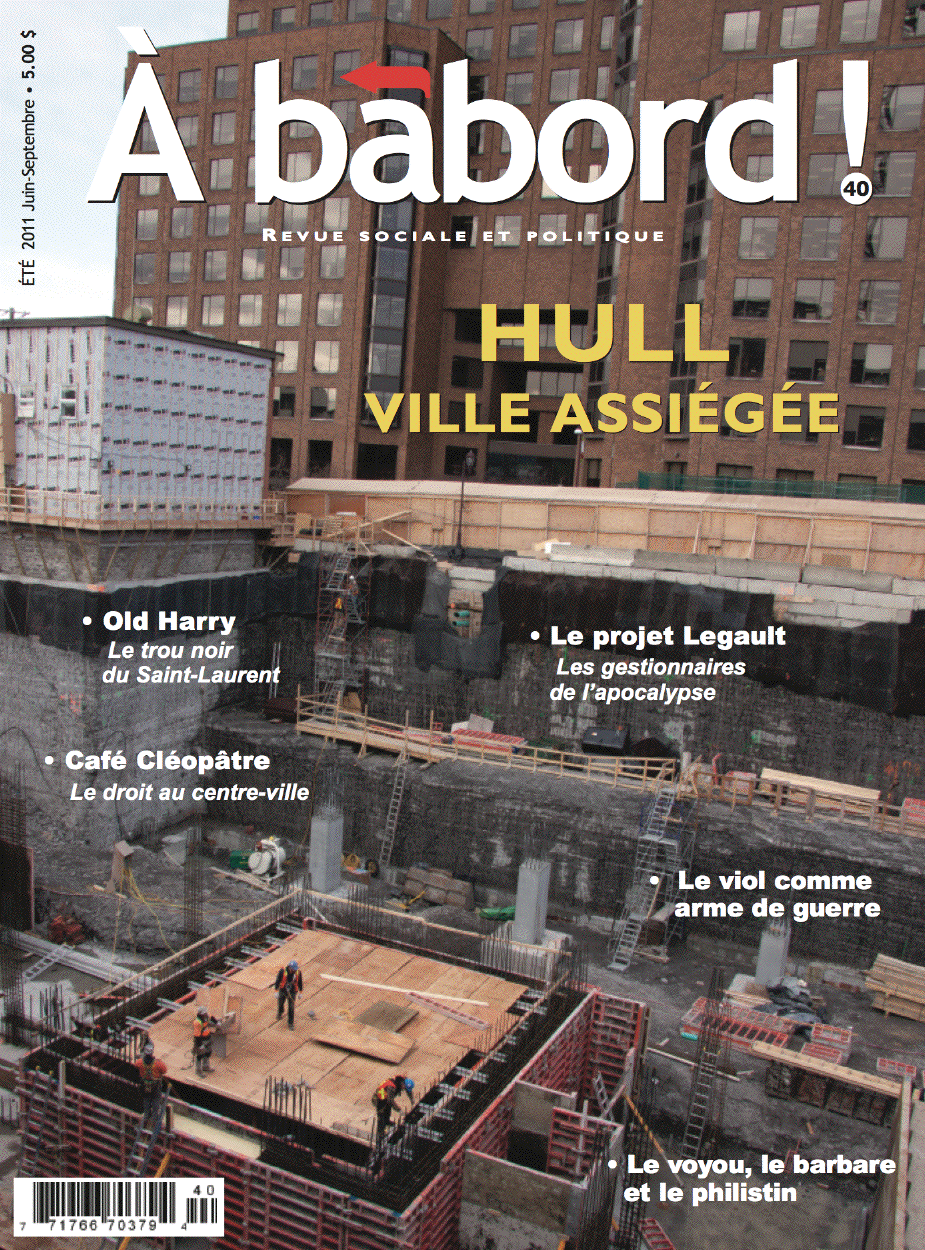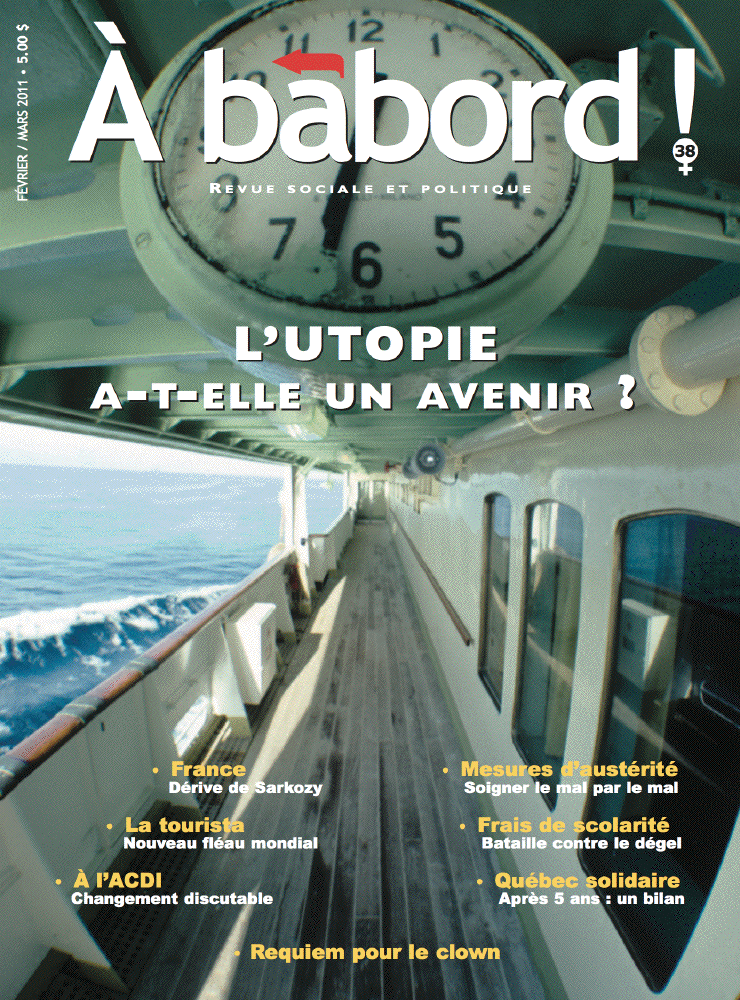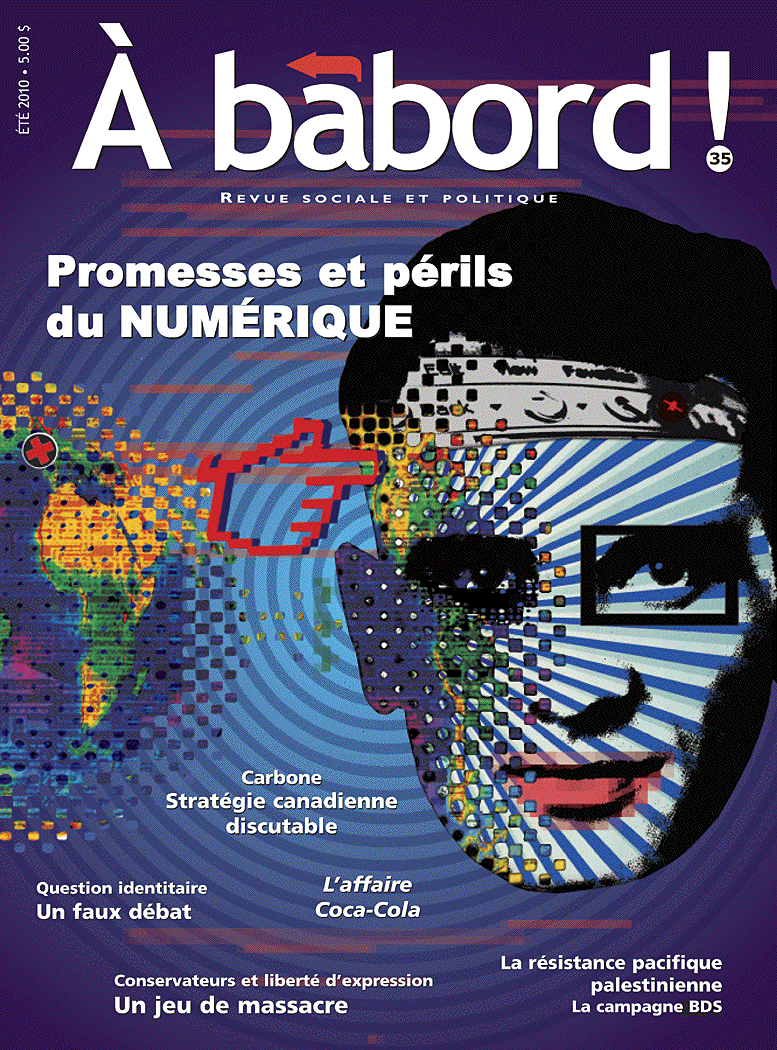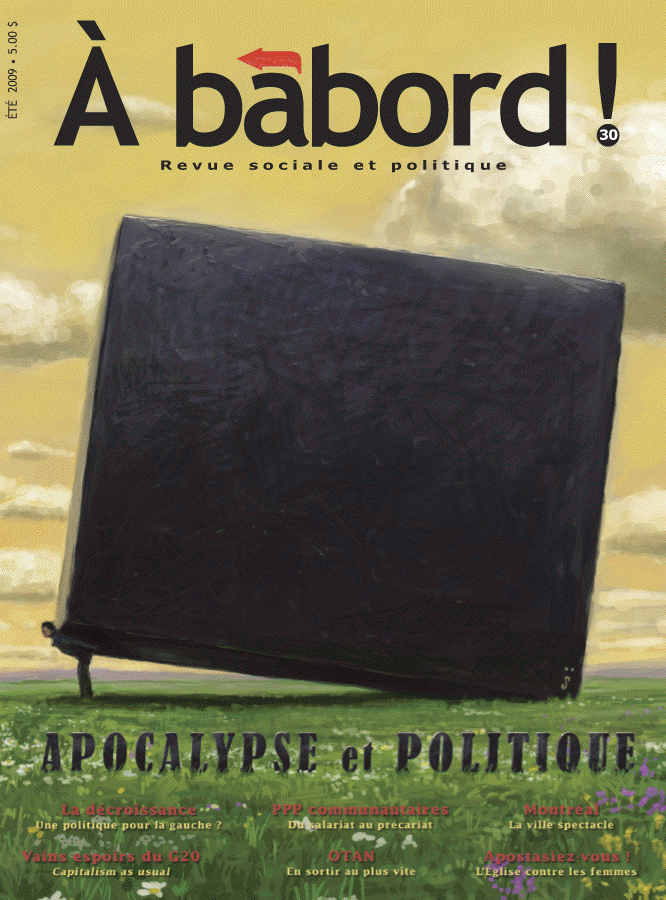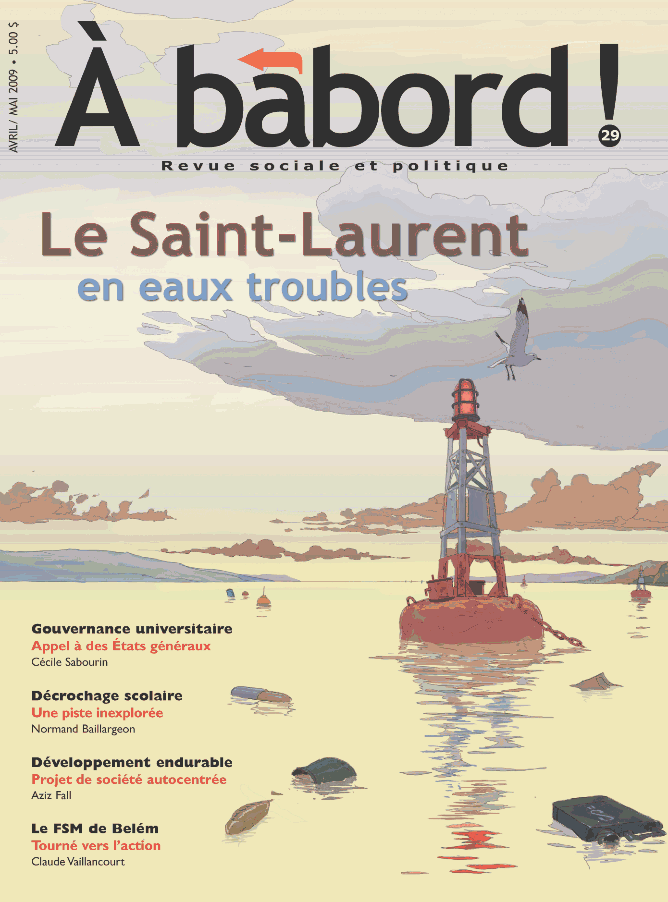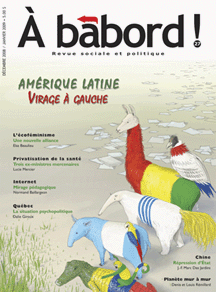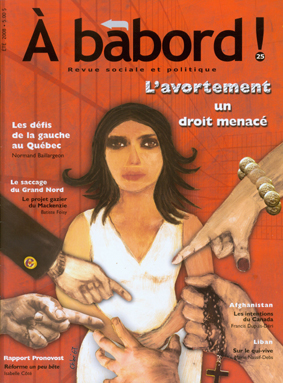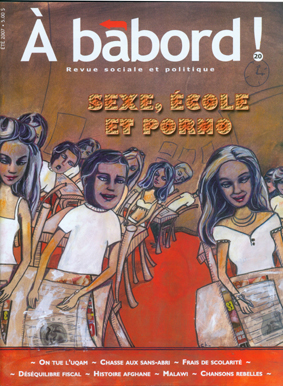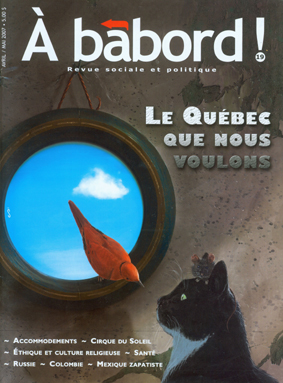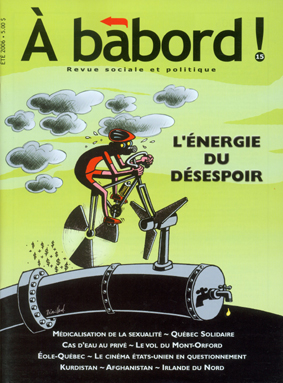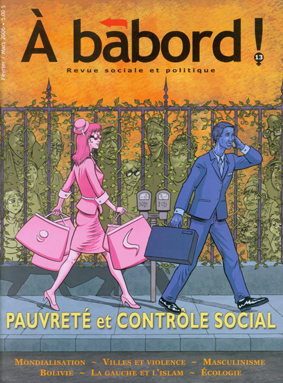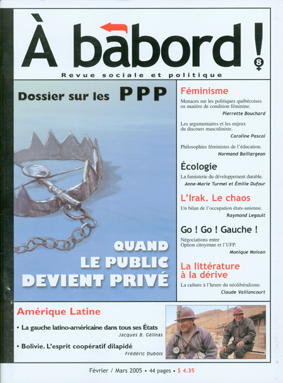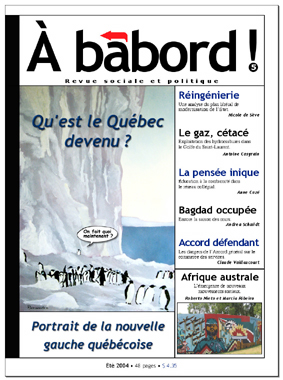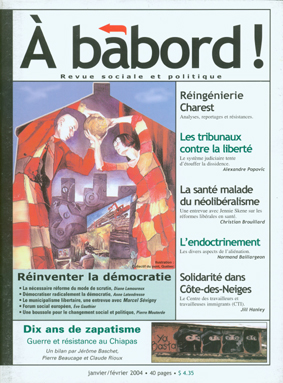Éditorial du no 72
Quand la peur change de camp
En 2014, la Fédération des femmes du Québec (FFQ) avait lancé le mouvement #AgressionNonDénoncée sur les médias sociaux. Ce mot-clic invitait les femmes à briser le silence. Grâce à ce mouvement devenu viral, plusieurs prirent conscience que les violences perpétrées envers les femmes (cis et trans ainsi qu’envers des hommes) n’étaient pas exceptionnelles. Celles-ci étaient plutôt la résultante d’un système social traversé par de multiples rapports d’oppression.
Lors des dernières semaines, nous avons pu constater avec le mouvement #MoiAussi que cette exaspération à l’endroit des gestes et des attitudes violents, sexistes et misogynes dépasse largement le territoire québécois. En quelques jours, le mot-clic a été utilisé des millions de fois, partout à travers le monde. Plusieurs personnes ont exprimé cependant des réticences ou un malaise à l’égard du concept de « culture du viol ». Pourtant, comme le rappelle l’ex-présidente de la FFQ Alexa Conradi dans son ouvrage Les angles morts, l’élimination des violences à caractère sexuel rencontre un obstacle majeur, soit une culture qui conduit les individus et les institutions à normaliser, banaliser et à tolérer ces violences, ainsi qu’à minimiser leurs conséquences négatives chez les victimes. Les agresseurs sont portés à croire qu’ils agissent en toute légitimité, que ce n’est « pas si grave après tout » et ils en viennent même à blâmer les personnes agressées.
Ces manières de penser, de sentir et d’agir structurent les dynamiques relationnelles dans de nombreux milieux. Des enquêtes journalistiques ont signalé le silence de collègues de travail et de patrons à l’égard des comportements d’Éric Salvail et de Harvey Weinstein, entre autres.
Le dossier de ce numéro fait d’ailleurs état de problèmes tout à fait similaires, en ce qu’il montre comment la médecine obstétricale fait trop souvent l’impasse sur la notion de consentement des femmes enceintes en leur imposant des mesures ou des techniques médicales qui violent leur intégrité physique ou psychologique.
Enfin, l’ampleur des vagues #AgressionNonDénoncée et #MoiAussi révèle l’incapacité de la justice à traiter adéquatement ces crimes graves contre la personne. Le système judiciaire contribue à perpétuer l’impunité en imposant à la victime le fardeau de démontrer qu’il n’y a pas eu de consentement. Comme le soulignait la juriste Rachel Chagnon dans Le Devoir en octobre dernier, si on nous donne un coup de poing dans la rue, doit-on prouver qu’on ne l’a pas cherché, qu’on n’avait pas consenti à le recevoir ? De toutes les agressions déclarées, seuls 3 cas sur 1 000 résultent en une condamnation. Face aux institutions qui ont prouvé leur inefficacité, comment en vouloir à ces femmes, qui ne trouvent pas justice ailleurs, de prendre parole publiquement pour dire ce qu’elles n’ont jamais osé dire ? Les policiers, les enquêteurs, les avocats et les juges doivent remettre en cause leurs pratiques.
Serait-on actuellement à l’aube d’un basculement ? La peur changera-t-elle de camp de manière durable ? Avant que l’on en soit là, il reste encore beaucoup de travail à abattre. Un pas supplémentaire a cependant été franchi depuis #AgressionNonDénoncée : débordant de l’univers numérique, les témoignages ont ciblé des personnes précises, souvent bien en vue. Les centres d’aide et de luttes aux agressions à caractère sexuel rapportent une forte augmentation des appels depuis quelques semaines. L’impunité n’est plus chose acquise.
La route est longue pour changer les mentalités. Transformer ces dernières en profondeur demande plus de temps que d’adopter une loi. Sans une prise de conscience du rôle que nous jouons toutes et tous dans la chaîne de ces oppressions, l’atteinte d’une sécurité égale entre les genres sera difficile. Pour cela, il est important de remettre les stéréotypes en question, mais aussi d’expliquer aux jeunes (et moins jeunes) ce qu’est le consentement, qui suppose une écoute attentive d’autrui.
Nous connaissons actuellement des avancées importantes et il faut saluer le courage de celles qui ont pris la parole ici et ailleurs. Souhaitons à toutes ces personnes de trouver soutien et solidarité auprès de leurs proches. Prenons soin de nous et revenons en force en 2018.