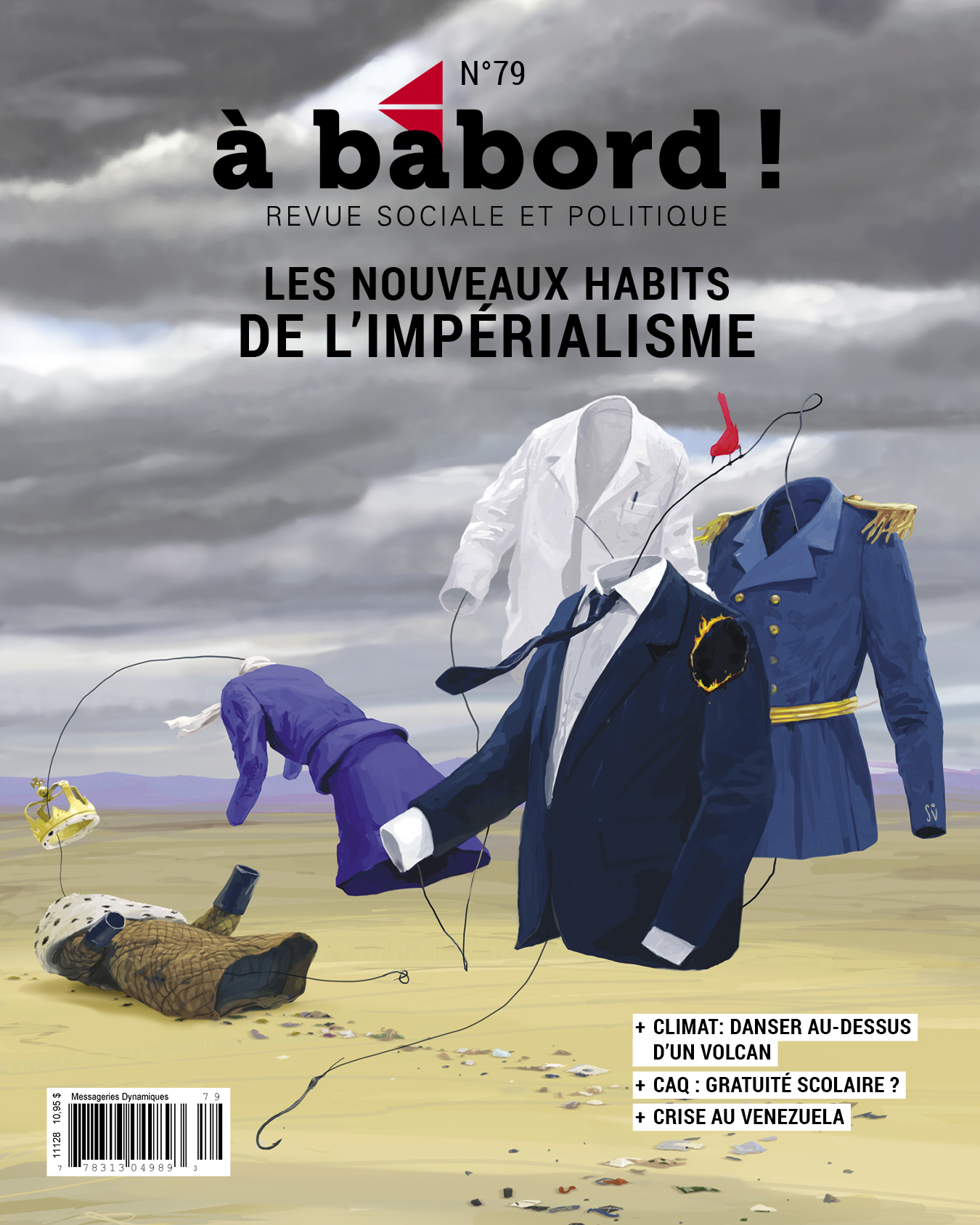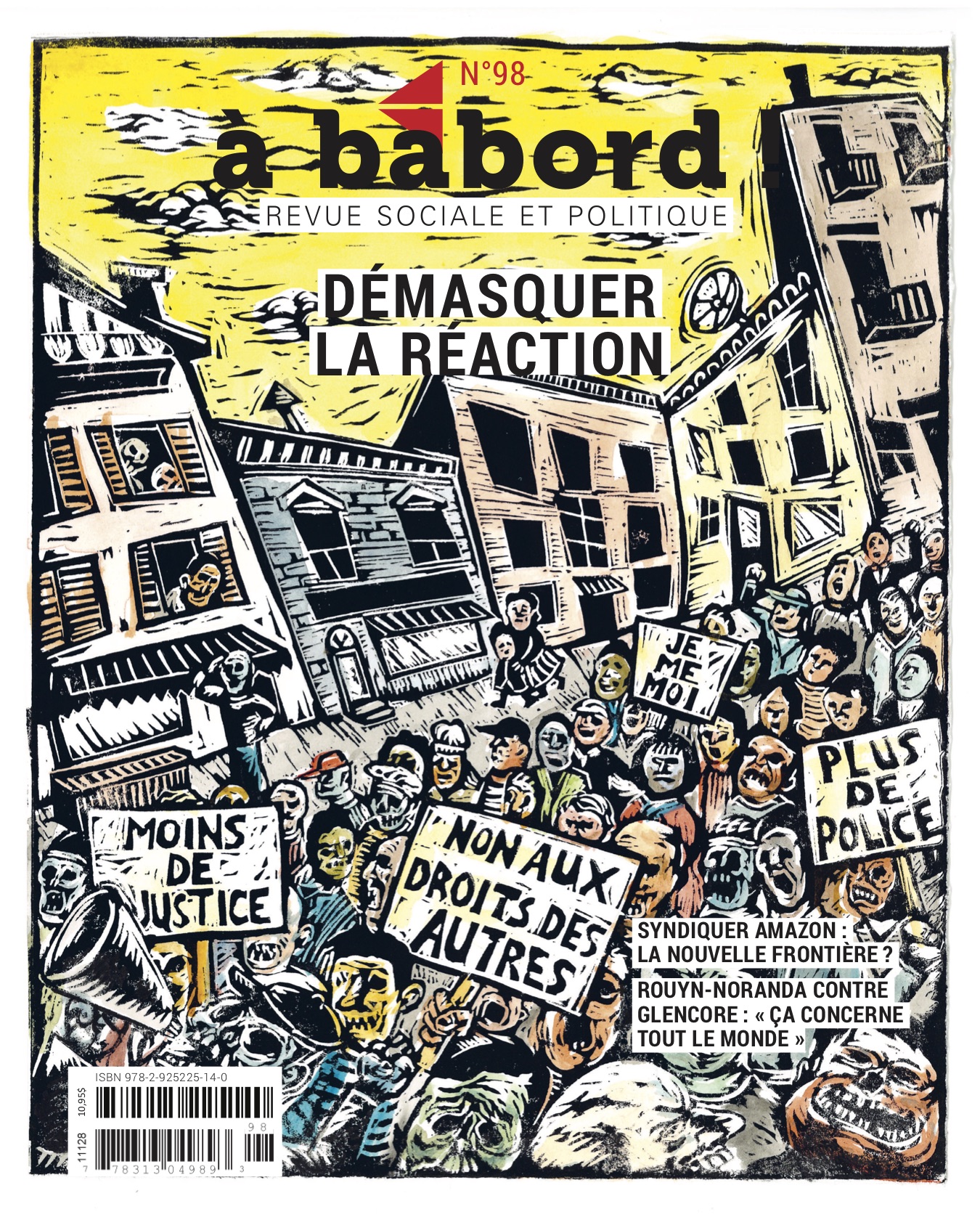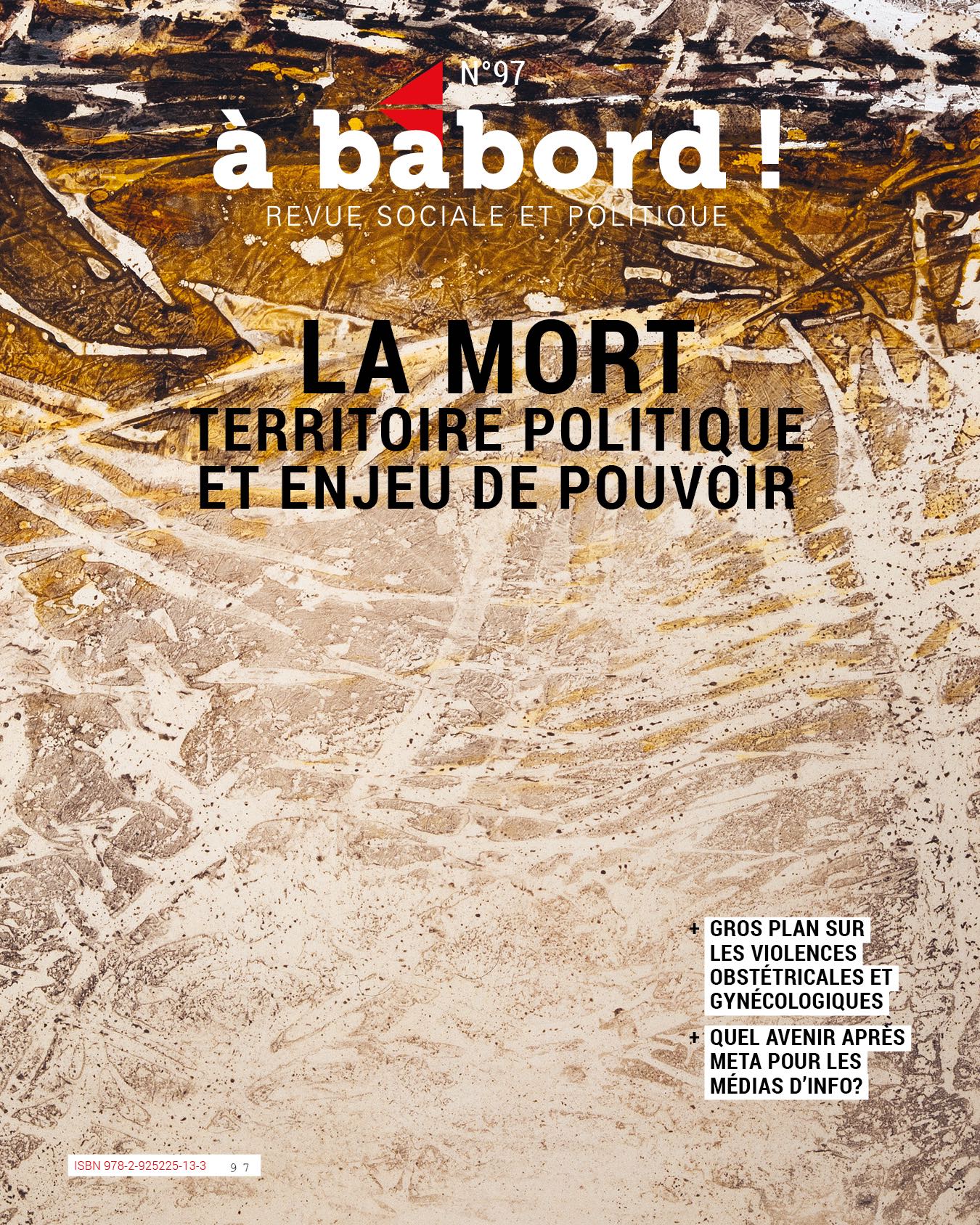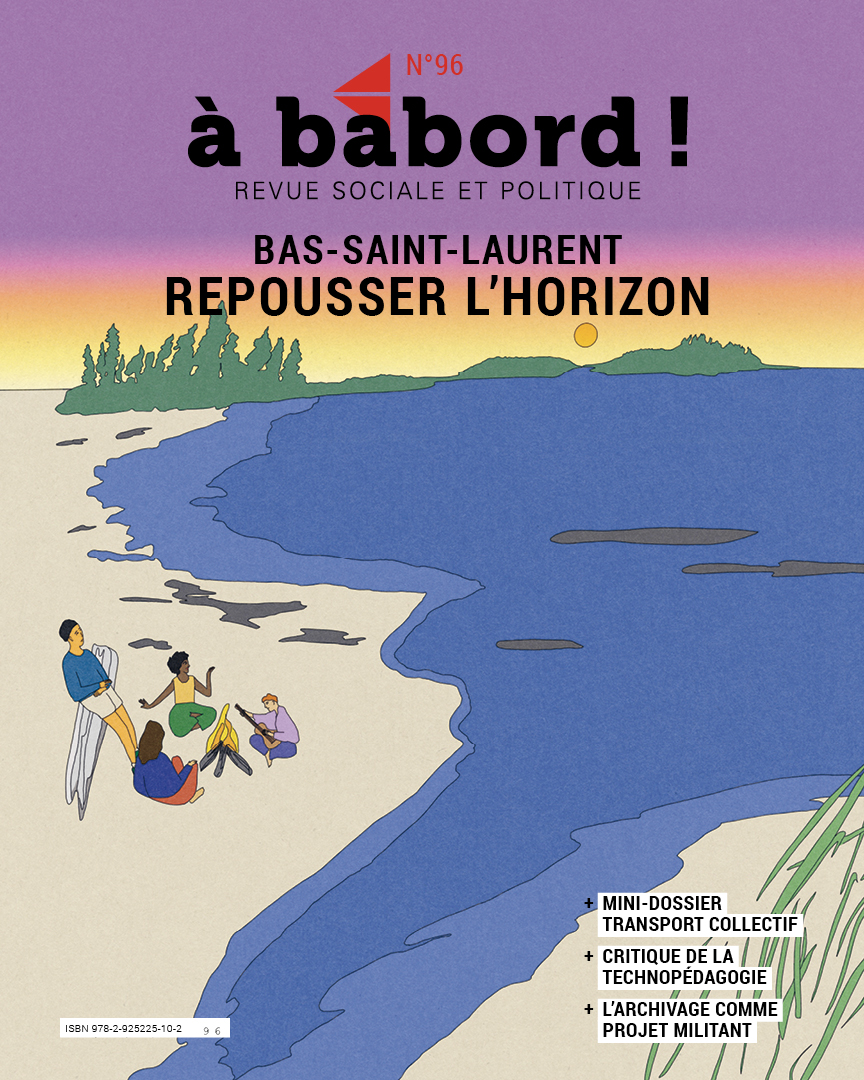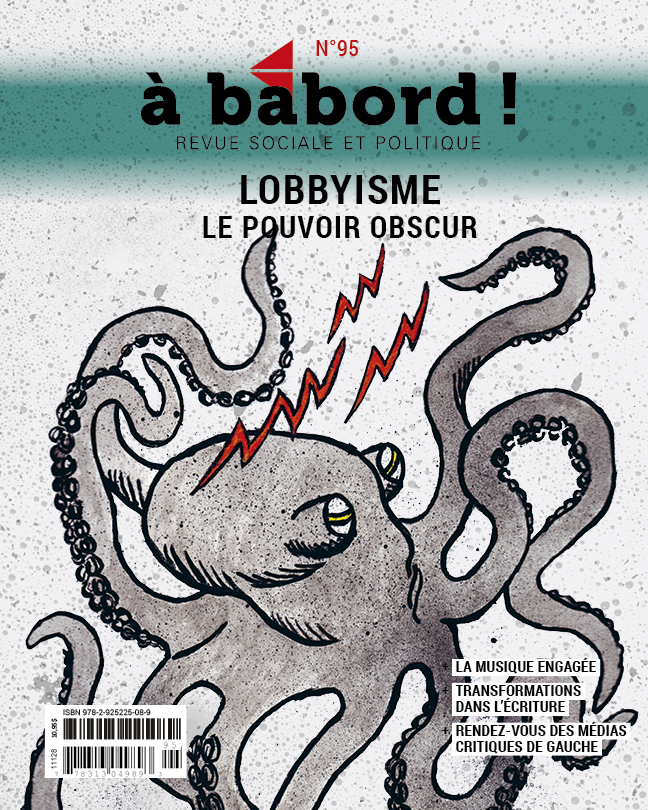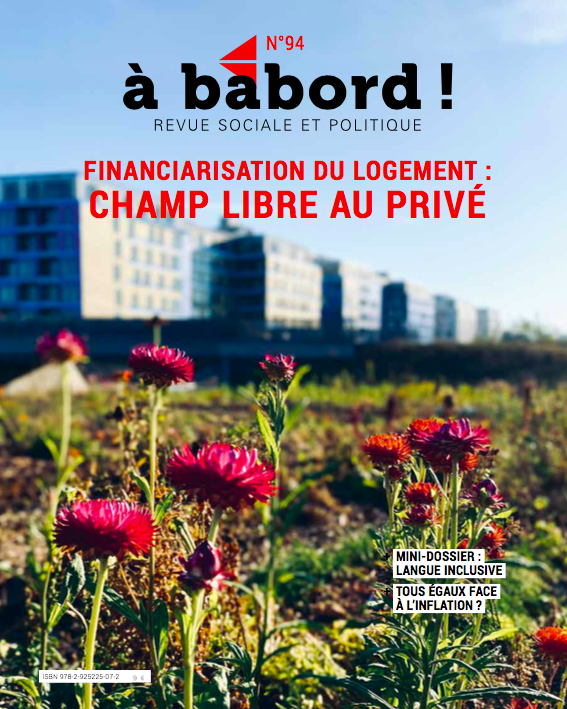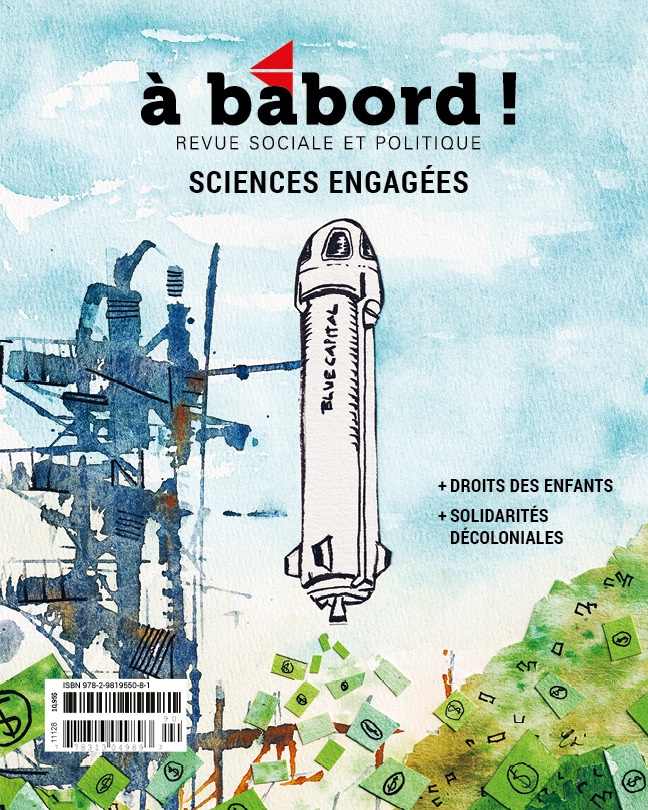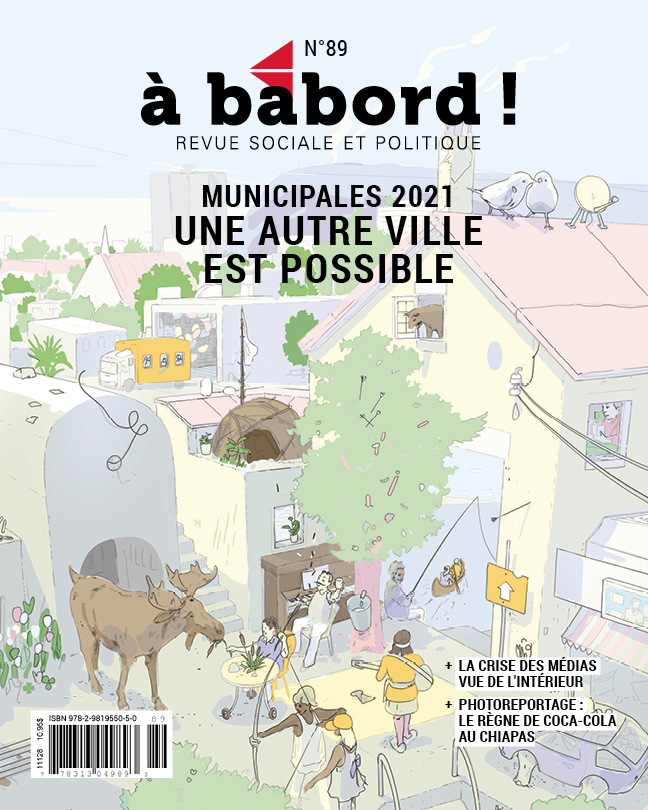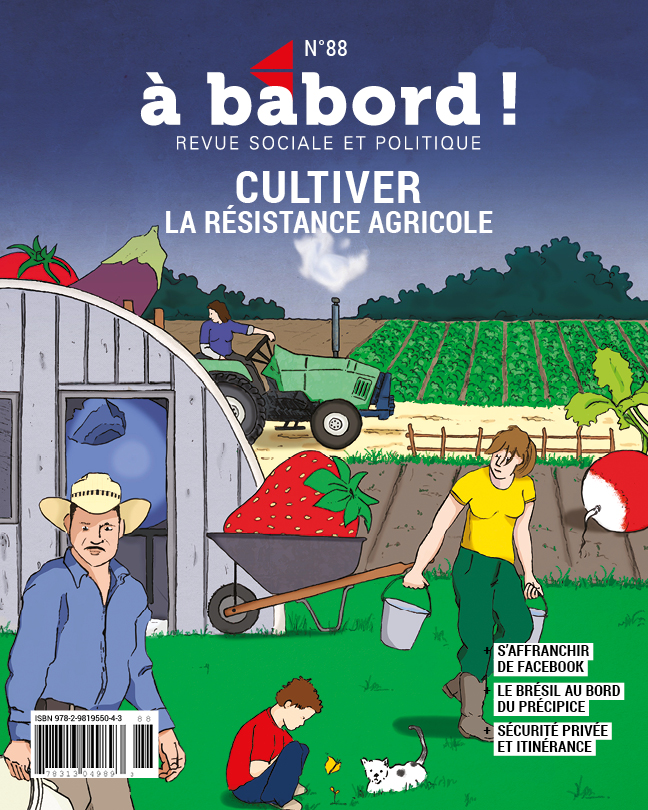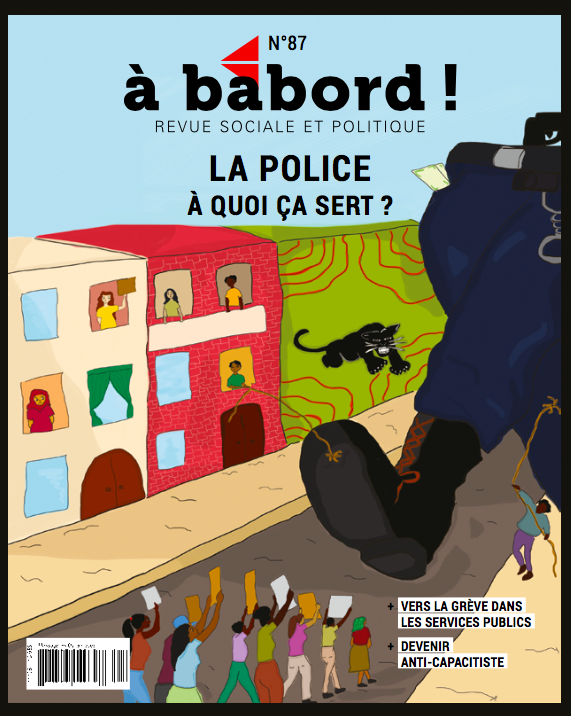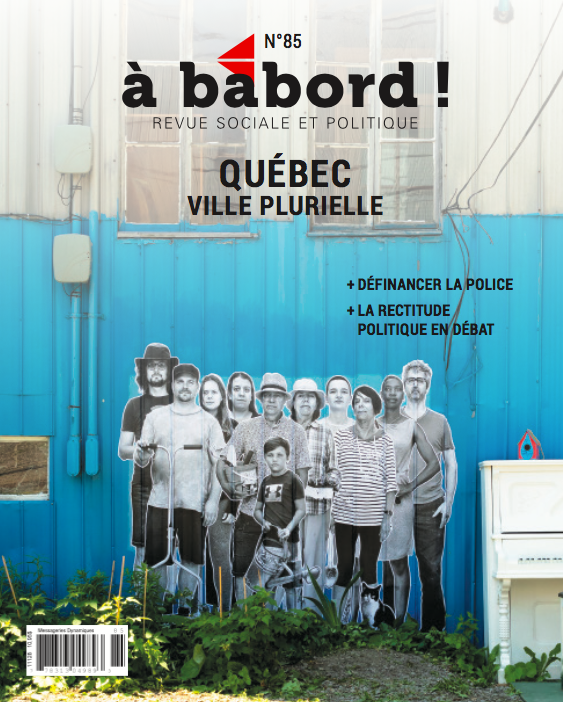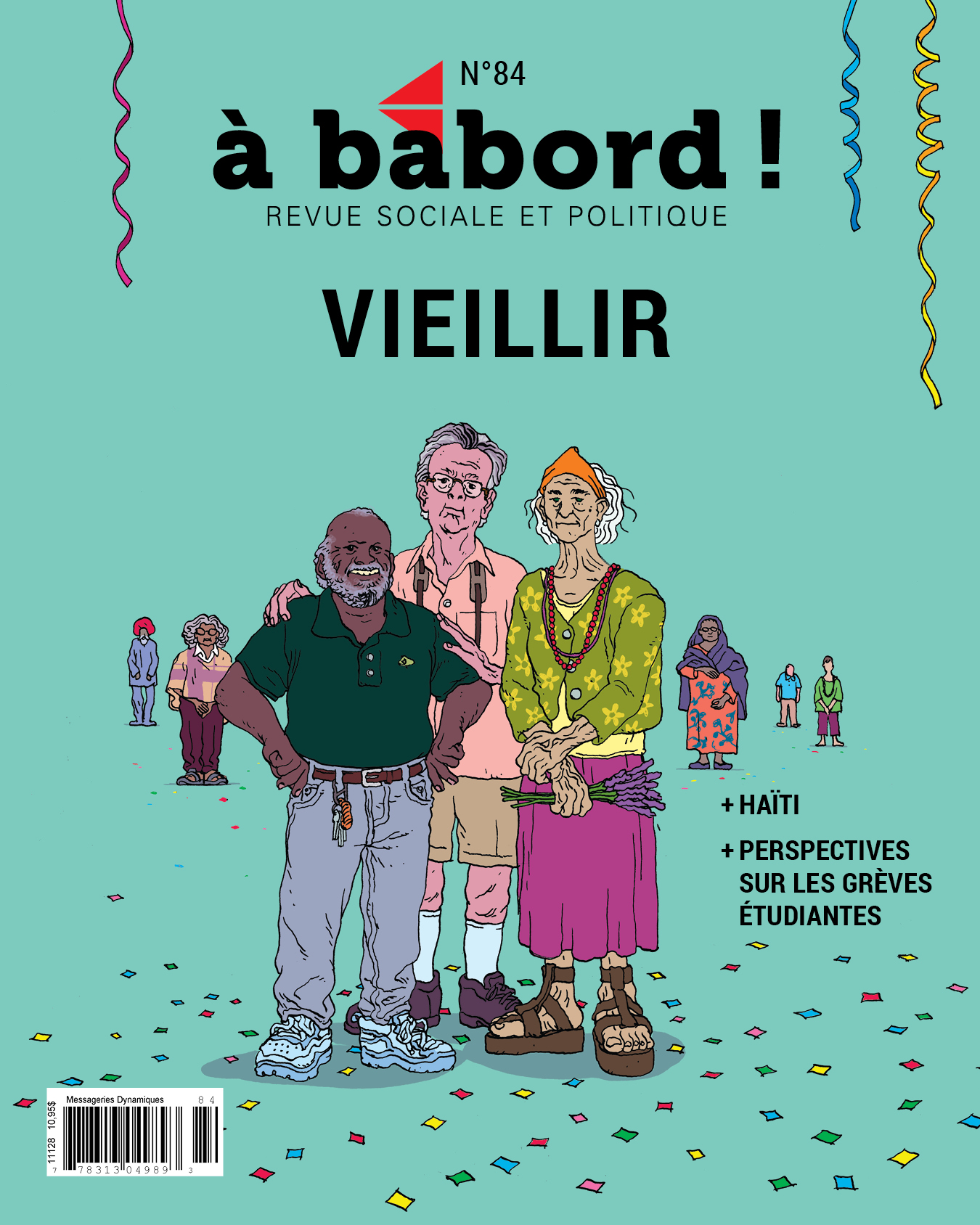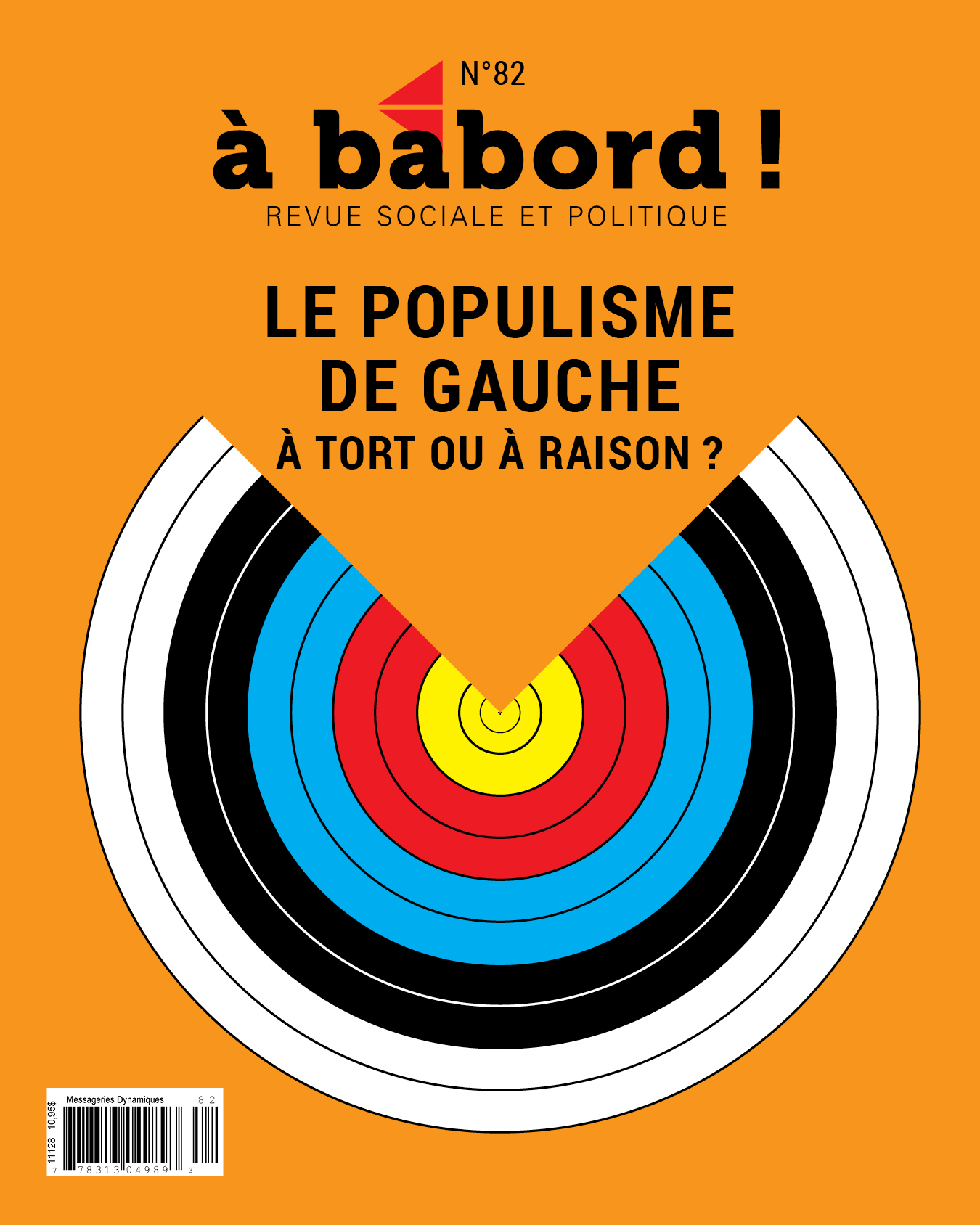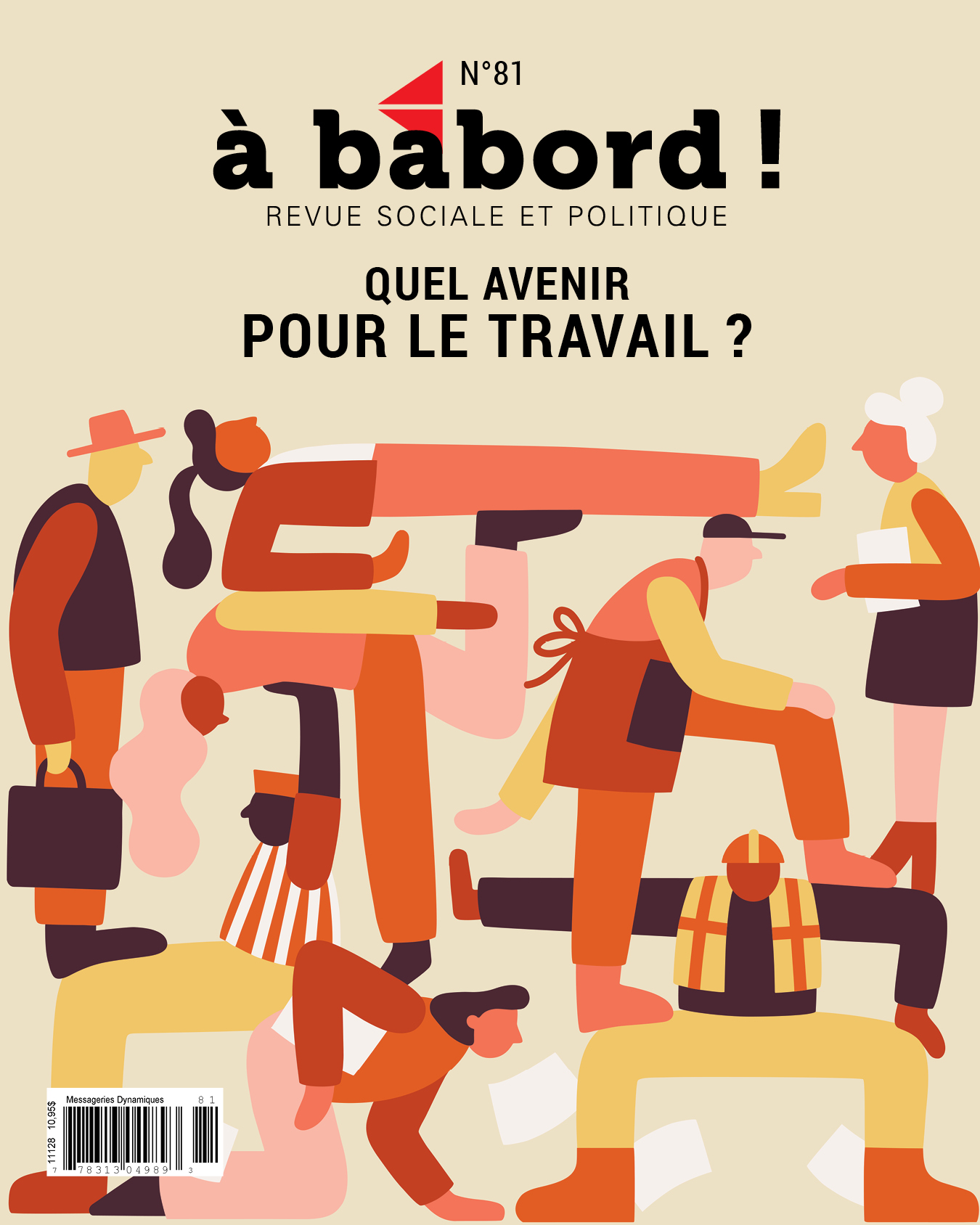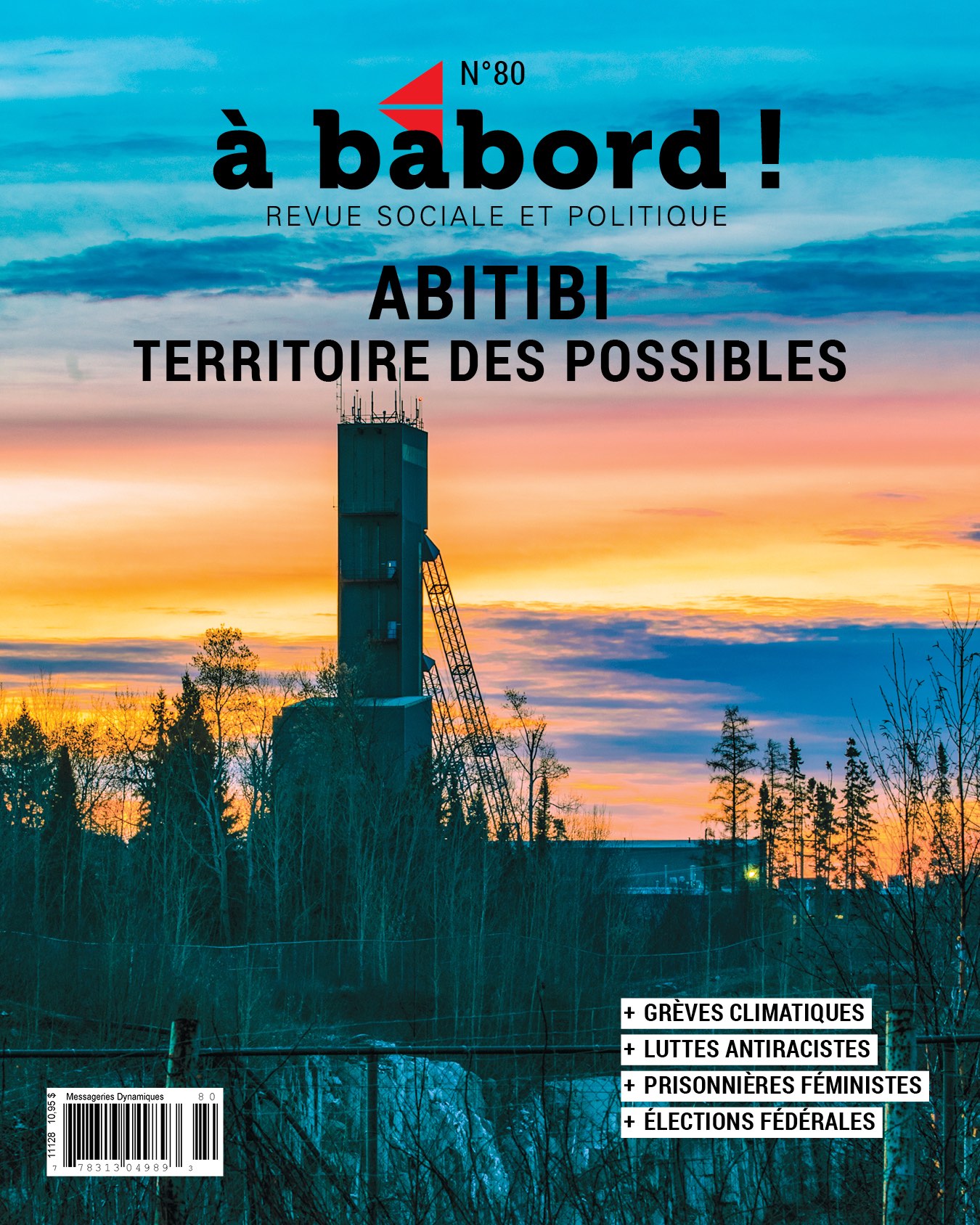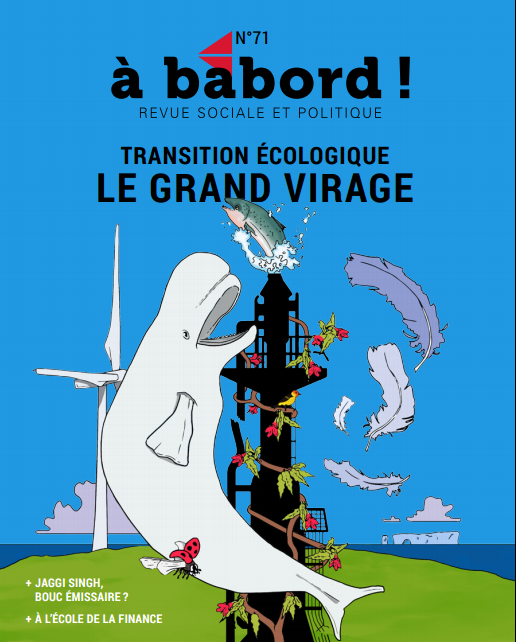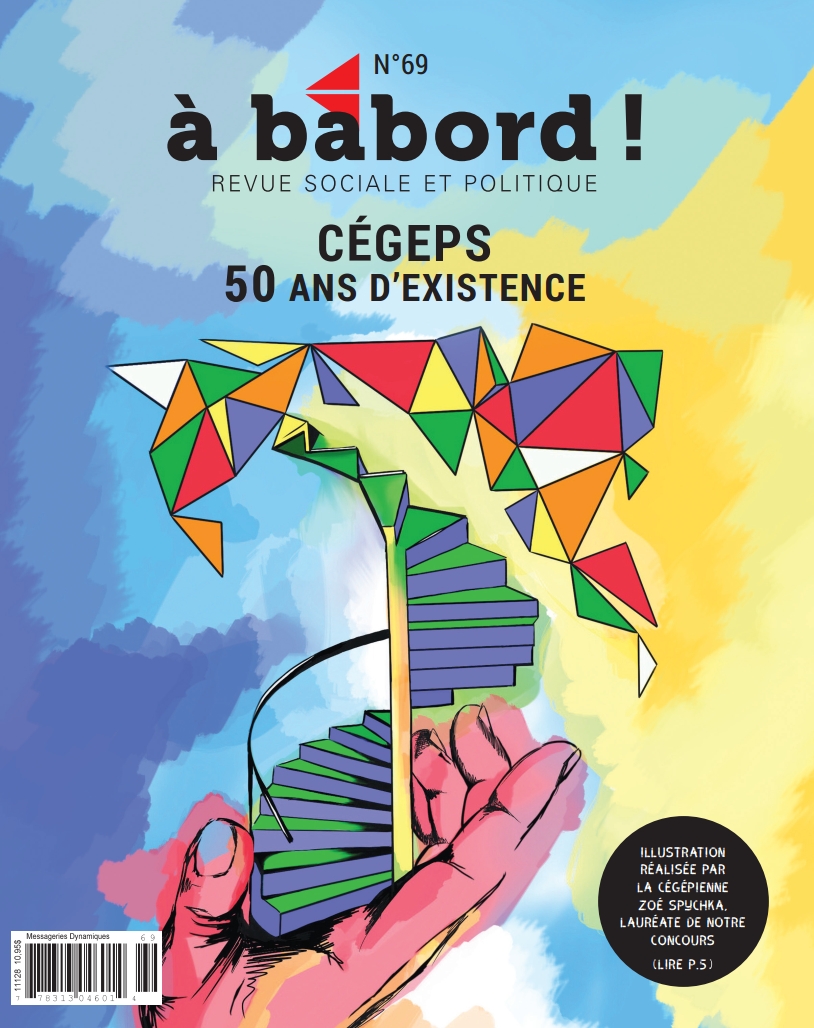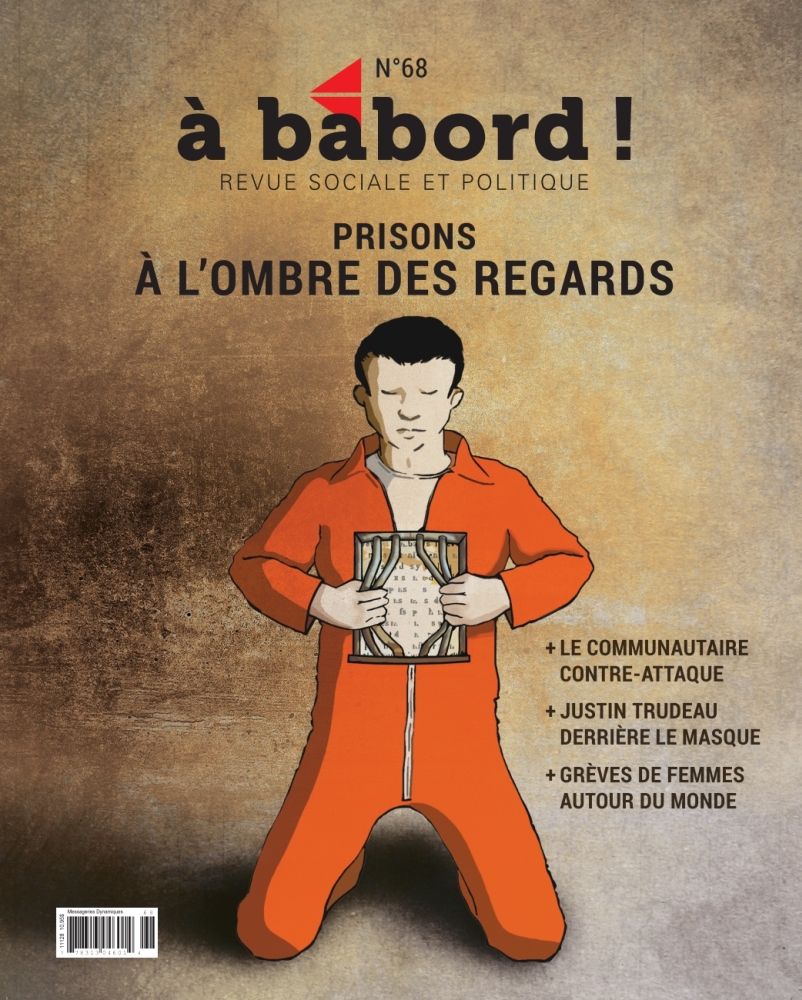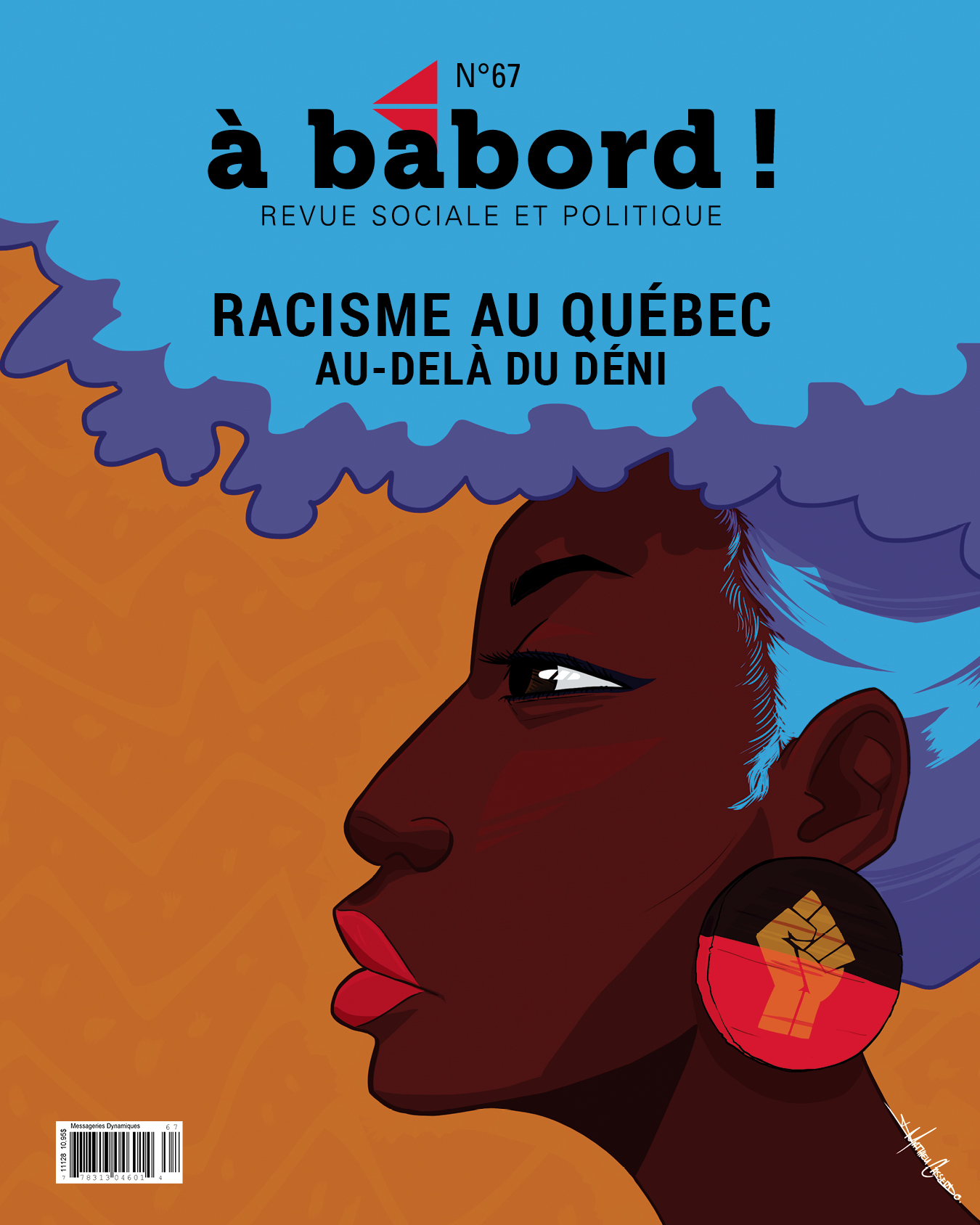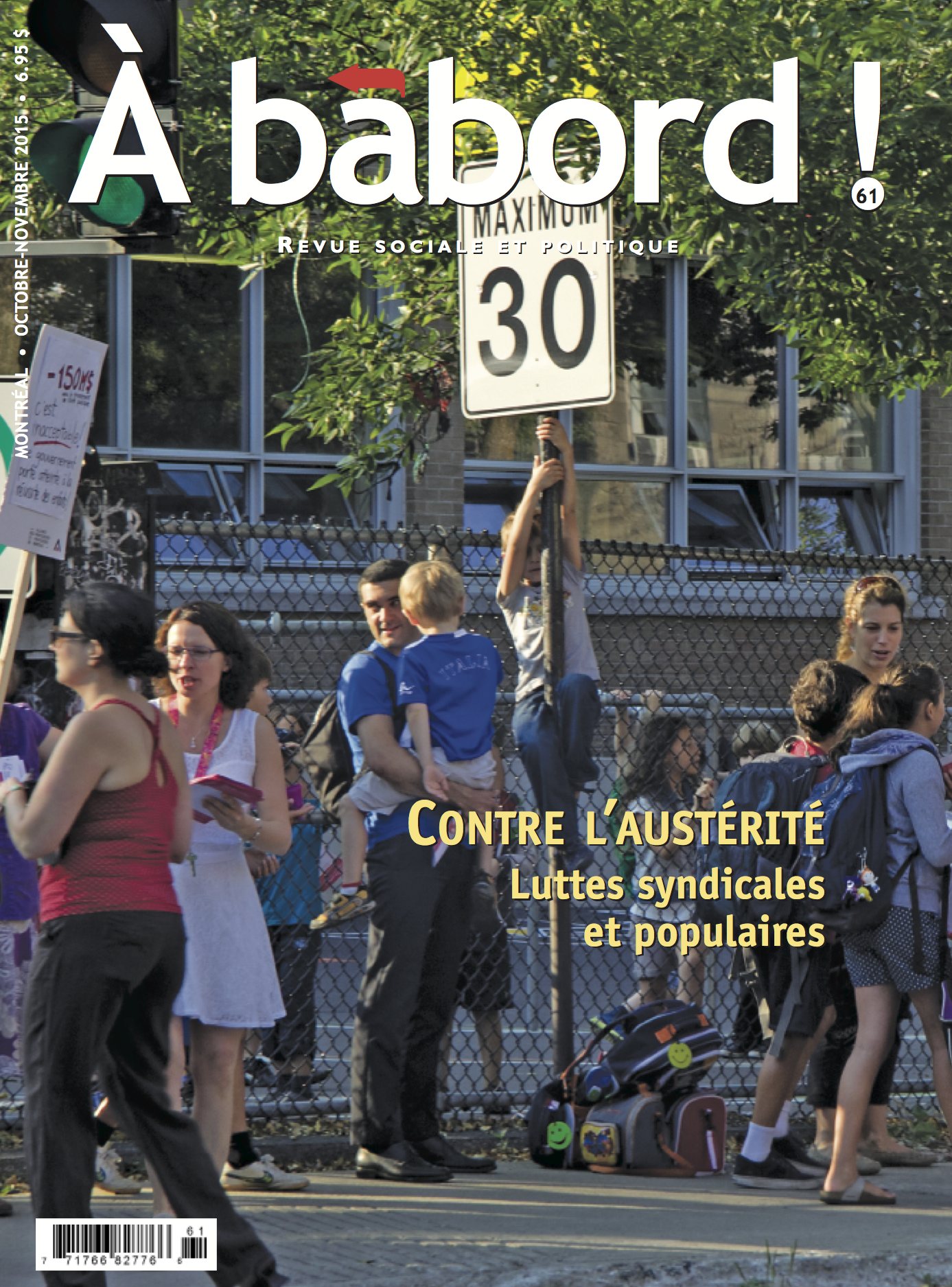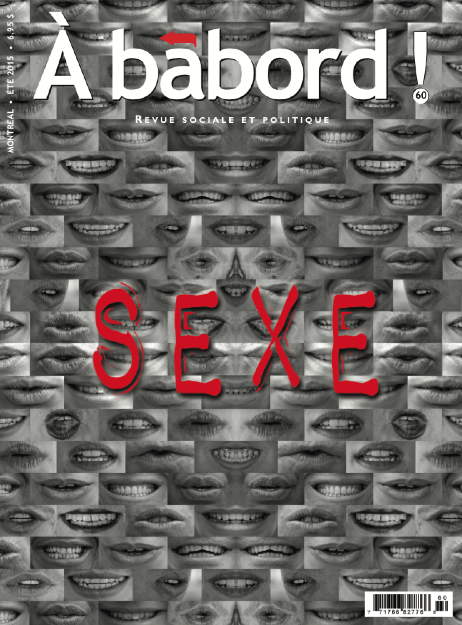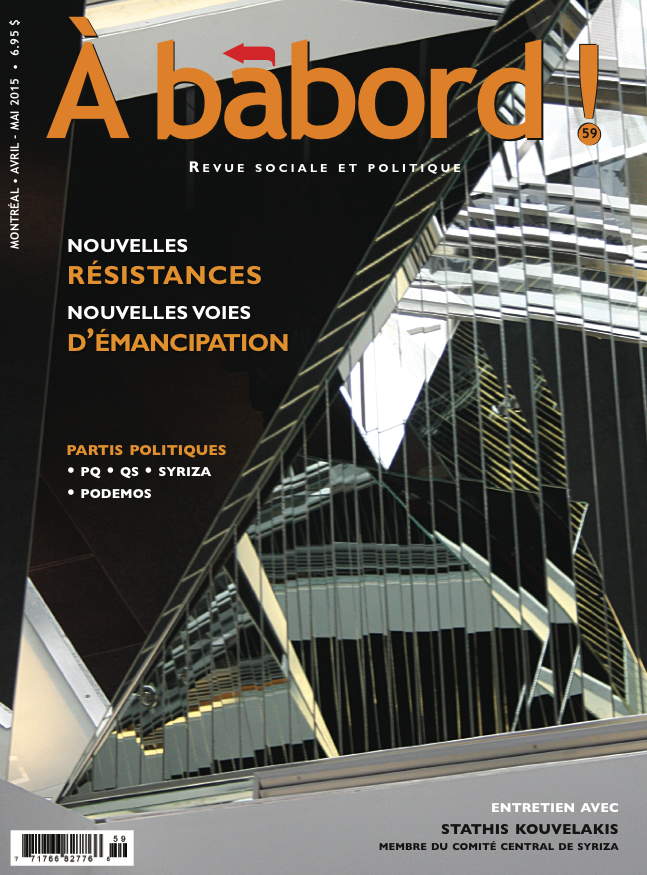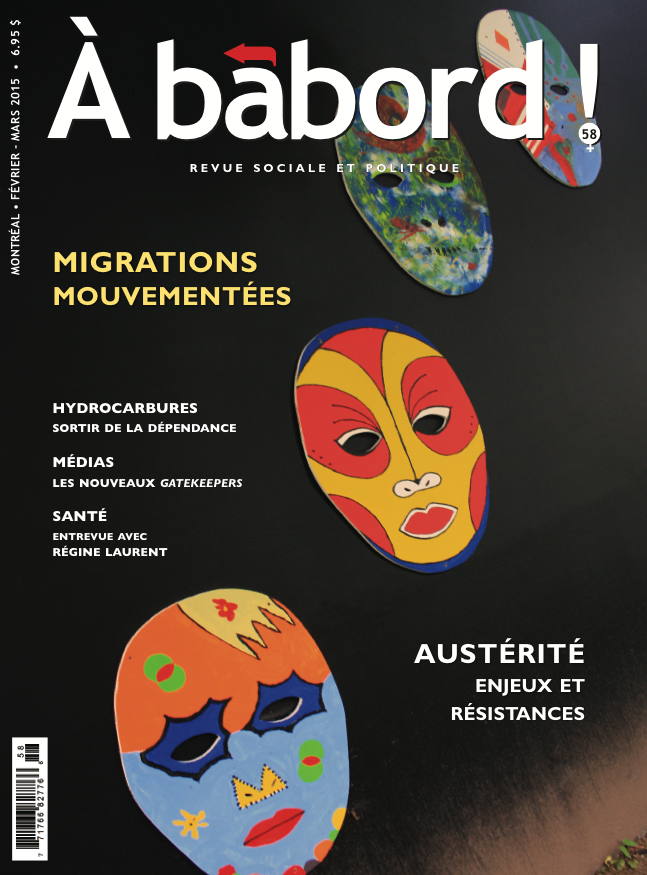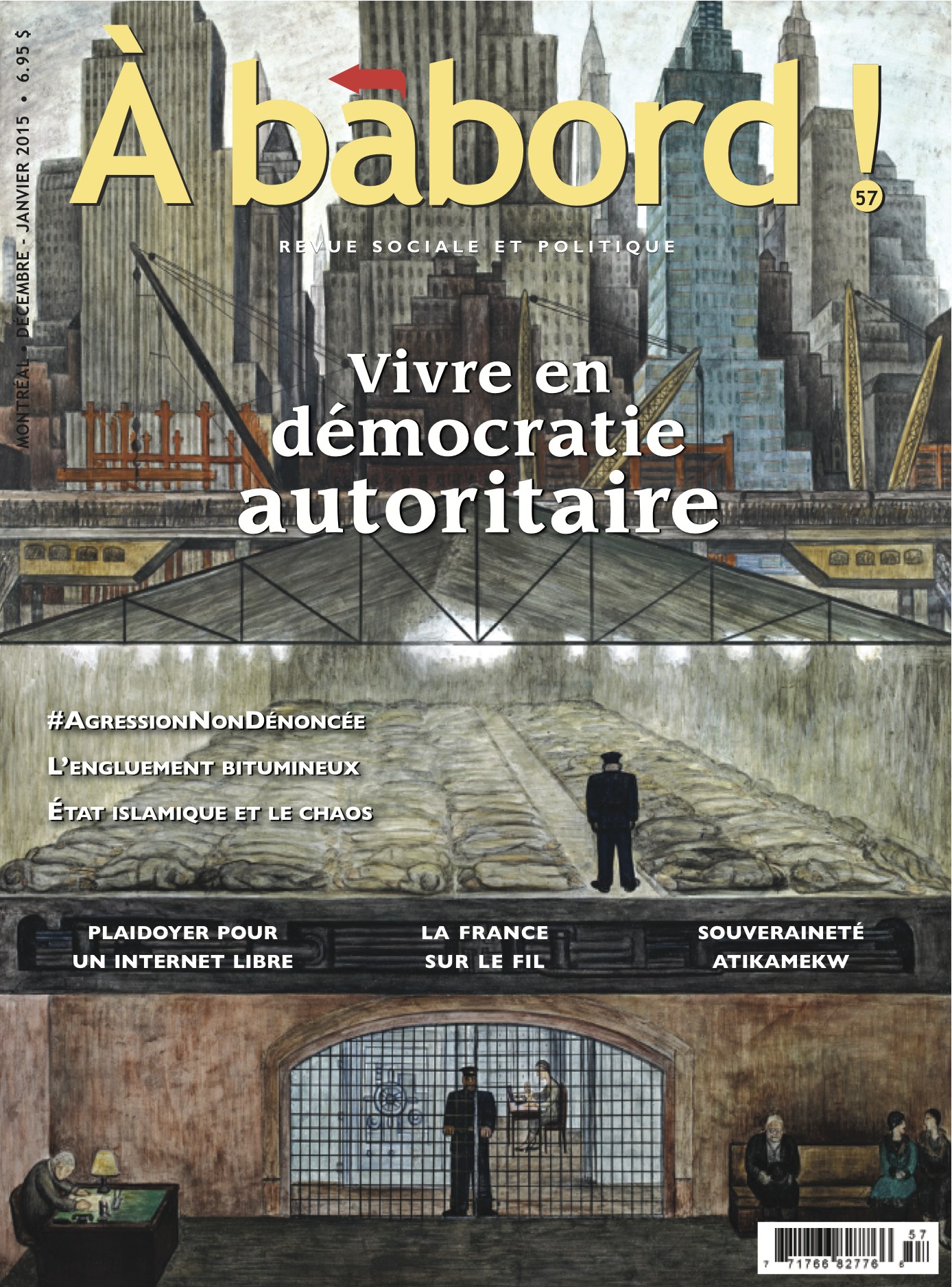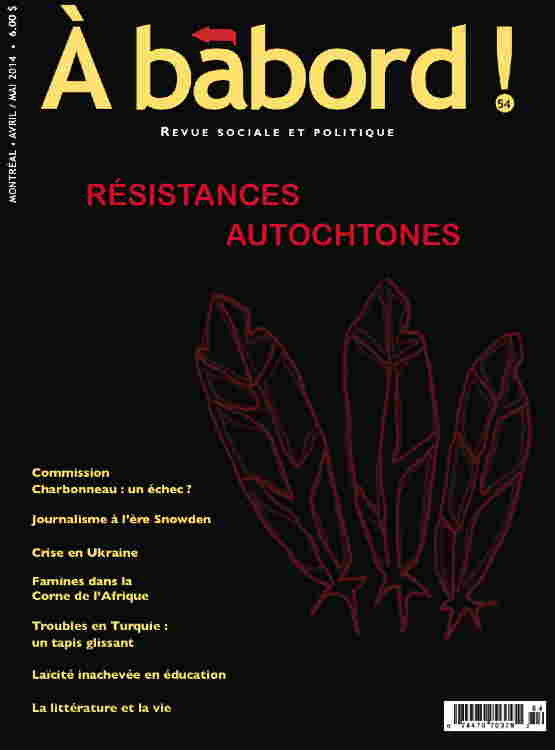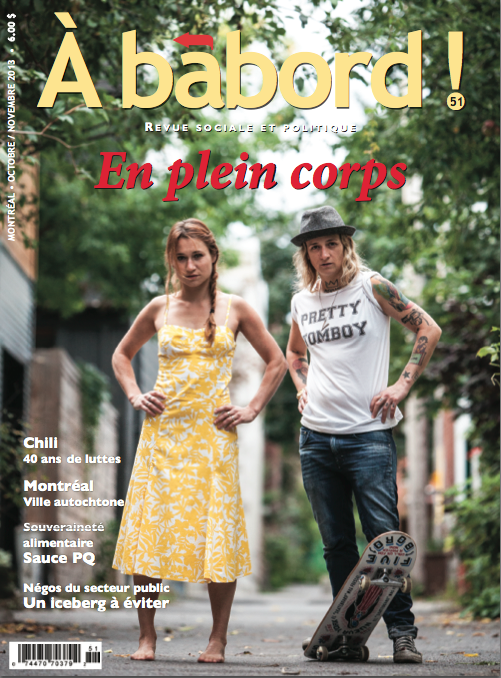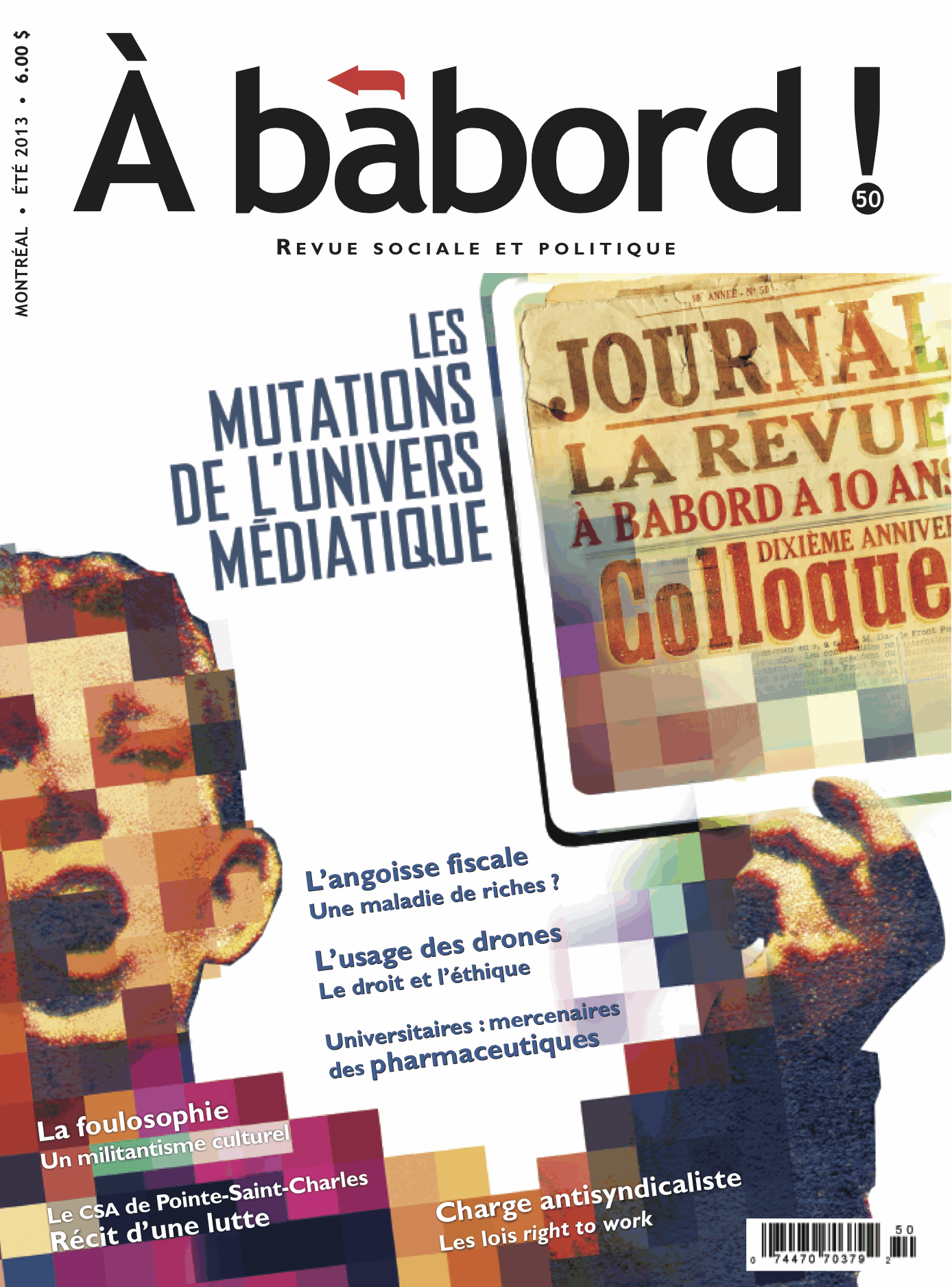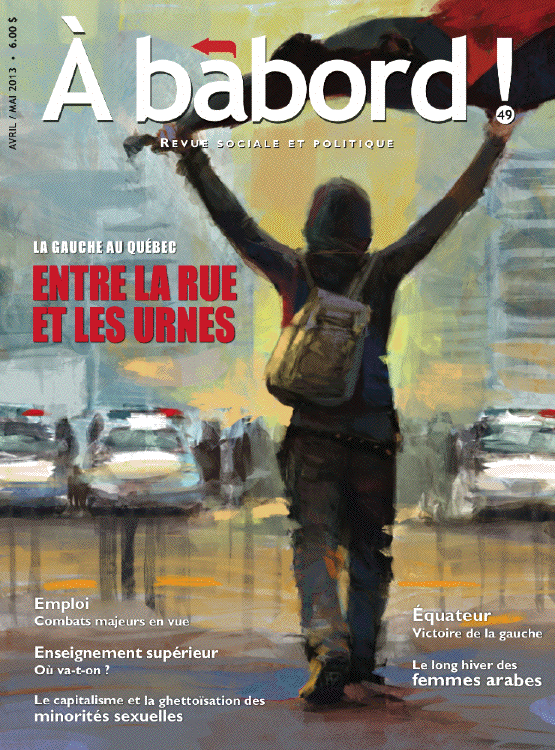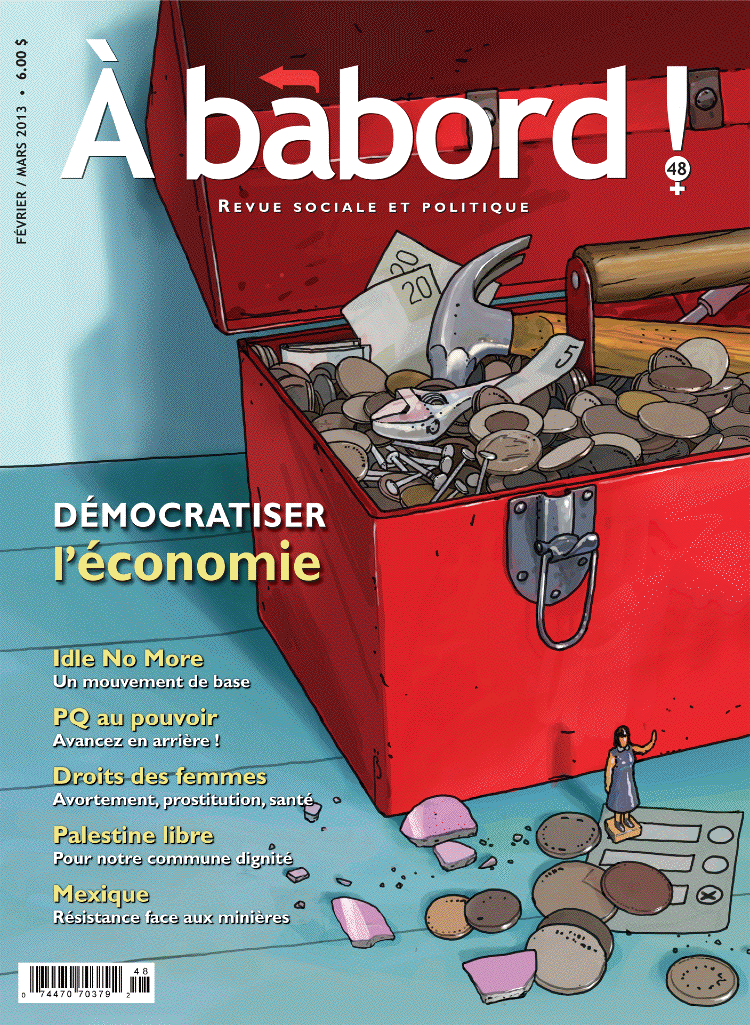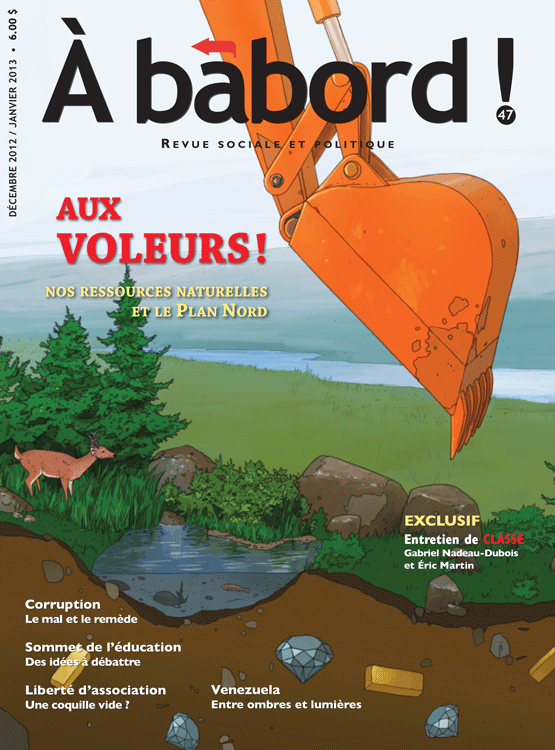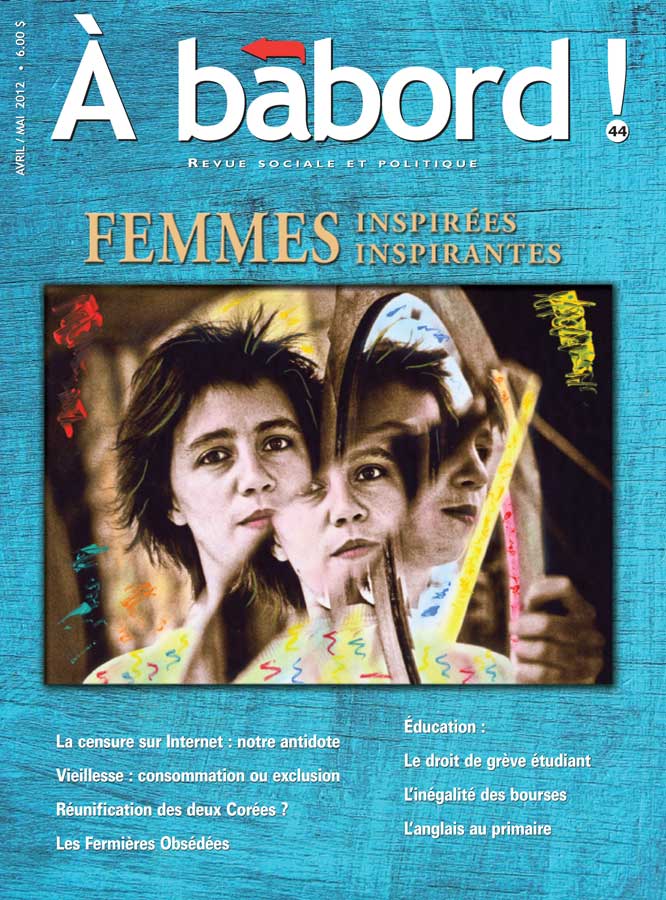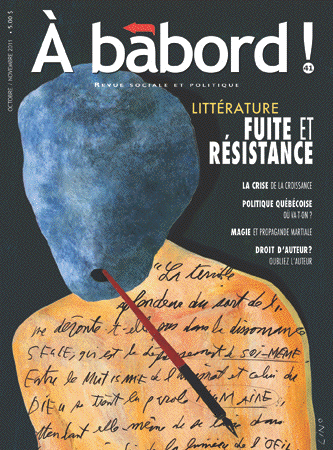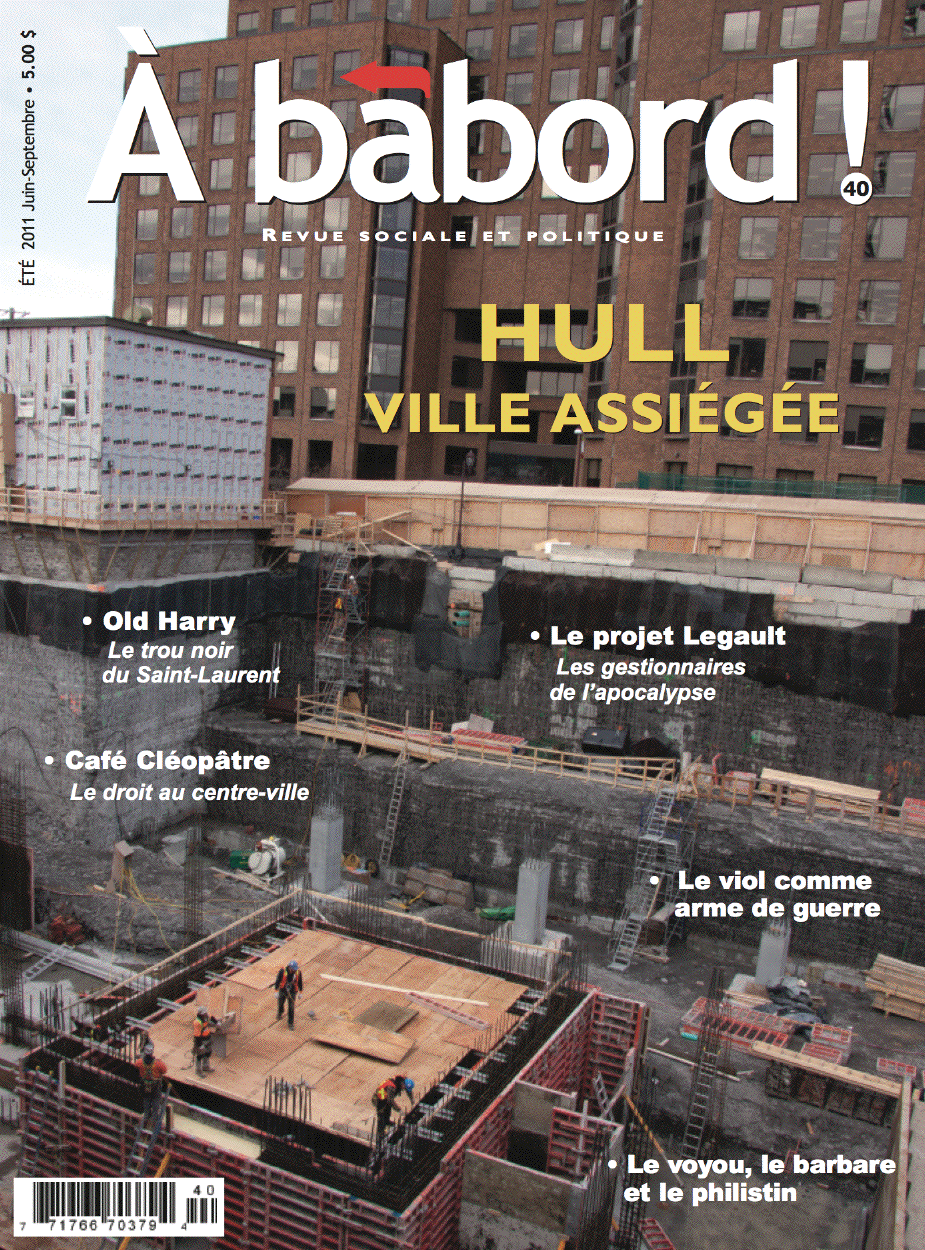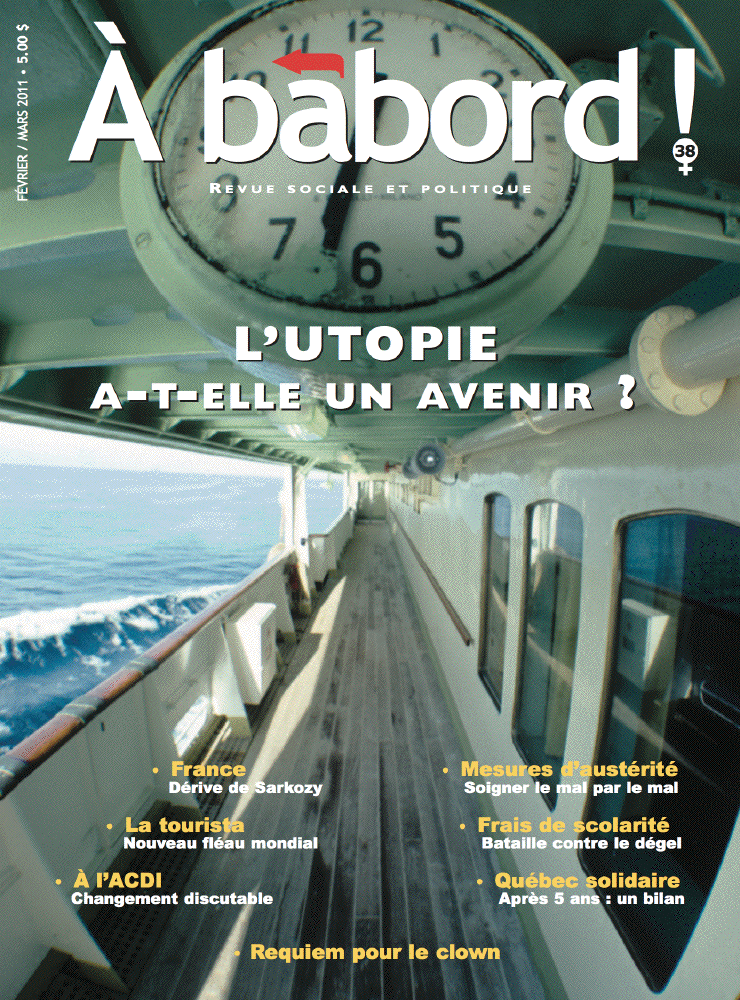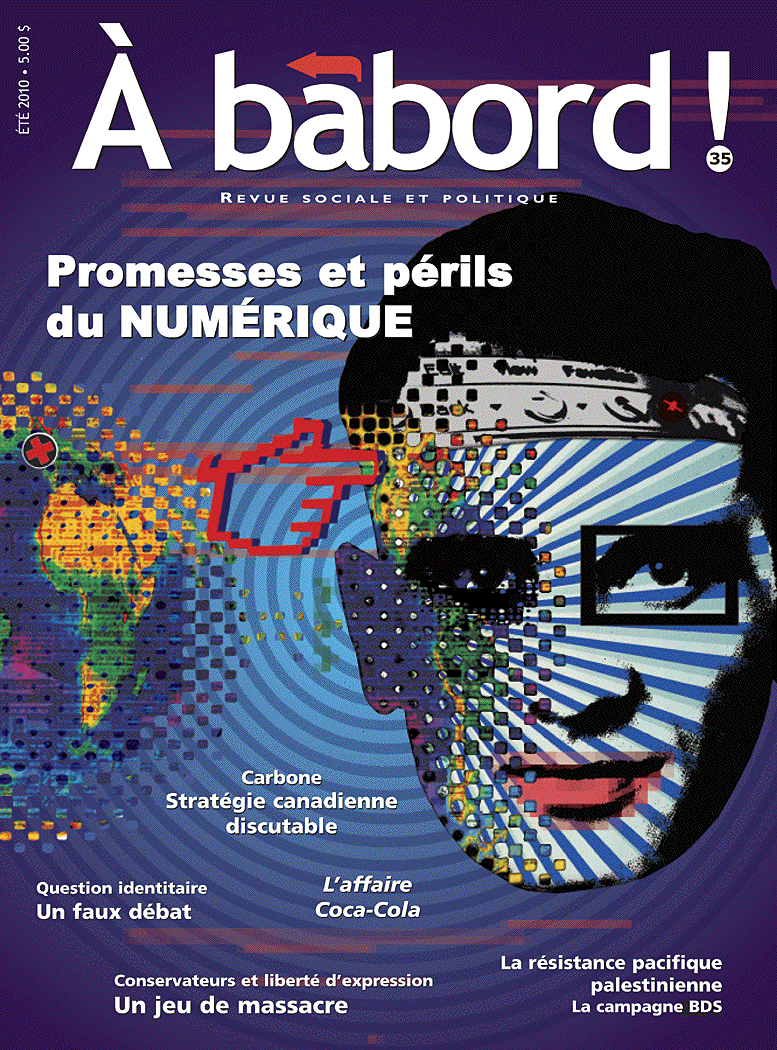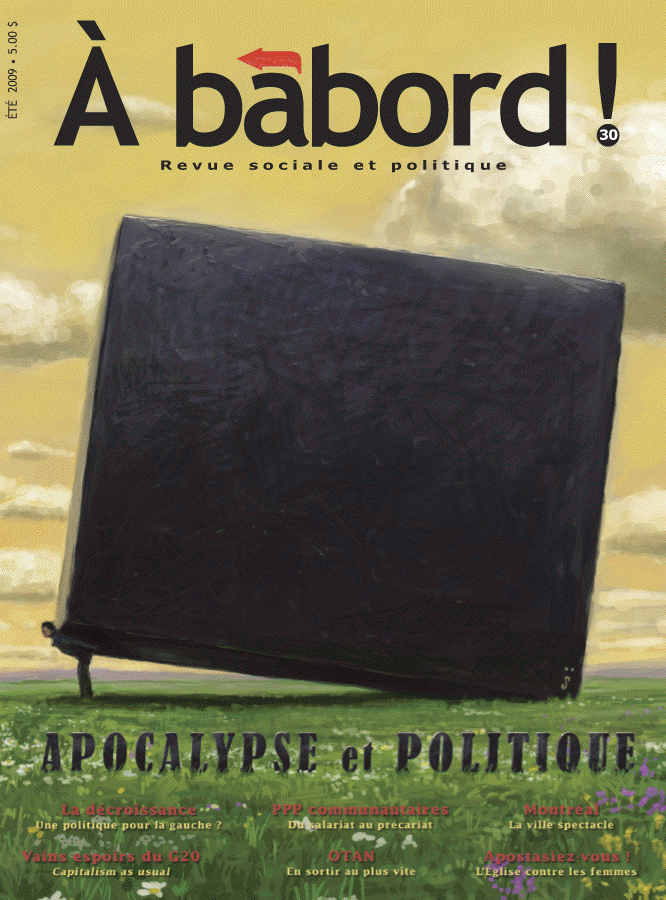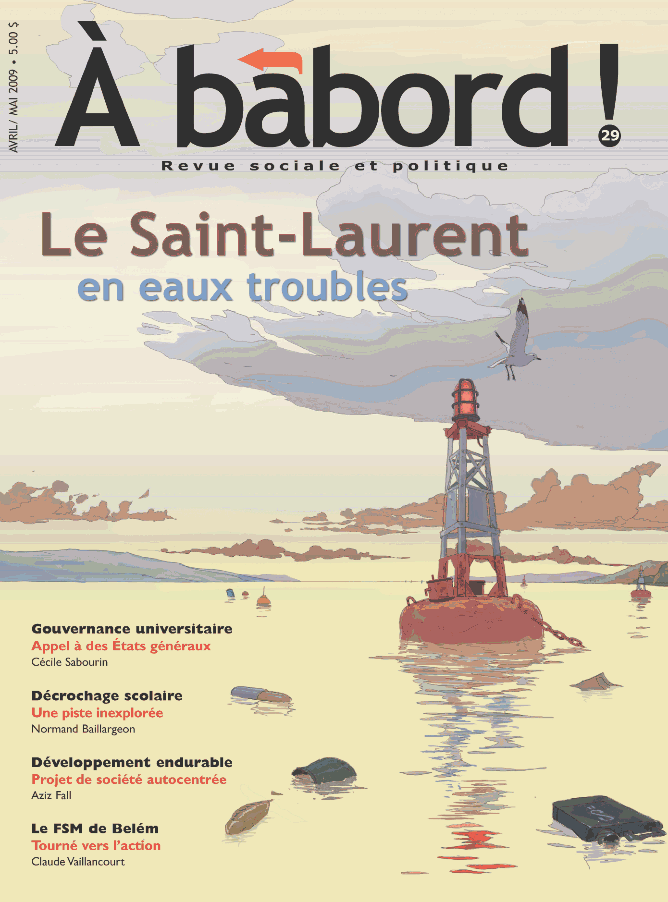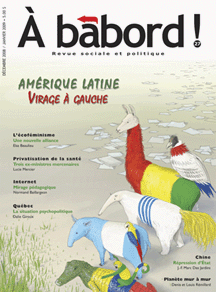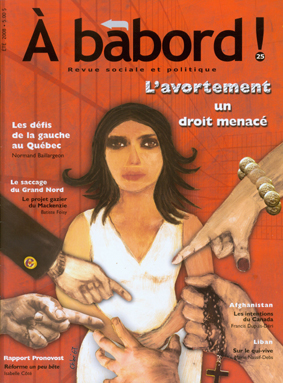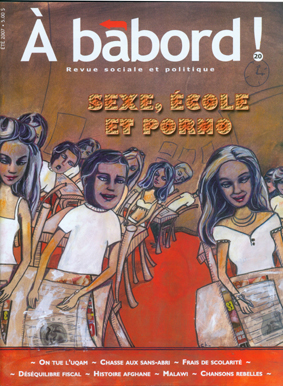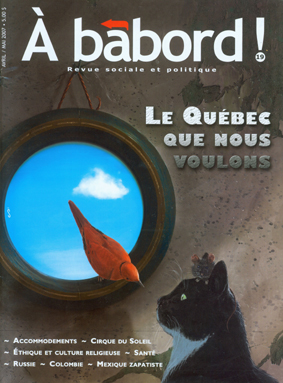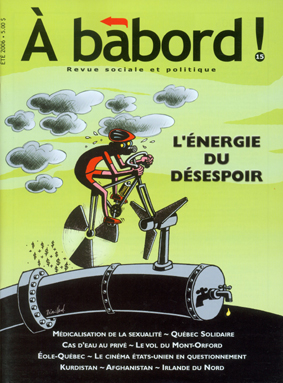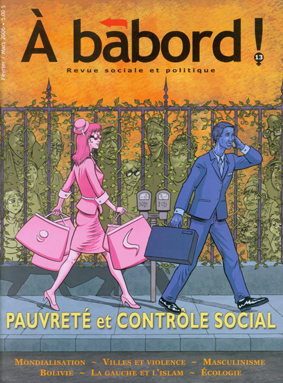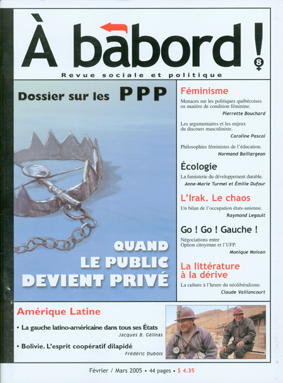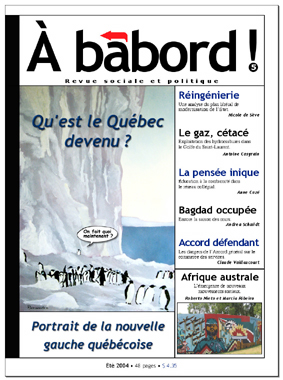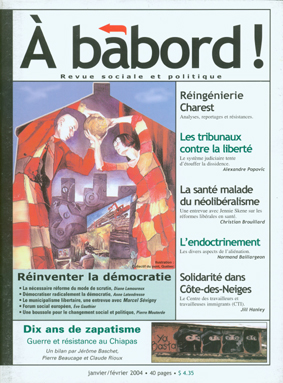International
Crise au Venezuela. L’empire et ses laquais
Ce serait aveuglement volontaire que d’ignorer les difficultés que traverse les Vénézuelien·ne·s. Il serait toutefois naïf de croire que le bien-être de la population vénézuélienne est la raison des récents événements entourant l’autoproclamation de Juan Guaidó à la présidence du pays.
La situation économique et sociale du Venezuela est très difficile. On n’en connaît cependant pas la mesure exacte puisque les sources statistiques officielles se sont taries depuis longtemps [1]. L’inflation est vertigineuse : 274 % en 2016 selon un rapport du gouvernement à la U.S. Security and Exchange Commission (SEC) et elle aurait dépassé 1 000 000 % en 2018 selon le FMI. Lorsqu’une économie dépend autant du pétrole, dont les prix ont été divisés par deux en 2014, il n’est pas étonnant que la confiance en sa devise s’étiole.
L’inflation révèle d’autres problèmes économiques. Selon le même rapport à la SEC, le produit intérieur brut se serait contracté de 16,5 % en 2016, suivant une réduction de 6,2 % l’année précédente et de 3,9 % en 2014. Depuis la fin des années 1990, l’industrie interne se contracte, même en période de croissance, incitant à l’augmentation des importations. Les devises viennent du secteur pétrolier, dont les exportations sont contrôlées par l’État depuis 2008. Celui-ci est donc un entonnoir déterminant qui importe des produits finis et des intrants productifs. La rente pétrolière ainsi distribuée par l’État n’est pas parvenue à maintenir le niveau d’extraction pétrolière, sciant tranquillement la branche sur laquelle l’ensemble du pays était assis.
Ces problèmes ont fait en sorte que les produits de base – nourriture et médicaments compris – sont de moins en moins accessibles. Les effets sont alarmants : entre 2015 et 2016, la mortalité infantile durant la première année de vie aurait augmenté de 30 %, et la mortalité des femmes enceintes de 64 %.
Pour suppléer l’absence de données officielles, des chercheurs·euses universitaires ont réalisé une enquête sur les conditions de vie (ENCOVI) selon laquelle, en 2016, 70,9 % des 5900 répondants déclaraient avoir manqué d’aliments, et 64 % avoir perdu du poids. Cette même enquête montre une amélioration en 2017 : plus de gens déclaraient avoir accès à 3 repas par jour, mais les sanctions économiques des États-Unis renforcées depuis la fin 2017 ont fort probablement empiré la situation. Le mouvement migratoire, estimé à 2,3 millions de personnes par l’Organisation internationale pour les migrations et à plus de 3 millions par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [2], confirme que les conditions sont difficiles.
Des racines historiques
À la source de ces problèmes, il n’y a pas que l’État, mais un face-à-face catastrophique [3] entre le gouvernement et les élites économiques. Ces dernières ont fomenté un coup d’État en 2002 contre la nouvelle constitution adoptée par référendum et la récupération du contrôle public sur le secteur pétrolier. Bien qu’appuyé par les États-Unis, le putsch a échoué, mais il n’en a pas moins engendré une polarisation extrême.
Dans ce contexte, les opposants refusent la légitimité de l’adversaire et rejettent les règles communes qui pourraient trancher les litiges. Malgré des périodes de croissance, les investissements publics se sont avérés incapables de stimuler l’investissement privé, tant national qu’international. À la suite de ce constat, les propositions socialistes naissent fin 2005, avec des vagues de nationalisation à partir de 2007 et différentes tentatives de créer un appareil productif alternatif ancré dans la mobilisation populaire (conseils communaux). Les ratés économiques de ce projet sont aujourd’hui évidents.
Divisions et autoproclamation
L’autoproclamation de Juan Guaidó en janvier dernier n’offre en rien une solution à ces problèmes. En fait, elle représente un pas supplémentaire dans la polarisation qui a nui aux programmes économiques des dernières décennies.
Juan Guaidó est membre de Voluntad Popular (VP), un parti qui cherche depuis ses débuts en 2009 à renverser le gouvernement. Avec 14 députés à l’Assemblée nationale (AN), c’est la quatrième force au sein de la coalition d’opposition de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). VP et son chef, Leopoldo López, avaient fait capoter les négociations entamées avec Maduro à la suite de la victoire de l’opposition aux élections législatives de 2014. En 2017, Juan Requesens, député du même parti, déclarait qu’ils faisaient tout en leur possible pour rendre le pays ingouvernable et que si cela ne faisait pas tomber le gouvernement, ils comptaient sur une intervention étrangère [4].
Dès 2015 sous Obama, le gouvernement américain déclarait le Venezuela « menace à la sécurité des États-Unis » et adoptait des sanctions économiques contre certains dirigeants. La liste des punis s’est allongée, mais c’est contre l’élection d’une nouvelle assemblée constituante en 2017 que Trump radicalise les mesures et coupe l’accès au marché des capitaux états-uniens, avant de décréter un embargo commercial début 2019 pour soutenir Guaidó. Ces mesures, contraires aux droits de la personne selon l’ONU, auront pour effet d’empirer les conditions de vie de la population [5].
L’impopulaire appel à une intervention étrangère ne faisait pas l’unanimité au sein de l’opposition [6]. Les tensions qui ont toujours existé au sein de la MUD ont crû lors de négociations avec l’exécutif à la fin 2018 et avec l’élection présidentielle de mai 2018 remportée sans grande légitimité par Maduro. Certains secteurs appelaient au boycottage, dont VP, alors que d’autres acceptaient de participer.
Ces désaccords stratégiques expliquent pourquoi la proclamation de Guaidó s’est faite dans la rue plutôt qu’à l’Assemblée nationale. La résolution de l’AN du 15 janvier, qui appuie le transfert des pouvoirs exécutifs au législatif, se garde bien de nommer Guaidó président de la République. Celui-ci préside l’AN parce que la MUD a négocié une rotation à cette fonction. Les autorités canadiennes se sont vantées d’avoir travaillé fort pour convaincre les autres partis d’opposition d’appuyer Guaidó [7]. Or sans le soutien international, celui des États-Unis en particulier, il était peu probable que Guaidó coalise l’opposition de la sorte.
Un État parallèle
L’appui international est toutefois limité. Les instances multilatérales (Conseil de sécurité de l’ONU, Organisation des États américains) n’ont pas accepté la stratégie américaine. La Russie, qui a investi plusieurs milliards dans le secteur pétrolier du Venezuela, et la Chine, créancier important, refusent que les États-Unis soufflent le chaud et le froid. Les États-Unis, dont l’intérêt pour le pétrole vénézuélien est publiquement déclaré [8], ont tout de même poursuivi leur ingérence, appuyant la création d’un État parallèle par la saisie et le transfert des actifs de l’État en leur sol à Guaidó. Leurs pressions ont également fait trembler certaines banques qui refusent de transférer les réserves d’or vénézuéliennes à Maduro.
Le ras-le-bol d’une très grande partie de la population vénézuélienne ne fait pas de doute. Il explique l’appui aux tentatives de remplacer le pouvoir en place. Le soutien d’une bonne partie de la population à Maduro ne fait pas de doute non plus, même s’il s’est effrité au cours des dernières années. Ceux qui cherchent à aider les Vénézuéliens ont proposé de soutenir un dialogue, solution à laquelle s’opposent les États-Unis, intéressés par les ressources du pays, et leurs alliés locaux.
La stratégie états-unienne, dont le Canada et le groupe Lima se font les tâcherons, vise à étouffer financièrement le gouvernement de Maduro, tout en transférant des ressources à un État parallèle faiblement institutionnalisé. Cela ne promet qu’une chose : les conditions de vie de la population iront en s’empirant. Les souffrances de celle-ci sont ainsi instrumentalisées dans un échiquier géostratégique dont la population locale fait les frais.
[1] La majorité des données du site Web de la Banque centrale et de l’inaccessible site de l’Institut national de la statistique n’ont pas été actualisées depuis 2015.
[2] Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, « Inicio Emergencias Situación en Venezuela ». Disponible en ligne.
[3] L’expression est du Bolivien Álvaro García Linera, qui parlait en espagnol d’un empate catastrófico pour décrire le duel l’opposant aux élites économiques de Santa Cruz, en Bolivie.
[4] Conectados_Vzla, « Requesens : Para llegar a una intervención extrajera hay que pasar por la violencia » », 7 juillet 2017. Disponible en ligne.
[5] ONU Info, « Las sanciones a Venezuela atentan contra los derechos humanos de personas inocentes », 31 janvier 2019. Disponible en ligne.
[6] Une enquête d’opinion d’Hinterlaces de janvier 2019 auprès de 1580 répondants soutenait que 86 % s’opposaient à une intervention militaire étrangère et 81% s’opposaient aux sanctions économiques imposées par les États-Unis.
[7] Mike Blanchfield, « Des diplomates canadiens ont discrètement soutenu l’opposition vénézuelienne », Le Devoir, 26 janvier 2019. Disponible en ligne.
[8] Fox Business, « John Bolton : I don’t think Maduro has the military on his side », 24 janvier 2019. Disponible en ligne.