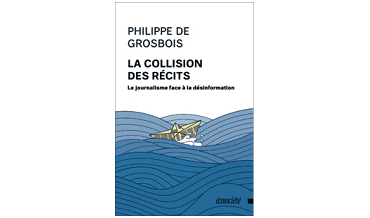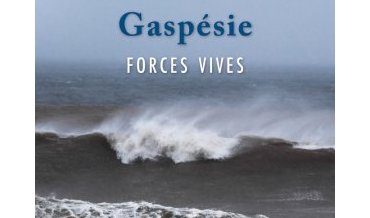Médias
Les nouveaux gatekeepers
Jusqu’à récemment, la question « faut-il publier ou pas ? » relevait du groupe relativement circonscrit des professionnel·le·s de l’univers de la diffusion médiatique. La donne s’est grandement complexifiée ces dernières années puisque la parole publique est accessible à un nombre beaucoup plus grand de gens, alors même qu’elle est encadrée, filtrée et exploitée avec une intensité inégalée par les plateformes corporatives que sont Facebook, Google, Amazon et Apple. Cette bouleversante irruption de nouveaux « gatekeepers » (ou « portiers des médias ») dans l’écosystème médiatique est un phénomène d’une portée politique déterminante. Parce que publier, c’est justement rendre public ce qui relevait jusqu’alors du privé.
Renouvellement de la formule « le privé est politique »
Le sociologue français Dominique Cardon est l’un de ceux qui fournissent les analyses les plus fines de ces transformations. Sur Internet, soutient-il, c’est à l’internaute que revient la décision de garder pour lui ou elle certains aspects de son existence ou de les (re)présenter à son entourage ou à autrui. Ces nouvelles opportunités, explique Cardon, permettent à l’individu de politiser un événement biographique ou une condition personnelle en la faisant surgir dans l’espace public.
Le mouvement #AgressionNonDénoncée, apparu l’automne dernier, en fournit un bel exemple. Lorsque l’animateur-vedette de la CBC Jian Ghomeshi fut mis à pied en raison de témoignages d’agression fournis par plusieurs femmes, certain·e·s se demandèrent pourquoi ces plaintes ne furent jamais formalisées par le biais d’instances judiciaires. S’ensuivit un flot de révélations sur Twitter et Facebook de victimes d’agression qui firent état de leurs propres difficultés à dénoncer leur agresseur. Pour chacun de ces témoignages, la décision individuelle fut la même : celle de faire passer un événement personnel dans la sphère publique, et du même coup, de le poser comme un problème politique. Le cas du mouvement #AgressionNon Dénoncée est d’autant plus intéressant qu’il soulève justement l’insuffisance des canaux traditionnels (judiciaires, notamment) par lesquels il est possible pour une victime de communiquer ce qu’elle a vécu. D’ailleurs, l’une des premières sorties menant au déboulonnage de Jian Ghomeshi fut un compte Twitter anonyme entretenu par l’une des victimes qui relatait des crimes allégués de l’animateur [1].
Ainsi, dans notre recherche des nouveaux gatekeepers des médias, on peut retracer un premier mouvement de fond, qui part du privé, de l’intime, du personnel, pour en faire un enjeu politique. Cette tangente en est une d’ouverture des vannes. Que l’on pense aux cas d’abus policiers avec le mot-clic #MyNYPD aux États-Unis ou à la page Facebook « Spotted Austérité », le principe est le même : se montrer sur la base d’une conviction politique et, par le fait même, illustrer concrètement un phénomène social qui pourrait demeurer abstrait.
Cette publicisation explosive du personnel comprend aussi un versant beaucoup moins reluisant, comme en témoigne la fronde masculiniste de nombreux gamers face aux critiques grandissantes de féministes à l’endroit du sexisme dans l’industrie des jeux vidéo : menaces de mort, harcèlement, dévoilement d’informations personnelles… Dans ces cas-ci, comme pour ces célébrités dont on a subtilisé des photographies à caractère sexuel pour les distribuer à grande échelle sur le web, le dévoilement de l’intime est non désiré [2]. Doit-on voir dans les trolls et les harceleurs une nouvelle forme de gatekeepers ? Telle semble être l’intention de ces derniers : intimider les voix discordantes et les exclure de l’espace public. Pour y remédier, il faut davantage que des vœux pieux, mais plutôt d’authentiques gestes de solidarité pour celles et ceux qui prennent la parole, de même que des poursuites judiciaires pour les intimidateurs. Mais sur le long terme, on voit mal comment ces contre-attaques pourraient parvenir à leurs fins, tant sont nombreux les groupes marginalisés qui saisissent les nouvelles opportunités de politisation du déni de justice vécu par leurs semblables. De #ICantBreathe aux États-Unis, cri de ralliement des Afro-Américain·e·s qui subissent la violence policière, à #YaMeCansé (« j’en ai marre »), qui réunit des Mexicain·e·s qui dénoncent la disparition de 43 étudiants de l’État de Guerrero dans un contexte de forte corruption gouvernementale, on voit émerger une vague de fond d’élargissement de l’accès à la parole publique.
La discussion politique dans une agora privée
Il y a pourtant une autre menace à cette prolifération de paroles, beaucoup plus sourde, plus subtile et plus profonde. De manière paradoxale, alors même que les possibilités de débats publics croissent sur le web, ceux-ci tendent à prendre place sur des espaces corporatifs extrêmement contrôlés. Comme l’explique Astra Taylor dans Démocratie.com, récemment traduit chez Lux éditeur, sur le plan économique, les grands gagnants de la mutation médiatique actuelle sont les plateformes qui ne créent pas de contenu, mais qui l’hébergent et le rendent disponible. Les barrières ont sauté, tous et toutes peuvent produire, publier, diffuser et partager du contenu, souvent gratuitement ou presque. Mais par quels intermédiaires ? Une étude faisait récemment état que presque 40 % du trafic Internet cellulaire nord-américain était accaparé par Facebook et YouTube. Le pouvoir que développent ces géants du Net (Google, Apple, Facebook et Amazon, principalement) est fondamental pour la question qui nous préoccupe ici, à savoir qui dispose de la capacité de déterminer ce qui parviendra à un auditoire ou pas. YouTube menaçait récemment de petites étiquettes de disques de bloquer l’accès à la diffusion de leurs clips si elles n’acceptaient pas ses termes, alors qu’Amazon ralentissait la distribution des produits diffusés par Hachette dans le cadre de négociations d’ententes [3].
Le deuxième mouvement de fond, en ce qui a trait à l’émergence de nouveaux gatekeepers, suit donc le parcours inverse du premier : celui qui voit la cacophonie du web être logée chez quelques grandes corporations qui y filtrent des éléments précis à des fins lucratives, voire politiques. Et c’est ici que les algorithmes entrent en scène. Qu’est-ce qu’un algorithme ? Il s’agit d’une série d’opérations mathématiques permettant de traiter des quantités massives d’informations (le fameux « big data ») et ainsi de résoudre des problèmes. Ces algorithmes ont maintenant atteint un tel degré de raffinement que les machines « apprennent » par elles-mêmes et se perfectionnent au fur et à mesure que les données sont accumulées.
Il est capital de mieux comprendre les impacts que peuvent avoir ces algorithmes sur l’accès à certains contenus et sur nos capacités d’expression et d’échanges en ligne. Eli Pariser, dans l’ouvrage The Filter Bubble, démontre que Google ne fournit pas les mêmes résultats de recherche selon ce que l’algorithme connaît de nos habitudes de navigation. Facebook estime qu’un usager moyen pourrait recevoir près de 1 500 nouveaux messages par jour sur son fil, que l’algorithme réduit aux 300 considérés les plus « pertinents » pour cette personne. Selon quels critères ?
La plupart du temps, ces algorithmes sont maintenus à l’abri du regard du public, même si leur portée est éminemment politique : c’est de plus en plus par leur intermédiaire qu’une nouvelle nous parviendra… ou pas [4]. Sur Facebook, l’algorithme sélectionne les envois les plus susceptibles d’augmenter le nombre de visites des utilisateurs sur le site, la durée de chacune de ces visites, le nombre de « J’aime » et de commentaires provoqués, etc. Jamais n’a-t-on eu meilleure occasion de constater le pouvoir que cache cet algorithme qu’en juin 2014, lorsque Facebook révéla un peu candidement avoir commandé une recherche sur près de 700 000 usagers et usagères du site [5]. Les chercheurs ont modifié l’algorithme d’un groupe de manière à ce que seules les publications aux émotions positives leur parviennent ; pour l’autre groupe, c’était l’inverse. On a ensuite cherché à vérifier si cela avait un effet de « contagion » auprès des utilisateurs. Au-delà des considérations éthiques autour d’une telle recherche (les cobayes n’ont jamais été mis au courant de l’expérience), ce cas révèle, mieux que tout autre, le caractère politique de tels algorithmes : sur Facebook, une analyse critique de l’austérité ne fait pas le poids face à une photo de nouveau-né.
Pour une sphère pleinement publique en ligne
L’algorithme, si machinique soit-il, n’est pas un outil neutre : il est conçu par des êtres humains qui répondent aux ordres de leurs employeurs, eux-mêmes régis par des impératifs de profit et de pouvoir politique. De même, la manière dont la plateforme est conçue reflète souvent les intérêts et les privilèges de ses concepteurs, riches hommes blancs scolarisés de la Silicon Valley. L’interdiction de pseudonymes ou de comptes anonymes par certains médias sociaux et ses impacts sur des communautés marginalisées (personnes trans, dissident·e·s politiques, etc.) en est une bonne illustration.
C’est pourquoi la réappropriation de ces espaces numériques de discussions et d’échanges est aussi importante. Celle-ci pourrait prendre la forme d’une expropriation en bonne et due forme, les relations humaines et l’échange d’idées étant trop précieux pour être laissés entre les mains de corporations privées. Mais la réappropriation doit aussi être pensée dans les termes des tenant·e·s du logiciel libre et de l’ouverture du code : il est devenu essentiel de mieux connaître et de débattre des mécanismes, algorithmiques ou autres, qui contribuent à mettre en forme nos échanges sur Internet. Ces questions sont extrêmement riches, et jamais dans l’histoire n’y a-t-il eu autant de personnes prêtes à y travailler. La « salle de nouvelles » lancée par Ricochet, dans laquelle les personnes qui ont soutenu financièrement le média peuvent proposer et soutenir un futur sujet d’article, est un bel exemple d’initiative visant à ramener vers les citoyen·ne·s la question que se pose tout gatekeeper : sur quelles bases doit-on décider de ce qui sera publié ?
À terme, il nous faut aspirer à un écosystème médiatique dans lequel chacun·e d’entre nous peut définir, individuellement, les aspects de sa vie qu’il ou elle souhaite voir amené à l’attention du public, et où nos espaces médiatiques d’échanges sont eux-mêmes conçus, construits et débattus collectivement.
[1] Voir l’excellent reportage « The unmaking of Jian Ghomeshi », The Fifth Estate, CBC, 28 novembre 2014.
[2] Voir Martine Delvaux, « À qui appartiennent les femmes ? », À bâbord !, no 57, décembre 2014-janvier 2015.
[3] Voir « From YouTube to Amazon, tech innovators need to be held to account », The Observer, 22 juin 2014.
[4] Voir Stuart Dredge, « Strictly Algorithm : how news finds people in the Facebook and Twitter age », The Guardian, 10 mars 2014.
[5] Voir Robert Booth, « Facebook reveals news feed experiment to control emotions », The Guardian, 29 juin 2014.