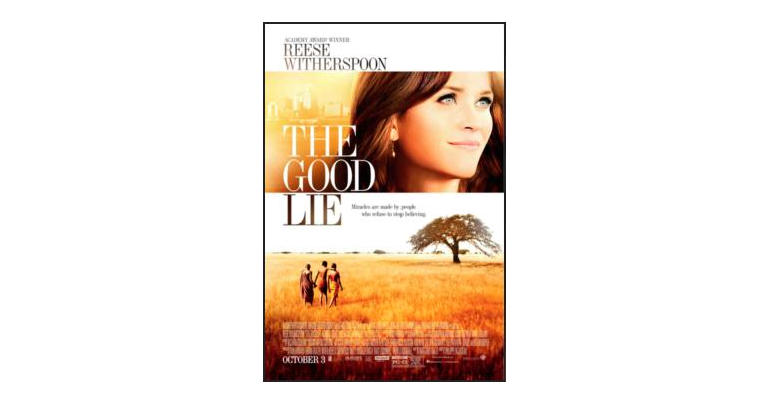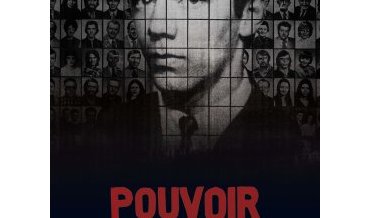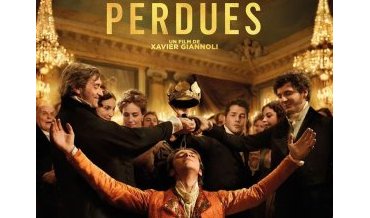The Good Lie
Une imagerie d’Épinal
À la suite de l’impressionnant succès international remporté par Monsieur Lazhar (2011), Philippe Falardeau s’est vu offrir un attrayant contrat par la compagnie californienne Alcon Entertainment pour tourner un film à gros budget en territoire américain. C’est pourquoi Falardeau a réalisé The Good Lie (2014), dont l’action se déroule surtout dans la ville de Kansas City, au Missouri.
Sommairement, cette œuvre de fiction à dimension interculturelle relate l’histoire de quatre jeunes Noirs d’origine soudanaise, lesquels, ayant fui la guerre qui sévissait dans leur pays, cherchent à s’établir aux États-Unis peu de temps avant les attentats du 11 septembre 2001. Évidemment, la chose ne va pas sans mal attendu que la réalité nord-américaine est très différente de celle de l’Afrique du Nord… Toutefois, le quatuor de compagnons témoigne d’une remarquable bonne volonté en tentant de s’intégrer à son pays d’accueil.
Le titre du film de Falardeau se réfère explicitement à un aphorisme du célèbre roman picaresque de Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn : dans cette œuvre, l’écrivain américain définissait « le bon mensonge » comme étant un propos sciemment erroné qui comportait une justification morale puisqu’il évitait qu’une (grave) injustice ne se produise. Or, c’est en s’inspirant d’un tel principe que les protagonistes du film de Falardeau parviendront à composer avec l’adversité à laquelle ils seront confrontés.
Les poncifs du mélodrame
Fidèle à lui-même, Philippe Falardeau établit ici une mise en scène soignée, qui lui permet de proposer au spectateur une représentation multidimensionnelle de la réalité. Dans cette perspective, le cinéaste orchestre les composantes plastiques et sonores de la narration de façon à circonscrire un axe spatiotemporel éminemment évocateur. La première partie du film décrit avec élégance et véracité les épouvantables épreuves vécues par les quatre protagonistes, alors qu’ils ne sont que des enfants. Le cinéphile ne manquera pas d’apprécier l’habileté avec laquelle Falardeau utilise les procédés stylistiques du retour en arrière et de l’ellipse pour nous montrer l’accablante traversée du Soudan effectuée par les héros.
Toutefois, la maîtrise grammaticale du réalisateur ne suffit pas à cacher les graves lacunes du scénario écrit par Margaret Nagle, qui a choisi de construire une histoire essentiellement réconfortante, voire un inoffensif mélodrame, plutôt que d’élaborer un drame réaliste et démystificateur. Cela explique que les auteurs de The Good Lie brossent un portrait erroné, trompeur des États-Unis contemporains. Dès lors, il n’est pas surprenant qu’un spectateur politisé récuse l’imagerie d’Épinal de la nation américaine que promeuvent Falardeau et Nagle dans cette œuvre. Plutôt que de poser un regard critique sur le peuple américain ainsi que sur le système politique qui le régit, le cinéaste et sa collaboratrice dépeignent de manière démesurément laudative l’attitude que les États-Unien·ne·s adoptent face aux étrangers. Par conséquent, il n’est pas étonnant de constater que le film de Philippe Falardeau ne comporte aucune scène traduisant la xénophobie ou le racisme dont peuvent faire preuve des membres de la majorité blanche à l’égard de représentant·e·s des minorités visibles au pays de l’Oncle Sam. Les Américaines et Américains de souche que côtoient les quatre réfugiés d’origine soudanaise sont généralement des gens bien intentionnés, qui sympathisent avec les nouveaux venus et cherchent à les aider plutôt que de tenter de leur nuire. Compte tenu des incidents à caractère raciste qui ont lieu aux États-Unis jour après jour, une telle reconstruction du réel apparaît particulièrement inadéquate. Du reste, l’américanisme dans lequel verse le long métrage de Falardeau dénature déplorablement la réalité que lui et sa scénariste auraient dû reconstituer.
La portée de la narration de Philippe Falardeau
Par le biais de ce récit, le réalisateur a tenté de traduire une vision du monde humaniste, optimiste, mettant en relief les sentiments de solidarité qui existent entre les humains. Malheureusement, il n’a pas su transcender les faiblesses de son intrigue afin d’atteindre ce noble objectif. En d’autres termes, le mélodrame de Philippe Falardeau se révèle trop artificiel, trop pétri de bons sentiments pour emporter l’adhésion du cinéphile averti. Sur le plan dramaturgique, les composantes narratives de l’œuvre de Falardeau apparaissent poussives puisqu’elles reposent presque exclusivement sur les petits problèmes quotidiens que vivent les principaux personnages de The Good Lie, après être arrivés aux États-Unis. En outre, le réalisateur dépeint ceux-là de manière stéréotypée plutôt que d’analyser l’évolution de leurs psychés respectives. Ce parti pris explique que les relations interculturelles qu’établissent différents personnages de la narration se résument à peu de choses significatives.
En dépit de ses importantes faiblesses, on remarquera que The Good Lie comporte quelques beaux moments narratifs, comme la scène au cours de laquelle Jeremiah choisit de quitter le supermarché dans lequel il travaillait parce que son superviseur était mécontent que l’homme d’origine soudanaise ait désobéi à ses ordres en donnant de la nourriture à une femme sans-abri, plutôt que de la jeter aux ordures. Cependant, de telles séquences demeurent trop rares pour faire en sorte que le film de Falardeau soit globalement appréciable. Incontestablement, le carcan du système de production hollywoodien s’avère pernicieux pour la créativité de Philippe Falardeau. En conséquence, il faut souhaiter que la réalisation, au Québec, du prochain long métrage de Falardeau, Guibord s’en va-t-en guerre, lui permettra de renouer avec un cinéma plus pénétrant que celui qui a caractérisé ses débuts à Hollywood.