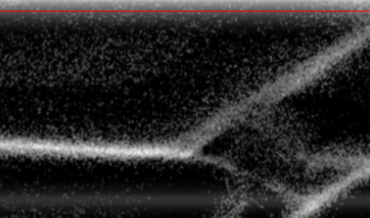Recherche et développement pharmaceutique au Québec
Le gouffre financier
Dossier : Santé - État d’urgence
Le développement de l’industrie pharmaceutique québécoise est souvent considéré comme l’histoire d’une réussite industrielle issue d’une politique ciblée d’aide aux industries à haute valeur ajoutée. Toutefois, à y regarder de près, les fonds publics investis pour soutenir ce secteur sont disproportionnés par rapport aux retombées économiques.
L’ industrie pharmaceutique a consacré près de 461 M$ en recherche et développement (R. et D.) pharmaceutique au Québec en 2010, soit 43 % du total canadien, à parité avec l’Ontario1. En prenant en compte la différence démographique, cela signifie que la R. et D. pharmaceutique par habitant est environ 50 % plus élevée au Québec qu’en Ontario. Beaucoup parlent d’une grande réussite industrielle, mais le Québec paie cher ses incitatifs financiers au secteur pharmaceutique à travers une série de mesures qui vont au-delà d’une simple politique de brevets : crédits d’impôt, généreuses politiques de prix ou subventions directes aux entreprises.
Le Canada fait partie des pays offrant les crédits d’impôt les plus généreux au monde pour la R. et D., particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, et le Québec offre le régime le plus généreux au Canada. Sans tenir compte des autres déductions fiscales, les seuls crédits d’impôt permettent aux firmes de récupérer environ la moitié de leurs dépenses en R. et D. au Québec. Bref, la moitié de la R. et D. privée est en fait payée par l’argent des contribuables. De plus, le Québec offre aussi de généreuses subventions directes (soit entre 27 M$ et 45 M$ par année) à ces entreprises pharmaceutiques à travers sa Stratégie biopharmaceutique québécoise, lancée en 2009.
Générosité des gouvernements envers les pharmaceutiques
Pour soutenir le secteur pharmaceutique, nous avons aussi établi depuis 1987 des politiques qui gonflent artificiellement le prix des médicaments brevetés au Canada et au Québec, afin de créer un environnement d’affaires favorable à l’industrie. Le Canada se classe systématiquement troisième ou quatrième pays au monde pour la cherté des médicaments brevetés. En échange d’une telle générosité, l’industrie pharmaceutique s’était engagée en 1987 à dépenser 10 % de ses ventes en R. et D. au Canada. Depuis 2001, l’industrie ne respecte plus son engagement et le ratio de R. et D. par rapport aux ventes va en diminuant constamment. Il était de 6,9 % en 2010 et des pertes d’emplois ont été annoncées depuis, entre autres chez Pfizer et GlaxoSmithKline. Docilement, le Canada continue de respecter sa part de l’entente. Pourtant, si le Canada arrêtait simplement de gonfler les prix artificiellement et cherchait plutôt à maximiser les économies, comme le fait la Nouvelle-Zélande, le Québec pourrait alors épargner plus de 1,5 M$ par année, soit environ 45 % des coûts des médicaments brevetés.
Il faut comprendre que nous parlons ici de politiques industrielles fédérales financées par le budget de la santé des provinces. Doit-on s’étonner que les dépenses en santé deviennent insoutenables à long terme ? Mais le Québec n’est pas en reste, il offre aussi aux firmes pharmaceutiques la « règle de 15 ans » qui permet d’étendre l’exclusivité des produits brevetés remboursés par le régime public d’assurance médicaments, une bagatelle qui coûte au Québec au minimum 130 M$ par année, mais qui pourrait grimper à 412 M$ dès cette année étant donné l’arrivée à échéance de plusieurs brevets importants. Rappelons que la croissance des coûts des médicaments au Québec est d’environ 10 % par année depuis 2000 et qu’elle représente près du quart de la croissance des dépenses en santé.
En bref, afin que l’industrie pharmaceutique québécoise effectue une dépense nette en R. et D. d’environ 230 M$ (en tenant compte des crédits d’impôt), le Québec accepte de dépenser en subventions de toutes sortes environ 1 657 M$ si l’on se compare à un pays comme la Nouvelle-Zélande qui utilise tous les outils disponibles pour maximiser les économies. Cela signifie que les politiques d’innovation du Québec dans le secteur pharmaceutique génèrent au total un retour sur l’investissement d’environ – 86 % en termes de R. et D. !
Certains pourraient être tentés de justifier ce gouffre financier en arguant que le coût actuel important sera compensé dans le futur, puisque nous assurons par ces politiques la croissance d’un secteur à haute valeur ajoutée. Cet argument ne tient pas la route. Selon les données compilées par le ministère du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le nombre d’emplois dans le secteur pharmaceutique est en nette régression au Québec. Malgré toutes les politiques d’innovation, nous avons aujourd’hui 1 000 emplois de moins qu’en 2003 dans le secteur pharmaceutique breveté. En plus des récentes fermetures et mises à pied parmi les grandes firmes intégrées, le Québec a vu disparaître 55 % des emplois dans le secteur des biotechnologies.
L’importance de la R. et D. est aussi en forte décroissance. Au Canada, le ratio de la R. et D. par rapport aux ventes est passé de 10,1 % en 2000 à 6,9 % en 2010. Les chiffres disponibles pour le Québec montrent que ce même ratio est passé de 22,5 % en 1999 à 16,5 % en 2006. Quelle que soit la manière dont on évalue la performance de ce secteur en termes de retombées économiques, on constate un net déclin dans les dernières années. Non seulement les politiques industrielles pour encourager le secteur pharmaceutique sont extrêmement coûteuses, mais elles sont de plus complètement inefficaces.
Pour une recherche pharmaceutique publique
Peut-on envisager que la recherche publique dans ce secteur prenne le relais ? Plusieurs le souhaitent puisqu’il y a actuellement urgence : les nouvelles cohortes de doctorants et doctorantes qui sortent des universités québécoises avec une formation à la fine pointe des savoirs en pharmacologie, biochimie ou pharmacogénomique doivent dorénavant s’expatrier pour trouver du travail. L’industrie pharmaceutique et biotechnologique en déclin n’arrive plus à les intégrer. D’autres objecteront que la recherche publique est un non-sens, car l’État n’aurait pas les moyens de financer ce secteur et il serait de plus incapable de l’administrer de façon dynamique et innovante.
La question du coût de l’innovation doit être relativisée. Selon Statistique Canada, le total de la R. et D. en santé (incluant les dépenses publiques et privées dans les secteurs biopharmaceutique et des appareils médicaux) était de 6 387 M$ en 2009 au Canada. Les entreprises commerciales ont contribué pour seulement 2 336 M$ (soit 37 % du total), alors que le reste – comme le détaille le tableau ci-contre – était financé par les administrations fédérale et provinciales, l’enseignement supérieur et les organismes privés sans but lucratif. De plus, lorsque nous tenons compte des crédits d’impôt, qui sont en fait la part de la R. et D. des entreprises payée par l’État, nous constatons que celui-ci paie déjà les trois quarts de toute la R. et D. dans ce secteur.
Afin qu’elles déboursent 18 % de la R. et D. en santé, les entreprises reçoivent donc des aides financières publiques absolument disproportionnées. Qui plus est, ces politiques sont complètement inefficaces. Si l’État mettait de l’avant des infrastructures publiques de recherche dans le secteur pharmaceutique, les coûts ne seraient pas un obstacle puisque nous n’aurions qu’à éliminer les politiques d’innovation coûteuses et inopérantes pour redistribuer cet argent de manière plus rationnelle.
Mais l’État, dans toute sa lourdeur bureaucratique, peut-il être compétitif dans un secteur dynamique, innovant, « schumpétérien » ? En fait, lorsqu’on regarde le piètre résultat de l’industrie privée en termes d’innovation thérapeutique, on est en droit de penser que le secteur public pourrait difficilement faire pire. En 2010, 76 % des nouveaux médicaments brevetés mis sur le marché au Canada ne présentaient aucune innovation thérapeutique importante par rapport aux médicaments déjà existants. Le modèle d’affaires de l’industrie reste basé sur la méga-promotion de nouveaux médicaments qui ne sont en fait que des compléments de gamme (me-too drugs). Une étude publiée dans le Health Affairs de février 2011 montre plutôt que la recherche publique a joué un rôle central dans la plupart des véritables innovations thérapeutiques. Ce n’est pas surprenant : la recherche pharmaceutique est un processus long, complexe et coûteux. Si cette recherche se structure à partir d’incitatifs financiers à court terme, alors la seule garantie de rentabilité est de re-breveter un médicament déjà existant en modifiant minimalement la molécule et de mobiliser une armée de représentants et représentantes pharmaceutiques pour modifier les habitudes de prescription des médecins.
Nous sommes dans un système complètement absurde. Les contribuables du Québec paient déjà l’essentiel de la R. et D. du secteur pharmaceutique et le gouvernement octroie des avantages disproportionnés pour soutenir une industrie qui ne génère des retombées intéressantes ni sur le plan économique, ni sur le plan thérapeutique. Pourtant, la seule solution envisagée par l’État québécois est de pelleter davantage d’argent dans le gouffre financier actuel en octroyant toujours plus d’avantages aux firmes dans le but d’attirer l’investissement. Soyons clairs, ce modèle dépassé ne fonctionne plus, il faut envisager d’autres options.