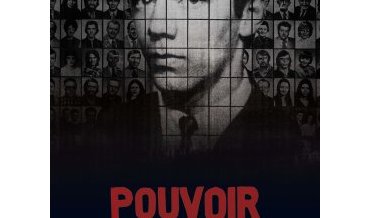Iana Mar
Travailleurs, vos papiers !
La grève des travailleur·ses sans-papiers en France, la force d’un pléonasme
Iana Mar, Travailleurs, vos papiers ! Paris, Libertalia, 2011.
Le 15 avril 2008, plus de 300 travailleur·ses sans-papiers de 16 entreprises de la région parisienne déclenchent des grèves accompagnées d’occupations pour exiger leur régularisation. Ces grèves coordonnées trouvent leur origine dans les multiples licenciements entraînés par l’entrée en vigueur de la loi Hortefeux, loi qui oblige les employeur·es à déclarer l’embauche des étranger·es aux préfectures qui vérifieront la légalité des titres de séjour. Si les grévistes revendiquent des régularisations, c’est qu’un article de cette récente loi introduit par ailleurs la possibilité d’une admission « exceptionnelle » au titre de séjour à la demande d’employeur·s de secteurs spécifiques où il y a un manque de main-d’œuvre (sous-entendu : peu coûteuse et corvéable), soit les secteurs non délocalisables où travaillent la majorité des sans-papiers (restauration, construction, nettoyage, sécurité, etc.). Les premières occupations produisent un effet de contagion : les grèves se succèdent dans la plupart de ces secteurs. Elles permettent d’établir un rapport de force favorable aux travailleur·ses et d’obtenir des titres de séjour temporaire pour près de 3 000 travailleur·ses. Ces grèves, sur lesquelles revient l’ouvrage signé Iana Mar – un collectif formé de trois jeunes sociologues français (Claire Flécher, Ludo Simbille et Daniel Veron) –, marquent aussi des avancées significatives sur le plan de l’organisation ardue de travailleur·ses au sein de secteurs où l’activité syndicale est entravée par les effets des mutations néolibérales du salariat (précarisation de l’emploi, individualisation de la relation salariale, dissémination des lieux de travail, etc.).
En dépit des rapports de domination qui affectent ce salariat bridé, « figure ultime de la précarité », les grèves de 2008-2010 ont révélé l’existence du contraire d’un asservissement insupportable. Si elle est « un faisceau de situations extrêmes », la précarité n’est pas pour autant une chape de plomb rendant impossible le conflit. En brisant un silence que cimente la peur, en jetant quelques lumières sur « l’obscurité privée de l’atelier, du chantier, du centre de rétention, de l’espace domestique », le mouvement des sans-papiers a manifesté la possibilité de se détacher de la domination.
La rencontre inédite entre la principale revendication du mouvement des sans-papiers et le mode d’action traditionnel du mouvement ouvrier français (grève avec occupation) n’est pas la seule singularité de ces grèves. Une autre innovation marquante tient au déplacement opéré sur la visibilité accordée à la personne migrante dans la configuration sociale : à la faveur d’une lutte ayant lieu dans la sphère du travail, elle a pu se défaire une fois de plus de « l’image criminalisante de clandestin » et apparaître comme un·e travailleur·se comme les autres, faisant aussi partie du salariat et de la vie sociale la plus courante, tout en restant privé·e d’un statut légal, donc de droits élémentaires. La dénomination « travailleur·se sans-papiers » – élevé par les auteur·rices au statut de pléonasme – a mis à mal un certain nombre de catégories négatives, aussi bien l’opposition faussement évidente entre nationaux et non-nationaux que l’image de profiteurs d’un système. Du reste, les grévistes ont éclipsé le « problème de l’immigration » – expression que la lepénisation des esprits a réussi à faire accepter comme allant de soi –, au profit d’un problème d’exploitation économique favorisée par « une vulnérabilité administrative », l’une et l’autre profitant aussi bien au patronat qu’aux États hypocrites qui retirent du travail des sans-papiers des sommes colossales en termes de cotisations et d’impôts prélevés sur les salaires.
Répondant à plusieurs finalités, l’ouvrage prolonge aussi bien la parole et la rationalité qui se sont dégagées de la lutte des sans-papiers que l’élan de leur émancipation. Cette prise de position s’accompagne d’un impératif de bilan, sorte de pas de côté qui permet d’énoncer des réserves, d’analyser le chevauchement de logiques parfois hétérogènes et les tensions qui en découlent. Ainsi les auteur·rices mettent-ils en lumière la contradiction qu’il y a à s’opposer au discours dominant sur « l’utilité de l’immigration » tout en montrant que l’économie ne peut se passer du travail des sans-papiers.
Si elle a eu son efficacité dans la lutte, matant les schèmes de l’exclusion et du racisme, l’identification sans-papiers/travailleur·se a toutefois comme piège d’enfermer la migrante et le migrant dans le seul domaine du travail. Ce confinement risque de faire l’impasse, même temporairement, sur tou·tes ces autres sans-papiers évoluant hors du salariat et du travail à proprement parler, et éventuellement de rendre conditionnels l’admission des migrant·es et l’octroi de leurs droits. Cet oubli n’empêche toutefois pas ce pléonasme de faire un pas considérable vers l’élaboration d’un cadre symbolique permettant de concevoir, de ressentir et de percevoir les déplacements et la présence des migrant·es dans nos sociétés d’une manière qui soit à la hauteur des exigences d’hospitalité et d’humanité les plus élevées, capable de donner un véritable fondement au droit universel et égalitaire d’avoir des droits.