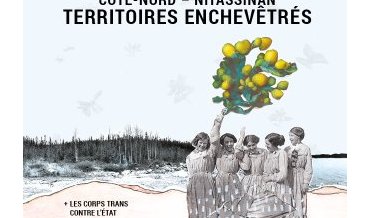Bolivie
Vague d’espoir sur fond de crise
par Denis Langlois
Elles ont failli ne pas avoir lieu ces élections, tenues en décembre 2005 alors qu’elles étaient prévues pour juin 2007. Rappelons qu’elles constituaient, à la suite de la paralysie du pays en juin dernier, la seule porte de sortie devant un parlement discrédité, un président démissionnaire et, surtout, en regard d’une polarisation croissante de la société bolivienne.
En septembre 2005 en effet, le Tribunal constitutionnel du pays rendait un jugement incontournable : il fallait revoir la répartition des parlementaires parmi les neuf départements que compte le pays afin de tenir compte de l’importance relative de la population dans chacun d’eux. Le régionalisme déjà à l’œuvre éclata au grand jour, menaçant la tenue même du scrutin. Finalement la raison l’emporta. Les élections ne furent que retardées du 4 au 18 décembre 2005.
Un pays divisé
Les résultats du scrutin donnent à Evo Morales, du MAS (Movimiento al socialismo), la présidence du pays avec 54 % du vote populaire. Le MAS est arrivé en tête dans 5 des 9 départements du pays et a provoqué une certaine surprise dans 2 autres (Tarija et Santa Cruz). Il a fait élire 72 députés sur 130 et 12 sénateurs sur 27. Aucun parti n’a obtenu une majorité aussi forte depuis la fin des dictatures en 1982.
La partie andine du pays (La Paz, Oruro, Potosi, Cochabamba) ainsi que le département de Chuquisaca se sont retrouvés en grande partie derrière le candidat Aymara. C’est là que vivent la majorité des Autochtones, Aymaras et Quechuas en particulier. Par leur travail dans des mines autrefois rentables, ils ont été au cœur de la révolution de 1952 et ont permis à l’État national de se doter d’assises financières plus ou moins stables jusque dans les années 1980. La crise économique et financière entraîna alors une révision majeure de la politique économique bolivienne vers la vente d’entreprises publiques et une privatisation appuyée fortement par le FMI, la Banque mondiale et les investisseurs étrangers.
Avec le virage économique, ces populations andines n’ont pas connu de réelle amélioration de leur sort. Dans la dernière décennie, les conflits sociaux se sont multipliés : sur la terre, sur l’eau, sur l’agriculture, sur la feuille de coca, sur les impôts et sur le gaz, cette nouvelle manne qui pourrait sortir le pays de sa dépendance. D’où leur appui à un Evo Morales perçu comme un contestataire conséquent d’une politique économique libérale ayant dominé depuis la chute définitive de la dictature.
La partie orientale du pays (Santa-Cruz, Tarija, Beni) a toutefois connu un certain développement économique et une augmentation de sa population. C’est là qu’existent d’importantes ressources de gaz naturel, dont l’exploitation est l’objet d’intérêts multiples qui se croisent avec la revendication d’une plus grande autonomie régionale. Bien que plusieurs peuples autochtones y vivent, notamment les Guaranis sur les territoires desquels se situent les réserves gazières et les Chiquitanos aux prises avec la défense de leurs terres forestières, ces peuples sont loin d’y constituer une majorité de la population. Malgré une campagne orchestrée pour battre Morales, ils lui ont accordé leur confiance davantage que prévu.
Mais ces départements ont quand même appuyé largement Jorge Quiroga du PODEMOS (Poder Democrático Social), ex-président bolivien de 2001 jusqu’aux élections générales de juin 2002. Ayant préféré créer PODEMOS plutôt que de se présenter sous la bannière de son ancien parti discrédité, Quiroga est le représentant de la droite qui tient à préserver le modèle économique présentement en vigueur. Quant à Doria Medina, florissant entrepreneur du ciment, il a récolté à peine 7 % des suffrages au niveau national et le MNR (Movimiento nacionalista revolucionario), le parti de la révolution de 1952, à peine 6 %.
En septembre et novembre 2005, les sondages les plus sérieux prédisaient un vote très divisé. D’un côté Morales, avec les classes les moins favorisées, les moins scolarisées et les populations autochtones. De l’autre Quiroga, avec les classes moyennes et favorisées, plus scolarisées et d’origine espagnole. Les résultats du 18 décembre auront surpris par l’ampleur de la victoire du MAS, mais ils n’auront pas solutionné cette division profonde de la société bolivienne.
Les défis du nouveau gouvernement
En 2002, Morales était arrivé second, mais il avait refusé tout compromis avec les partis jugés néolibéraux (NFR et MIR aujourd’hui quasi disparus). La conjoncture n’est plus la même en ce début d’année 2006. L’espoir que représente Morales, à tort ou à raison, aux yeux d’une majorité d’exclus ne peut plus être nié par ses opposants. Le vote témoigne bien d’une résurgence et d’une nouvelle détermination des mouvements sociaux et autochtones, mais il indique aussi une situation inquiétante quant aux perspectives de cohabitation intercommunautaire.
Les défis auxquels fera face le nouveau gouvernement sont immenses. Comment faire en sorte que l’exploitation du gaz serve au développement endogène du pays et au relèvement du niveau de vie de ses populations exclues ? Comment assurer que celles-ci aient voix au chapitre et soient représentées dans les institutions de la société ? Quelle politique économique peut représenter une alternative viable à l’échec de la privatisation quand un État et ses institutions, dont l’intégrité est mise à mal, jouissent de si peu de crédibilité ?
À la différence de ses voisins du cône sud, la Bolivie est un pays dépendant de l’aide économique et financière étrangère. Cela pose un défi majeur à une politique qui se veut nouvelle et indépendante. Deux multinationales de l’eau ont bien été chassées par des luttes sociales légitimes, mais l’alternative se fait toujours attendre. Des quartiers entiers d’El Alto ne comptent encore que sur l’eau de pluie. En sera-t-il de même dans le cas de la « nationalisation » du gaz ? La production de la feuille de coca trouvera-t-elle d’autres débouchés que celui du narcotrafic, en Europe notamment comme le souhaite Morales ? Le référendum annoncé sur l’autonomie régionale et la décentralisation aura-t-il lieu avant la mise en place d’une Assemblée Constituante, et comment son résultat éventuel sera-t-il interprété ?
Le résultat des élections doit aussi être vu à la lumière de la conjoncture internationale. D’abord celle du cône sud de l’Amérique latine : Brésil, Argentine, Chili, Uruguay, où de semblables marges d’espoir se sont exprimées par les urnes dans les dernières années. Ensuite celle de l’Europe, notamment de l’Espagne dont les intérêts économiques sont relativement importants en Bolivie, surtout en ce qui concerne le gaz (compagnie Repsol). Enfin, et de loin la plus délicate, celle des États-Unis qui voudront probablement éviter en Bolivie, à tout prix, une évolution à la vénézuélienne. Le président Morales conservera-t-il l’appui des populations qui l’ont porté au pouvoir devant les exigences et les stratégies de la droite pétrolière et autonomiste tout autant que face à l’opposition états-unienne ?
De quel sursis Morales dispose-t-il ?
Lorsque Gallup ou Ipsos demandaient aux Boliviennes pour qui ils voteraient en second lieu, Morales obtenait la cote la plus faible. C’est un autre signe de grande polarisation du vote. Or, au cœur des régions où la revendication d’autonomie se renforce (Santa-Cruz, Tarija, Béni), Morales n’a pas autant d’appuis. Par ailleurs, les élections de 2005 offraient une nouveauté : l’élection au suffrage universel des préfets départementaux, auparavant nommés par le gouvernement élu. Et là, Morales ne l’a pas emporté aussi fermement.
Les pétrolières, les autonomistes, les politiciens rejetés et les États-Unis disposent en fait d’une marge de soutien au rejet d’une nouvelle politique et ne manqueront pas de l’exploiter. La « droite » peut faire tomber un gouvernement, tout comme la « gauche » l’avait fait en 2003 et en 2005. Mais elle a aussi intérêt à ne rien brusquer, l’expérience vénézuélienne lui servant à cet égard de leçon. D’où la probabilité d’un certain sursis, quoiqu’en Bolivie cela se calcule plus en mois qu’en années. Mais il n’y a pas que la droite, il y a aussi la « gauche » très radicale, laquelle contrôle la COB (Central obrera boliviana) en déclin et la CSUTCB (Confederación sindical única de los trabajadores campesinos de Bolivia), dont le leader Felipe Quispe envisagerait déjà la clandestinité devant la crainte que le MAS change son fusil d’épaule une fois au pouvoir.
Pour le nouveau président Morales, deux échéances demeurent cruciales : celle de la « nationalisation » promise du gaz et celle de l’Assemblée Constituante que revendique l’ensemble des populations exclues de Bolivie. De la résolution positive de ces deux enjeux dépendra la capacité du nouveau président à se maintenir au pouvoir.
La nationalisation du gaz a présentement valeur de symbole. Elle est incontournable pour les uns tout en étant rejetée, cela se comprend aisément, par les pétrolières et les secteurs politiques nationaux et internationaux associés. Mais les intérêts sur le terrain sont plus complexes. Les Guaranis exigent des ententes sur l’exploitation de leurs territoires ainsi qu’une participation privilégiée aux bénéfices de cette exploitation ; ils peuvent facilement en paralyser l’exploitation ou la distribution. Pour leur part, les départements producteurs (Tarija, Santa Cruz) valsent actuellement entre le contrôle propre des redevances pétrolières et son partage avec les départements non-producteurs. Quant à ces derniers, la perspective d’une redistribution des bénéfices qui ne serait pas équitable est irrecevable et pourrait conduire à de nouvelles paralysies du pays si nécessaire.
Quant à la Constituante, elle est aussi objet de divergences majeures. L’élite des régions autonomistes n’y accorde pas de crédibilité, la voit même menaçante face à sa résolution d’autonomie régionale qu’elle est prête à imposer si le nouveau président Morales n’entend pas la négocier en sa faveur. Pour l’ensemble des peuples autochtones cependant, qu’ils viennent des Andes ou d’Orient, ainsi que pour plusieurs organisations sociales et syndicales, elle est vue comme l’occasion de « refonder » le pays sur des bases plus égalitaires. L’État national déjà faible parviendra-t-il à résister aux fortes pressions centrifuges d’une partie de la classe dominante ? Bien malin qui pourrait le prévoir. Mais une chose est sûre : sauf pour une minorité, par ailleurs influente, la division du pays est combattue de tous les côtés.
Une vraie démocratie longue à construire
Les élections de décembre 2005 ne seront pas une solution miracle pour un pays profondément divisé sur les enjeux de son développement et sur des perspectives démocratiques. L’entrée en fonction d’un nouveau président d’origine autochtone représente en soi une « petite révolution ». Mais en même temps, l’acceptation de règles du jeu en démocratie est encore loin d’être gagnée.
Du côté des « perdants », on cherchera certes à enferrer le nouveau pouvoir dans ses contradictions au point de diminuer la confiance acquise auprès de ses propres partisans ; on privilégiera l’exportation du gaz, plus payante que sa redistribution au pays ; on sera tenté d’investir ses sous à l’étranger plutôt que de favoriser le développement économique endogène ; on voudra maintenir son contrôle sur les nominations politiques malgré le changement de garde.
Du côté des « gagnants », les secteurs qui auront porté cet espoir jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir en bénéficieront-ils ? Certes pas à court terme. La crise financière de l’État, combinée à la lutte des investisseurs étrangers et nationaux pour maintenir leur pouvoir économique, qu’ils appellent pudiquement « sécurité juridique », affaibliront la marge de manœuvre d’un pays très largement dépendant. Les possibilités de relever le niveau de vie de ces populations marginalisées et de renforcer leurs droits économiques et sociaux majeurs (travail, éducation, santé, logement, accès à l’eau) resteront fort probablement encore réduites à court terme.
Il peut sembler pessimiste d’analyser une « petite révolution » en ces termes, mais la démocratie réelle, aujourd’hui mise à mal chez nous, n’a pas connu de trajectoire historique linéaire avant de s’imposer comme modèle de développement. Dans le cas bolivien, elle fait face à un défi supplémentaire : les peuples autochtones n’y ont pas été éliminés, comme ici, mais constituent toujours la majorité, une majorité exclue et discriminée. Les perspectives de développement y sont encore plus complexes du fait de la situation internationale actuelle, du fait des différences d’intérêts parmi les peuples autochtones eux-mêmes et enfin du fait des contradictions non encore prises en compte entre leur conception de la démocratie et celle que nous avons cherchée à leur faire valoir.