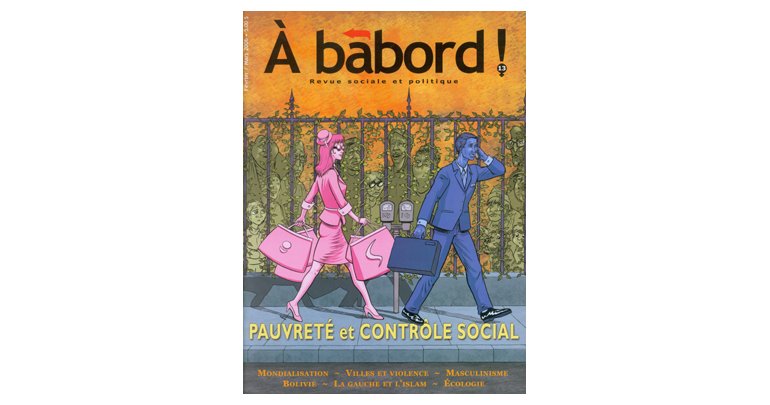Bolivie
Une révolution aux racines profondes
par Adolfo Gilly
Les révolutions sont des changements violents dans les rapports de force entre les classes – entre dominants et subalternes – dans une société déterminée. Ces changements mettent en crise la forme politique de la domination existante. La crise peut aussi s’exprimer sur le terrain électoral. C’est ce qui vient de se passer en Bolivie avec la victoire écrasante des indigènes, des humiliés, des exploités, des spoliés, des mâcheurs de coca, des femmes au chapeau rond et de leurs alliés à tous, qui ont porté Evo Morales à la présidence de la République.
Normalement, les élections sont un lieu de rénovation et de confirmation de la domination existante. Elles servent à changer le personnel politique et administratif du gouvernement, qui sera choisi entre les différents membres de la classe politique alors mis en concurrence. Mais elles ne permettent pas de décider quelle classe ou strate sociale exerce le pouvoir de commander, celui dont la totalité des politiciens respecte le cadre (sous peine de se transformer en parias ou intouchables). Par exemple, au Mexique, le Pacte de Chapultepec, véritable Manifeste Capitaliste de la haute finance mexicaine, est aujourd’hui le cadre fixé par les grands maîtres du pouvoir et de l’argent aux trois candidats à la présidence : « Disputez-vous tant que vous voudrez, choisissez l’équipe qui vous plaira, mais à la condition de signer ce pacte et de tenir vos engagements envers nous ». C’est l’équivalent national, mais explicite et sans vergogne, des contrôles rigides que le FMI et sa police, le Pentagone, imposent à tous les pays dominés.
En Bolivie, les récentes élections ont été une confirmation politique, légale, démocratique, constitutionnelle, institutionnelle – et tous les autres adjectifs que l’on voudra de la science politique – d’une violente et persistante lame de fond contre la domination néolibérale dans l’État raciste de matrice coloniale qu’a toujours été l’État bolivien. Depuis l’an 2000, cette vague a déferlé, au gré d’une succession de « guerres », car c’est là le nom lourd de sens que le peuple lui-même a donné à ses mouvements : la guerre contre la privatisation de l’eau à Cochabamba en 2000 ; la guerre de défense des plantations de coca dans le Chapare contre l’armée et la police en janvier 2003 (13 planteurs de coca tués, 60 blessés) ; la guerre contre l’impôt sur les salaires à La Paz en février 2003 (plus de 30 morts) et, point culminant en octobre dernier, la prise de La Paz par les indigènes et la chute du gouvernement de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ce même mouvement de fond a empêché la stabilisation conservatrice de son successeur Carlos Mesa, a imposé au Congrès la mise à l’écart de deux présidents potentiels qu’il gardait dans sa manche, et a fini par obliger l’actuel président intérimaire Eduardo Rodriguez Veltzé à organiser des élections dans des délais qu’il ne voulait pas et à des conditions qu’il n’imaginait pas (au prix, pour le peuple, de plusieurs morts de plus).
C’est ainsi qu’a été porté à la présidence le dirigeant d’un mouvement « hors-la-loi internationale », celui des planteurs de coca, car la coca, feuille sacrée et nourriture quotidienne des populations andines, est une plante illégale selon le Département d’État de Washington, sa succursale l’OEA, et allez savoir combien d’autres institutions impériales ! Quoi que fasse ou doive faire Evo Morales par la suite, son premier cri à l’heure du triomphe définissait la couleur de cette victoire : « Causachun coca, huanuchun yanquis » (pour la cause de la coca, à bas les yankees !).
Ce cri a résonné comme nul autre, c’est sûr, là-bas sur l’altiplano, à 4 000 mètres d’altitude, dans la moderne, très organisée et très pauvre ville indigène d’El Alto, création des paysans et mineurs déracinés par le néolibéralisme, des traditions communautaires indiennes, de la soif de communauté et de modernité des migrants internes venus la peupler, des efforts et du travail quotidiens de ses 800 000 habitants au bord même de la gigantesque cuvette où, 400 mètres plus bas, la ville de La Paz s’étire jusqu’aux chaudes vallées.
Cette élection démocratique est la conquête d’une révolution qui n’est pas finie et qui espère, à l’avenir, pouvoir poursuivre son chemin non plus à force de morts mais à force d’assemblées, de votes et de décisions collectives. Les Boliviens sont un peuple étonnamment organisé et sous des formes à peine perceptibles pour les observateurs de la politique institutionnelle. À tel point que les instituts de sondage ont été victimes, à mon avis, d’une conspiration de masse spontanée : les gens leur ont menti, ont donné de fausses intentions de vote, leur ont fait croire qu’Evo Morales totalisait entre 38 et 40 pour cent (majorité relative : le Congrès attribue la présidence), puis leur ont montré dans les urnes qu’il dépassait les 53 pour cent (majorité absolue : « c’est nous qui décidons, seuls, par nos propres votes, carajo et si vous essayez de tricher, gare à la guerre »).
Une autre guerre en vue ? Pas pour tout de suite, quoique Condoleeza Rice se dise vigilante, car l’autre élément de la situation est que les classes dominantes, qui le sont toujours, ont peur. Elles ont vu, d’abord incrédules puis avec une irritation apeurée, la montée de cette marée humaine qui, bien que désarmée, n’a pu, au cours des cinq dernières années, être stoppée par les balles ni désorganisée par les inévitables et naturels différends entre ses propres dirigeants. Les classes dominantes ont peur à présent de faire appel à la violence, car en Bolivie, la peur a changé de direction.
Cela ne durera pas, et il n’est pas bon que cela dure. Mais c’est ainsi pour l’instant, et ceux qui dominent encore, même s’ils ont perdu la présidence, tentent d’étouffer dès maintenant le nouveau gouvernement sous les conditions et les pressions de leurs alliés extérieurs (car il n’y pas aujourd’hui en Bolivie de magnat capable de taper du poing sur la table pour imposer à la nation opprimée un Pacte de Chapultepec) et de leurs groupes locaux les plus insolents et réactionnaires, comme l’oligarchie raciste de Santa Cruz de la Sierra et d’autres régions.
Quant à la suite, on verra bien. Mais pour le voir, ça n’avance à rien de discuter des personnalités du président et du vice-président, de soupeser chaque jour leurs paroles, de scruter l’âme de leurs conseillers, de faire des comparaisons avec Néstor Kirchner ou avec Luiz Inacio Lula da Silva (qui ont chacun assumé le gouvernement dans des élections, des conditions, et des pays radicalement différents). Pour le voir, aujourd’hui, il faut évaluer la force avec laquelle la marée peut continuer à monter et les questions que le mouvement populaire, nécessairement hétérogène, devra affronter dans l’immédiat [1] .
La Bolivie est toujours en pleine révolution, la première du XXIe siècle, et une révolution est un processus de fond qui oblige chacun, qu’il le veuille ou non, à prendre position, à l’intérieur comme à l’extérieur. La lumière claire et intense qu’elle diffuse ne tolère pas les demi-teintes, les subterfuges politiques, les astuces rhétoriques.
Une révolution n’est pas une secousse qui se produirait à l’intérieur d’un État, de ses institutions et de son personnel politique. Elle vient d’en bas et du dehors. Elle survient quand passent au premier plan de la scène, avec la violence de leurs corps et la colère de leurs âmes, celles et ceux qui sont toujours, précisément, en bas et en dehors : les oubliés de toujours, les dirigés, ceux que les dirigeants ne considèrent que comme somme de votants, clientèle électorale, masse manipulable, de la chair à enquêtes. Elle survient quand celles et ceux-là font irruption, se donnent un but politique, s’organisent selon leurs propres décisions et connaissances et, avec lucidité, réflexion et violence, font pénétrer leur monde dans celui de ceux qui commandent et, comme ils viennent de le faire une fois encore en Bolivie, parviennent à leurs fins. Et ce qui viendra après, viendra après.
[1] Les défis d’Evo Morales :
• La relation à la terre : la défense, la stabilisation et la légalisation des plantations de coca ; la réforme agraire complète, dans l’altiplano et dans les vallées et les plaines d’Occident.
• La relation des organisations avec le nouveau gouvernement : la prévisible expansion des multiples organisations du peuple : coordinations, assemblées de voisinage, syndicats, municipalités, églises, fédérations, écoles et universités, un monde en ébullition après la victoire électorale, avec les inévitables différends internes qui sont le prix légitime de la vie démocratique.
• La relation de la nation avec elle-même : les photos des festivités populaires disent vrai quand elles montrent les femmes au premier plan, espace qu’elles ont gagné de haute lutte et défendront de même ; le combat, organisé, matériel, et non simplement juridique, contre l’oppression raciale inhérente à l’actuel État bolivien ; l’Assemblée constituante et la nouvelle constitution ; la redistribution des ressources et des charges fiscales ; l’éducation pour tous et toutes, la santé, les droits sociaux effectifs.
• La relation avec le monde, face aux États-Unis, à ses instruments financiers et militaires de pression et à son allié fidèle et loyal serviteur, l’actuel gouvernement mexicain du président Vicente Fox ; près de Cuba et du Venezuela ; près des mouvements andins, indigènes et populaires de l’Équateur et du Pérou et du mouvement paysan du Brésil ; et à la recherche d’une prise de position des gouvernements du Brésil, de l’Argentine et de l’Uruguay qui devront, dans leur relation géopolitique et économique avec la Bolivie, aujourd’hui plus que jamais, se définir sur leurs relations réelles et leurs intentions à l’égard de leurs propres peuples, du Mercosur et du futur indépendant et démocratique de l’Amérique Latine.