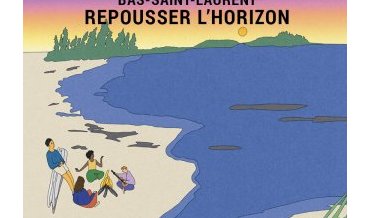Au Parti Québécois
Tergiversations écologiques
Si l’année 2012 fut marquée par la question étudiante qui provoqua la plus grande crise sociale des 30 dernières années, l’année 2013 aura été sans conteste celle des enjeux énergétiques. Pour comprendre cette transformation du débat public qui a complètement basculé en l’espace d’une année, il faut replacer la trajectoire économique, politique et idéologique du Parti québécois à l’intérieur de ce que nous pourrions appeler une « charnière historique » entre la fin d’une période libérale et la consolidation d’un nouveau régime.
Volonté hégémonique du PQ
Le mécontentement populaire qui renversa le gouvernement Charest reposait sur un ensemble de contradictions relatives à l’éducation, la corruption et la crise écologique. Les importantes mobilisations contre la hausse des frais de scolarité et les gaz de schiste, l’impopularité du Plan Nord et les allégations de collusion venaient contester l’hégémonie culturelle et idéologique d’un projet qui n’arrivait plus à susciter le consentement spontané de la population. La crise d’autorité se manifesta par le recours à la force qui devenait le seul moyen d’asseoir la domination de l’État, le pari électoral servant à désamorcer la crise et remettre les compteurs à zéro.
Il suffit de remarquer les mesures adoptées immédiatement après l’élection du Parti québécois : annulation de la hausse des frais de scolarité, Loi régissant le financement des partis politiques, fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2. Il s’agissait évidemment de refermer la brèche historique de 2012 en ressoudant la légitimité de l’ordre sociopolitique, c’est-à-dire le lien de confiance entre gouvernants et gouvernés. Pour ce faire, la stratégie péquiste eut recours à une prolifération de consultations publiques visant à dégager des « consensus » sur une foule d’enjeux : Sommet sur l’éducation supérieure, Forum sur les redevances minières, Commission spéciale d’examen sur le printemps étudiant, Commission sur les enjeux énergétiques, etc.
Cette approche de concertation avec les différents acteurs de la « société civile » n’est pas anodine ; elle vise à fabriquer un nouveau « sens commun », à forger une « culture majoritaire » par une réforme « intellectuelle et morale » du peuple québécois. Le projet de Charte des valeurs québécoises représente ainsi le cœur de cette approche, visant à consolider le leadership politique et culturel du Parti québécois. Le travail idéologique, la construction du discours dominant, la maîtrise du débat public et l’élaboration d’une « vision du monde » sont des parties intégrantes d’une même logique de fabrication du consentement populaire.
La « bullshit » selon Harry Frankfurt
Ce travail d’équilibriste, de conciliation d’intérêts contradictoires, d’affirmation et d’écoute amène des résultats plutôt incohérents du point de vue de la rationalité économique et écologique, notamment en matière de politiques énergétiques. Nous pouvons le constater par l’incompatibilité manifeste entre les objectifs de la politique industrielle « Priorité emploi » (réduction des émissions de gaz à effet de serre, électrification des transports, efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables) et l’ouverture du gouvernement à l’exploration, l’exploitation et le transport d’hydrocarbures sur le territoire québécois. Pour résoudre cette contradiction de l’économie verte, d’anciens écologistes récupérés par le Parti québécois ont tenté de réduire leur dissonance cognitive par un travail de rationalisation acrobatique : « La transition énergétique du Québec devra réussir à concilier deux objectifs en apparence contradictoires, soit la production de pétrole québécois et la réduction des gaz à effet de serre [1] . »
Cette conciliation forcée repose sur une approche managériale des hydrocarbures, visant à gérer les risques de l’exploitation pétrolière au lieu de sortir de notre dépendance au pétrole pour des raisons de justice sociale et climatique. Cela doit évidemment passer par des normes environnementales « plus strictes », le rehaussement de la limite de responsabilité civile en cas de déversement, et surtout un débat public visant à assurer l’acceptabilité sociale du projet. « Le débat sur les gaz de schiste a dérapé en grande partie parce que les décisions gouvernementales avaient été prises en catimini, sur la base d’informations très partielles et partiales. Il ne faut pas craindre la transparence et le débat public. Au contraire, c’est du choc des idées que naissent les grandes avancées sociales. La modernisation écologique de l’économie ne se fera pas sans débats [2] . »
Pour le meilleur et pour le pire, le Parti québécois a négligé de soigner l’image de sa dernière consultation publique concernant le projet d’inversion de la ligne 9B d’Enbridge. Le ministre de l’Environnement, maître d’œuvre des relations publiques pour les compagnies pétrolières, n’a pas jugé nécessaire de convoquer le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ; une simple commission parlementaire annoncée à la dernière minute apparaissait suffisante pour atténuer la critique, mitiger la contestation et s’assurer de passer à autre chose le plus rapidement possible. Le caractère bâclé de cette consultation aura même été aggravé par les remarques douteuses des députés Luc Trudel et Scott McKay, attaquant la crédibilité du porte-parole de la Coalition vigilance oléoducs, Olivier Huard. L’accusant de partisanerie à cause de son affiliation politique à Québec solidaire, ils préférèrent présenter des arguments ad hominem et infantilisants au seul représentant des groupes citoyens, au lieu de répliquer rationnellement à ses propos. La saga de cette farce parlementaire fut largement diffusée sur les réseaux sociaux grâce aux vidéos d’un organe de surveillance des médias de masse, le Guet des activités paralogiques, propagandistes et anti-démocratiques (GAPPA) [3]. Cette bavure relativement mineure révèle pourtant la principale faiblesse du Parti québécois, à savoir les limites de « l’art de dire des conneries ». Selon le philosophe Harry Frankfurt, il faut distinguer le mensonge du baratin ou du bluff, qui caractérise davantage le populisme conservateur à la mode de nos jours. « Le concept fondamental qui caractérise la nature du mensonge est celui de la fausseté : le menteur est avant tout quelqu’un qui proclame volontairement une chose fausse. Le bluff vise lui aussi à transmettre une fausse information. Cependant, il se distingue du mensonge pur et simple en ce qu’il repose non pas sur la fausseté, mais plutôt sur le trucage. Ainsi s’explique qu’il soit si proche du baratin. Car l’essence même de ce dernier est l’imposture, et non la fausseté [4]. » Autrement dit, le bluffeur ne se soucie guère de la vérité, car il ne vise qu’à persuader un tiers par la gestion des perceptions sociales et des impressions sensibles.
Heureusement, cette stratégie de manipulation montre rapidement ses limites. Lorsque les techniques de légitimation de l’État deviennent de plus en plus superficielles, brouillonnes et spectaculaires, les gens finissent par se rendre compte que le « consensus », l’« acceptabilité sociale » et la « participation citoyenne » ne sont que des incubateurs à « bullshit », des machines à dire des conneries. Cette contradiction idéologique, entre un pouvoir politique en manque de légitimité qui recourt à des techniques toujours plus factices qui ne font qu’aggraver cette crise de représentation manifeste la décrépitude de notre démocratie médiatico-parlementaire. Cela mène évidemment à l’augmentation du cynisme et à l’affaiblissement du consentement actif des masses, ce qui ne provoque pas pour autant la révolte ou l’unification des forces d’opposition pour le renversement du pouvoir. Cette situation paradoxale, où les gens ne croient plus au système mais peinent à vouloir agir politiquement et à reprendre leur vie en main, représente le climat idéologique, conservateur et craintif, incrédule et attentiste, de notre époque. L’appel au sauveur, à l’homme d’État à la figure paternelle, constitue un vœu inavoué, qui scelle la complicité névrotique des gouvernants et gouvernés ; ceux-ci restent ensemble malgré le fait qu’ils savent très bien que leur union ne fonctionne plus depuis longtemps.
Vers la souveraineté populaire
Au-delà de ces élucubrations sur l’inconscient collectif, il faut noter que le Parti québécois ne fait qu’adopter la perspective économico-politique du gouvernement conservateur canadien, malgré sa prétention à défendre l’intérêt national. L’ouverture à l’acheminement des sables bitumineux albertains et l’exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois augmentent notre dépendance collective vis-à-vis de l’économie canadienne, des compagnies étrangères et d’une industrie non viable écologiquement. La novlangue de l’« indépendance énergétique », associée au champ lexical de la « gouvernance souverainiste » et de la « solidarité durable », troque en fait notre soumission nationale contre une illusion de croissance économique servant à pallier les effets néfastes des politiques d’austérité. Autrement dit, les tergiversations énergétiques du gouvernement péquiste ne résultent pas d’une maladresse politique ou d’une mécompréhension des enjeux actuels, mais d’une logique réconciliatrice visant à occulter les contradictions du système dominant. Il s’agit en quelque sorte de réduire les tensions socioéconomiques et d’éviter que la crise refasse surface.
De cette constatation du décalage entre les transformations sociales, culturelles, économiques du XXIe siècle et l’inertie idéologique, politique et institutionnelle qui freine tout véritable changement, nous pouvons faire l’hypothèse suivante : les dix prochaines années seront marquées par un carcan conservateur liant allègrement austérité, virage pétrolier et nationalisme identitaire. Durant cette nouvelle « Grande noirceur », gouvernée par le poids de la tradition scellant l’union du pouvoir économique et politique, le Capital et l’État, naîtront des espaces publics oppositionnels, des contre-publics subalternes, des mouvements sociaux et d’autres expérimentations collectives préparant le terreau d’une nouvelle lutte de libération populaire basée sur la défense du territoire et des milieux de vie. Celle-ci devra, pour devenir effective, lier indissociablement le combat pour l’émancipation nationale et un projet de transformation sociale, la transition écologique et la sortie du système capitaliste. Cela n’est pas une prédiction historique mais un souhait, une exigence. La question énergétique ne doit pas être pensée comme un problème isolé, mais comme le fil conducteur d’une lutte globale pour la reconstruction d’une véritable souveraineté populaire.
« La redéfinition de la notion de « souveraineté » sera le grand défi de l’ère post-globalisation. La mondialisation était fondée sur l’ancienne notion de souveraineté, celle des États-nations héritée de la souveraineté des monarques et des rois. La nouvelle notion de souveraineté est le fondement de la résistance à la mondialisation. Cette résistance se traduit par le slogan : « Le monde n’est pas une marchandise. » Actuellement, les Grecs disent : « Notre terre n’est pas à vendre, nos biens ne sont pas à vendre, nos vies ne sont pas à vendre. » Qui parle ? Les peuples. Revendiquer la souveraineté des peuples est la première étape de la souveraineté alimentaire, de l’eau ou des semences. Mais il y a une seconde partie : les peuples revendiquent le droit de protéger la Terre, et non celui d’abuser d’elle comme d’autres la maltraitent. Ainsi la souveraineté des terres, des semences, des rivières rejoint la souveraineté des peuples. Avec la responsabilité de protéger ce cadeau de la Terre et de le partager équitablement [5]. »
[1] Scott McKay, « Le casse-tête pétrolier », Le Devoir, 19 novembre 2013.
[2] Idem.
[3] GAPPA, « Le PQ sur la défensive depuis la dernière vidéo GAPPA », 7 décembre 2013. Disponible en ligne sur < http://gappasquad.wordpress.com/>.
[4] Harry Frankfurt, On Bullshit, Princeton University Press, Princeton, 2005.
[5] Agnès Rouseaux et Nadia, « Vandana Shiva : « Le libre-échange, c’est la dictature des entreprises », 4 juillet 2011. Disponible en ligne : <http://www.bastamag.net/article> .