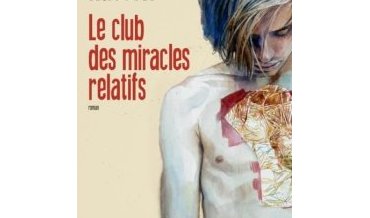La littérature et la vie
Puissance de la mer, passion des mots
Dominique Fortier appartient à la cohorte des écrivain·e·s qui, à l’aube de la quarantaine, parvenus à la maturité littéraire, possèdent à la fois un univers référentiel propre, reconnaissable et un style distinctif qui caractérisent leur monde romanesque. Dans son cas, c’est le recours à l’histoire fondé sur une puissante érudition et la maîtrise parfaite d’une écriture que l’on pourrait qualifier de classique, tout en finesse et en retenue, qui singularisent son approche.
Cette manière caractérisait déjà ses premiers romans : le récit fabuleux de l’expédition de Franklin en Arctique qui tourne en catastrophe dans Du bon usage des étoiles et celui, non moins extraordinaire, des éruptions volcaniques du mont Pelée en Martinique et du Vésuve en Italie et de leurs conséquences sur le destin de ceux qui y sont confrontés dans Les larmes de Aaint-Laurent.
Dans Au péril de la mer (Alto, 2015), c’est le Mont-Saint-Michel qui se retrouve au cœur du roman, lieu mythique (la marée y monte plus vite qu’un cheval au galop, dit-on) pour lequel la narratrice a éprouvé un coup de foudre à l’adolescence. Le paysage est magnifique bien sûr et l’endroit incarne de plus à ses yeux le « pays des livres », où il lui sera possible plus tard de vivre.
L’esprit des lieux
Son livre se présente d’une part comme une célébration de la célèbre abbaye, empruntant pour la représenter un mode de narration historique et légendaire. Il prend d’autre part la forme d’un carnet de notes contemporain dans lequel l’auteure consigne ses observations sur les rapports entre la vie et l’écriture dans sa propre existence marquée par la naissance récente de sa fille : comment concilier l’amour absolu des livres et le geste d’écrire avec une vie quotidienne aussi passionnante qu’exigeante ? Ces deux lignes du récit sont imbriquées en alternance, dans un subtil fondu enchaîné qui noue de manière étroite les préoccupations d’aujourd’hui à celles des moines d’hier.
L’évocation de l’abbaye se profile ainsi sur un arrière-plan historique qui occupe une place significative dans le récit. Fondée au début du Moyen Âge, haut lieu archétypique de la foi ardente de la chrétienté, elle connaît ensuite plusieurs métamorphoses : elle devient un centre de reproduction et de diffusion de livres saints et savants, une bibliothèque célèbre, puis une prison au moment de la Révolution de 1789 où l’on y enferme les prêtres récalcitrants, enfin la destination touristique célèbre et spectaculaire qu’elle symbolise aujourd’hui pour le meilleur et pour le pire.
La vie des moines est reconstituée dans sa quotidienneté, de leurs occupations les plus empiriques, l’entretien et le jardinage, aux plus hautes fonctions intellectuelles et spirituelles dont la bibliothèque est le cœur, une « mémoire » sans laquelle, comme le fait remarquer Robert, un de ses prieurs, « nous redevenons semblables à des enfants marchant à tâtons dans les ténèbres ». Des enfants, souvent orphelins abandonnés à l’époque, que le monastère accueille parfois d’ailleurs, comme il le fait pour les miséreux errants, gens pieux en pèlerinage aussi bien que voyous en tous genres auxquels il offre un abri. Les moines eux-mêmes appartiennent pour la plupart à cette masse paysanne, choisissant les ordres autant par nécessité économique et sociale que par vocation religieuse. Ils y trouvent un refuge à tout le moins, à défaut d’y trouver le ciel.
L’amour de la vie et des livres
C’est dans cet univers à la fois grandiose et dévasté que va prendre place une liaison amoureuse entre un moine, Éloi Leroux, peintre d’origine modeste, et Anna, fille d’un riche marchand promise au mariage avec un puissant seigneur et dont il est chargé de dresser un portrait officiel en quelque sorte. Passionnée, leur histoire d’amour est promise à un destin tragique en raison de leurs appartenances sociales respectives qui les séparent. Mais cela n’empêche pas la liaison de perdurer, y compris après le mariage d’Anna, et elle ne sera interrompue que par la mort de celle-ci, frappée par un accès de fièvre qui la terrasse dans la fleur de l’âge. Narrateur de cette ligne du roman, Éloi note alors dans une formule magnifique : « Ce jour-là, la lumière s’était éteinte. Le jour était devenu la nuit, la nuit était devenue de la cendre. »
Anna, en disparaissant, lui a cependant laissé en héritage l’amour des mots, qui se superpose à sa passion antérieure pour la peinture et l’art. « La meilleure part des mots que je connais, écrit-il, et grâce auxquels j’arrive tant bien que mal à nommer le monde qui m’entoure, je la lui dois. » Et cet amour des mots et des livres anime aussi ses confrères moines ainsi que le fait remarquer Robert, le supérieur de la communauté, car il ne suffit pas aux hommes « d’apprendre, de savoir et de croire. Il nous faut encore à inventer. » Or on invente et on crée par le maniement du pinceau et du marteau mais aussi par les mots. Cela vaut pour l’auteure d’Au péril de la mer aussi bien que pour les moines qu’elle met en scène dans son roman, célébration du Mont-Saint-Michel, cathédrale de pierre et symbole de la foi, mais également produit de la puissance de l’imaginaire qu’elle exerce pour sa part de manière souveraine dans le maniement de l’écriture.
Le péril de la mer
Sylvie Drapeau, surtout connue comme comédienne, soumet une variation différente du même thème dans un très court roman intitulé tout simplement Le fleuve (Leméac, 2015). Celui-ci s’y profile d’abord comme un objet de contemplation et de méditation. Le récit s’ouvre en effet sur la phrase suivante : « Par beau temps, sur le fleuve, il y a comme des diamants qui flottent, qui pétillent et qui rient », amorce qui le situe d’emblée dans le registre du poétique. Il l’est d’autant plus qu’il est associé à l’univers de l’enfance dont le caractère féérique est donné d’emblée.
La représentation de ce monde enchanté est investie par une voix d’adulte qui tente de reconstruire le monde de son enfance à partir de la vision quelque peu naïve qu’elle portait sur lui à l’époque. Le milieu d’origine situé quelque part sur la Côte-Nord est traditionnel : la famille de la narratrice est en effet très religieuse, vouant un culte fervent à Dieu, à Marie et aux anges, nombreuse et vraisemblablement peu fortunée. Elle semble toutefois très unie autour du père, de la mère et du frère aîné qui sert d’animateur et de guide à la « meute » de « loups sauvages » que forment les enfants, parcourant librement la forêt derrière la maison familiale et s’aventurant parfois dangereusement dans les eaux du fleuve.
Or la mer n’est pas qu’un espace de jeux rassurant : figure protectrice et enveloppante, elle peut se transformer rapidement en danger mortel. C’est ce que va comprendre, mais trop tard, le frère aîné, Roch, qui a osé braver l’interdit familial de prudence face à cette menace improbable mais néanmoins réelle. Sa disparition rapide dans les flots rageurs provoque la dislocation de la famille, dont les membres sont dispersés dans des milieux inhospitaliers, « survivants déroutés », devenus une « meute de loups-zombies égarés » qui essaiera de se regrouper plus tard autour de la figure d’une mère revenue en partie de son chagrin, animée par l’espoir problématique de retrouver le « paradis perdu », comme disait Proust, de l’enfance envolée et sans doute pour toujours irrécupérable.
Le récit de Sylvie Drapeau est aussi troublant que fragile, touchant que sympathique. Elle marche comme une funambule, sans cesse menacée de chuter mais gardant l’équilibre, tendue entre une idéalisation nostalgique de l’enfance et la description lucide de la perte inéluctable de ce paradis au contact du réel, symbolisé ici par un fleuve, qui berce mais qui peut aussi tuer.