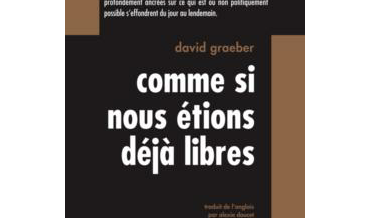Pierre Lefebvre
Confessions d’un cassé : la fierté du pauvre
Confessions d’un cassé, Pierre Lefebvre, Montréal, Boréal, 2015, 168 p.
« Ce n’est pas tout d’être cassé, il faut en plus être humble. Un pauvre baveux, personne n’aime ça. »
Certaines passions sont si prenantes qu’on en vient à considérer d’un œil méfiant ceux qu’elles laissent indifférents. J’aime furieusement le jazz et j’aurai toujours du mal à comprendre les gens qu’un solo de Coltrane n’émeut pas. Même si je sais tout le ridicule d’un tel jugement, il m’arrive de croire qu’ils sont bêtement dans l’erreur, qu’ils ne comprennent pas, par sottise ou par entêtement, et que par conséquent ils passent à côté d’un des grands plaisirs de la vie. Il ne me vient pas à l’esprit que ces gens vivent des émotions tout aussi intenses, peut-être même plus intenses que les miennes en écoutant de la musique dont je ne connais rien. Même lorsqu’après y avoir réfléchi je suis prêt à admettre que le jazz, ce n’est pas tout, la part la plus détestable de mon être tient à avoir le dernier mot et conclut secrètement qu’ils et elles passent à côté de quelque chose d’essentiel.
Un des grands mérites des Confessions d’un cassé de Pierre Lefebvre est de montrer comment la passion de l’argent suppose toujours aussi le mépris de ceux que l’argent indiffère. Les personnes qui aiment le plus l’argent ne se contentent pas de vivre leur passion : elles souhaitent aussi l’imposer aux autres. Ou plutôt, elles jugent insultant qu’on puisse se passer de ce qui, pour elles, revêt une importance vitale. À leurs yeux, un être qui se contente du strict minimum est un misérable. C’est précisément pour cela que ce livre est une suite de confessions : de nos jours, le fait de ne pas se démener pour avoir toujours plus d’argent est considéré comme une faute impardonnable. On attend du pauvre qu’il admette ses torts. S’il mène une vie à ce point dénuée, c’est parce qu’il refuse d’embrasser une passion qui, au fond, est le liant de la communauté capitaliste : celle du gros cash sale qui circule de mains en mains en absorbant comme un trou noir les désirs qui nous constituent.
C’est à cette logique à la fois simple et horrifiante que Pierre Lefebvre s’attaque. Puisqu’on demande au cassé de confesser son manque d’amour pour l’argent, source de toutes joies, il décide de jouer le jeu en expliquant d’où lui vient son étrange frigidité. En jouant à l’idiot qui ne comprend pas, en faisant son petit Socrate des pauvres, le cassé parvient peu à peu, au fil de ses confessions, à révéler une contradiction que nous connaissons bien, mais à laquelle nous n’aimons pas nous arrêter longuement parce que si on le faisait, elle nous obligerait à renoncer à trop de choses.
Avec sa verve habituelle, Lefevbre décrit la machine capitaliste, qui ne sait « accoucher d’autre chose que de la misère, de l’aliénation, du saccage, des déchets et, finalement, de l’horreur », non pas d’un point de vue théorique, mais à partir de son expérience du quotidien. Cette expérience de la précarité – que les intellectuel·le·s n’ont pas toujours, même si de plus en plus se condamnent à la pauvreté en faisant le choix de penser – confère au livre toute sa valeur. Ce texte ne tolère aucune bullshit, ce qui en soi est assez rare pour mériter d’être souligné. Lefebvre donne raison à la sagesse antique qui veut que la liberté dont on dispose soit inversement proportionnelle à la quantité des choses qu’on possède. N’avoir rien lui permet de penser en homme libre, et puisqu’il n’a pas l’ambition de grimper les échelons d’une quelconque échelle sociale, il n’hésite pas une seconde à appeler un chat un chat, ou plutôt un crosseur un crosseur.
C’est en nous laissant entrer dans sa vie d’homme brisé, incapable de fonctionner en société que Lefebvre nous met face à la contradiction que j’évoquais plus haut : si des gens font de l’argent, c’est toujours nécessairement sur le dos de ceux et celles qui, comme lui, n’arrivent pas à trouver leur place dans le système ou n’en ont tout simplement pas envie. Il y a plusieurs façons de devenir un perdant à ce jeu de l’argent. Il y a ceux qui manquent de talent pour se vendre (j’emploie sciemment cette expression répugnante), ceux dont la sensibilité les empêche de piler sur les pieds des autres, ceux que les flatteries horripilent jusqu’à la paralysie et ceux qui, comme Lefebvre, sont radicalement incapables d’oublier ne serait-ce qu’une seconde l’absurdité sans fin à laquelle nous condamne la logique de l’argent. « Si Victor Hugo pouvait se permettre d’affirmer : "C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches", nous n’avons même plus ce loisir-là tant notre paradis est infernal à force d’être pathétique. »
Une résistance tragique
On l’aura compris, l’intérêt des « confessions » de Lefebvre est au fond que celles-ci n’en sont pas. Il refuse de s’excuser, et comme si ce n’était pas assez, il se montre fier de mépriser souverainement l’argent. Ce mépris pour l’argent, et plus largement pour la valeur arbitraire des objets, est peut être ce qu’il y a de plus choquant ou de plus exaltant dans ce livre, tout dépendant de quel côté des choses on se trouve. Puisqu’on le somme de justifier son manque d’enthousiasme, Lefevbre décide de feindre l’idiotie qui, du point de vue capitaliste, est la seule explication à son manque d’entrain. Ne comprend-il donc pas tout le fun qu’il manque !? Mais il ne faut pas se leurrer : c’est au contraire une compréhension fine du fonctionnement de l’économie qui justifie sa posture : « À salaire minimum, j’ai toujours travaillé au minimum, même et surtout quand il m’était possible d’en faire plus. L’esquive la plus simple pour ne pas devenir dément ou neurasthénique reste, me semble-t-il, de leur en donner précisément pour leur argent. Les employeurs, en général, n’aiment pas tellement. »
Non, les employeurs n’aiment pas tellement le manque d’ardeur et de dévotion, pas plus que les propriétaires n’aiment se faire mettre des bâtons dans les roues par des locataires qui refusent de lever les pattes. Une des confessions les plus savoureuses du livre relate le combat perdu d’avance qu’a mené l’auteur contre le nouveau propriétaire de son immeuble, qui souhaitait le voir déguerpir pour faire des rénovations, et, on le devine, beaucoup de profits. S’accrochant au peu de droits qu’il possède, le cassé décide de jouer le jeu de l’argent en réclamant au propriétaire une compensation, ce qui enrage ce dernier. « Je n’en voulais pas tant que ça, des trente mille piasses ou des vingt mille ou des quinze mille ou même juste des dix mille, mais je tenais en maudit à ce que Gingras les crache. […] Ce qui m’intéressait dans ce deal-là, c’était de voir Jean-Claude Gingras frapper un écueil, même un tout petit. Je n’étais pas, je sais bien, en position de le faire couler, mais j’aurais voulu érafler la peinture de sa coque, suffisamment pour le mettre en maudit. »
Ce passage est important puisqu’il montre bien que le mode de vie choisi par l’auteur est une forme de résistance. J’ajouterais que cette résistance est tragique, au sens propre du terme, puisqu’un cassé qui décide de résister à la marche du monde se condamne à passer sous le rouleau compresseur de l’histoire. Lefebvre en est bien conscient et n’affiche dans son livre aucun romantisme. Les forces auxquelles il résiste sont insaisissables, anonymes, mais elles ont tout de même des effets bien réels. « Le défi le plus tenace du désargenté, écrit-il, est d’ailleurs d’avoir à la longueur de journée à canaliser sa colère vis-à-vis d’une violence donnant l’impression d’arriver de partout et de nulle part à la fois. C’est pourquoi il est toujours plus simple de retourner cette colère-là contre soi. »
Lefebvre décrit ici à mon avis quelque chose de très important. L’alchimie mystérieuse d’une colère sans objet précis, ayant pour objet le monde lui-même et qui se transforme peu à peu en haine de soi, beaucoup de gens la connaissent et en souffrent. En ce sens, les confessions de Lefebvre constituent un tour d’écrou de plus ; ce découragement, cet état de déréliction, il s’agit d’en faire une force, une impulsion pleine d’arrogance qui serait un ultime fuck you adressé à tout ceux qui veulent nous acheter.