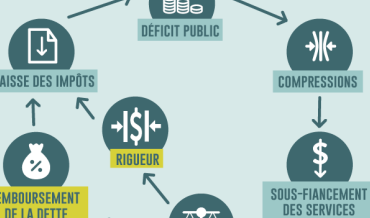Dossier : Contre l’austérité, luttes syndicales et populaires
Négocier en période d’austérité
Au moment d’écrire ces lignes, les syndicats du Front commun, formé de la CSN, de la FTQ et du Secrétariat intersyndical des services publics (SISP, qui regroupe la CSQ, le SFPQ et l’APTS) amorçaient leur 3e semaine de consultations en vue d’obtenir des mandats de grève tournante de 6 jours. Déjà, le message envoyé au gouvernement libéral est clair : des assemblées bondées, des mandats envoyés à plus de 80 % dans la majorité des cas. Un bras de fer est annoncé entre les salarié·e·s du secteur public et le gouvernement Couillard.
Lundi 15 décembre 2014 : alors que les négociateurs·trices du Front commun reçoivent les offres du Conseil du trésor, Francine Lévesque de la CSN, Daniel Boyer de la FTQ et Louise Chabot de la CSQ sont réunis et préparent leur réaction. Au vu des demandes patronales, un gel salarial de deux ans, des augmentations faméliques offertes pour la suite et des demandes pour charcuter les bénéfices du régime de retraite des employé·e·s de l’État, tous et toutes s’entendent : ces offres sont « insultantes, méprisantes et arrogantes ».
Le gouvernement qui n’aime pas les femmes
Depuis sa création en mai l’an dernier, le Front commun a affirmé la nécessité de mettre un terme au retard de la rémunération globale (salaire, régime de retraite et autres avantages sociaux) des employé·e·s de l’État par rapport aux autres salarié·e·s québécois·es, retard qui s’est cristallisé autour de 8 % ces dernières années, tel que le constate l’Institut de la statistique du Québec. Les offres salariales du gouvernement vont dans le sens opposé : en proposant un maigre 3 % de hausse sur 5 ans, le retard salarial des travailleurs et des travailleuses du secteur public atteindrait plus de 15 % en 2020. Alors que ces employé·e·s se sont appauvri·e·s de 10 % depuis 25 ans, ils perdraient à nouveau 7 % de leur pouvoir d’achat au cours des 5 prochaines années. Quand on ajoute le fait que plus de 75 % des emplois du secteur public sont occupés par des femmes, on est en droit de remettre en question cette discrimination salariale basée sur le sexe.
Sur toutes les tribunes, le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, répète que « chacun doit faire sa part » en vue du rapide retour à l’équilibre budgétaire. Mais alors qu’en moyenne, les Québécois recevront des augmentations salariales annuelles variant entre 2 et 2,5 % au cours des prochaines années, les employé·e·s du secteur public verraient leur salaire stagner ? Il s’agit là d’une forme d’impôt déguisé, applicable aux seuls salarié·e·s de l’État, clament plusieurs d’entre eux. Et ceux-ci, faut-il préciser, font déjà leur part, étant victimes comme chaque citoyen·ne·s des coupes de services et des hausses de tarifs – en plus de voir leur charge de travail s’alourdir au gré des abolitions de poste et des compressions budgétaires en santé et en éducation.
Ce n’est pas tout. Le gouvernement libéral ne veut pas seulement appauvrir ses salarié·e·s dès maintenant, mais également jusqu’à la fin de leurs jours. Trois demandes déposées par le Conseil du trésor auraient inévitablement pour effet de diminuer les rentes du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). D’abord en prolongeant de 5 à 8 ans la période de calcul du salaire moyen (quoique, affirment les plus cyniques, cette mesure n’aurait pas tant d’impact lorsqu’on propose un gel salarial…), en faisant passer de 60 à 62 ans l’âge de la retraite sans pénalité actuarielle, et en augmentant celle-ci de 4 à 7,2 % par année d’anticipation. Ainsi, les rentes pourraient être amputées jusqu’à 40 %.
Surfant sur la vague anti-régime de retraite provoquée par le projet de loi 3 dans le monde municipal, le ministre Coiteux affirme avoir à cœur la pérennité du RREGOP. Pourtant, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) démontrait, lors de sa dernière mise à jour actuarielle en avril dernier, que le RREGOP était capitalisé à 98,4 % – soit pleinement en mesure de s’acquitter de ses obligations actuelles et futures. L’objectif à peine avoué est de soutirer 200 millions de dollars annuellement des poches des retraité·e·s de l’État.
Biais idéologique
En déposant ses demandes le 30 octobre 2014, le Front commun avait indiqué au Conseil du trésor vouloir améliorer l’organisation du travail et la qualité de vie au travail, notamment en s’attaquant à la précarité d’emploi (qui touche 35 % des salarié·e·s de l’État), en diminuant le recours au secteur privé, en protégeant l’autonomie professionnelle des employé·e·s et en bonifiant les mesures de conciliation famille-travail-études. Autant de façons d’améliorer l’efficience des réseaux publics, d’augmenter la capacité d’attraction et de rétention du personnel dans une période où les pénuries de main-d’œuvre se font de plus en plus criantes, et de réaliser des économies d’échelle, notamment en diminuant le recours à la sous-traitance.
Non seulement le Conseil du trésor n’a-t-il toujours pas répondu à l’une ou l’autre de ces demandes, mais il voudrait, entre autres, faire sauter des conventions collectives les lettres d’entente négociées, posant des balises au recours à la sous-traitance. Alors que les scandales informatiques ou au ministère des Transports se multiplient, alors que les dépassements de coûts tournent au ridicule dans la construction des centres hospitaliers universitaires, le gouvernement libéral ignore les pistes d’économie soumises par le Front commun et voudrait ouvrir encore plus grandes les portes du secteur public au privé.
Sempiternelles restructurations
Il faut noter que les négociations actuelles se déroulent avec, en arrière-scène, la plus grande restructuration du réseau de la santé et des services sociaux, secteur où travaille environ la moitié des 540 000 employé·e·s de l’État. En allant de l’avant avec le projet de loi 10 du ministre Gaétan Barrette, le gouvernement libéral a imposé la fusion de nombreux établissements. Ainsi, le gouvernement voudrait privilégier la « disponibilité », la « mobilité » et la « flexibilité » de la main-d’œuvre afin de faciliter la mise en place de méga-structures s’étendant sur de vastes territoires. Le gouvernement voudrait, entre autres, revoir la règle du rayon de 50 km en cas de réaffectation ou lors de mises en disponibilité. Un ou une salariée de Montréal devrait accepter une affectation aux Îles-de-la-Madeleine, sans quoi elle perdrait son lien d’emploi, a-t-on entendu de la part d’un porte-parole patronal à une table sectorielle de négociation.
Tant dans les réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux que dans la fonction publique, le gouvernement souhaiterait s’attaquer à la sécurité d’emploi, avoir plus de souplesse pour confectionner les horaires de travail (en privilégiant les horaires atypiques ou, pourquoi pas, sur « plus de 5 jours par semaine ») et assouplir les règles en matière de mise à pied. Bref, le gouvernement voudrait que ses employé·e·s se déplacent où il veut, quand il veut et comme il veut, tels des pions interchangeables, et ce, au gré des ministres et de leurs sempiternels projets de restructuration. Pour ce faire, le gouvernement Couillard s’attaque à des pans entiers des conventions collectives du secteur public, chèrement gagnés au cours de précédentes rondes de négociation.
Vers la grève
Pas étonnant, dans ce contexte, que le Front commun ait appelé l’ensemble de ses syndicats à se doter de mandats de grève : six journées tournantes à être déclenchées dès l’automne, si nécessaire.
Mais avant de recourir à la grève, le Front commun voudra avoir démontré qu’il a utilisé tous les moyens nécessaires pour débloquer les tables de négociation. Depuis la fin de l’été, l’ensemble des établissements des réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation et des organismes gouvernementaux sont frappés par des moyens de perturbation : boycottage d’actes administratifs, occupations de bureaux de direction, application stricte des horaires de travail ; le mot d’ordre est d’enrayer les administrations.
Le 3 octobre, c’est par milliers que les salarié·e·s du secteur public descendent dans les rues de Montréal, à l’occasion d’une manifestation nationale du Front commun. Tout au long du mois d’octobre, les syndicats du secteur public mèneront des actions de perturbation socioéconomiques dans l’ensemble des régions du Québec. La grève pourrait être déclenchée par la suite, soit dès la fin du mois d’octobre.
Dans une récente entrevue, l’animateur Alain Gravel affirmait que le déclenchement d’une grève dans le secteur public ne ferait que précipiter le recours à une loi spéciale. Raisonner de cette façon revient à accepter qu’une telle mesure d’exception fasse partie de l’ordre normal des choses, rétorquent les syndicalistes. D’autant plus que la Cour suprême a reconnu pour la première fois, dans un jugement rendu en février dernier, la constitutionnalité du droit de grève au Canada.
Le Front commun parviendra-t-il à faire fléchir le gouvernement Couillard ? Ce dernier s’entêtera-t-il à vouloir réduire la taille de l’État et à considérer les services publics comme une simple colonne de chiffres dont il faut réduire les montants le plus possible ? Les syndicats auront-ils un appui significatif de la population, sensibilisée à la détérioration de services publics ? Nous le saurons au cours des prochaines semaines…