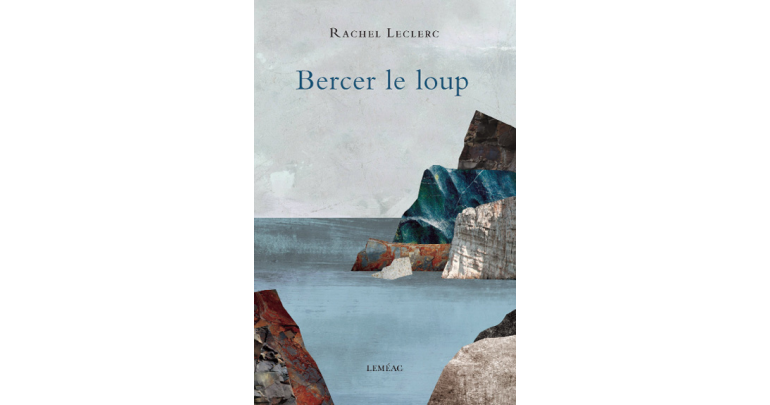La littérature et la vie
L’expropriation de Forillon : un mal pour un bien ?
Formulée à plusieurs reprises dans le beau roman de Rachel Leclerc (Leméac, 2016), cette question sert de fil conducteur d’un bout à l’autre du récit.
La question est pertinente comme elle l’était pour l’expropriation, à la même époque, du territoire de Mirabel pour faire place à un aéroport qui se révélera assez rapidement un éléphant blanc, comme nous l’a appris la suite de l’histoire. Dans le cas de Mirabel, il est clair que le mal ne s’est pas métamorphosé en bien ; c’est toutefois moins évident pour Forillon, devenu le magnifique parc touristique que l’on sait.
Une « tragédie grecque »
Romancière, Rachel Leclerc ne formule pas cette problématique en termes explicitement sociaux et politiques. Elle la reprend et la transpose dans le registre de la fiction en la dramatisant à partir du cas singulier d’une famille, marquée pour toujours par cette opération éprouvée comme une « tragédie grecque », construite en partie comme un roman policier. Le récit s’ouvre en effet sur une tentative de suicide au quai de Carleton-sur-Mer dont l’énigme sera résolue en cours de récit. Ce geste troublant intervient plusieurs décennies après les évènements de Forillon survenus au début des années 1970 qui lui assurent sa signification en insérant cet épisode singulier dans le drame à portée historique qui bouscule alors cette région de la Gaspésie, et qui est contemporain de la déportation des habitant·e·s de l’arrière-pays dans des villes dortoirs où, devenus des dépossédés, ils sont condamnés à végéter.
Le loup du titre du roman, c’est Louis Synnott, un travailleur de scierie et ébéniste à ses heures, qui a construit une maison de style scandinave au Cap Jalousie et qui se considère comme « gardien de cette terre » qu’il a élue et où il espère élever sa famille et terminer ses jours. Le projet de création d’un parc touristique met fin à ses espoirs, car il implique non seulement l’expropriation mais la destruction de sa maison qui sera incendiée par un fonctionnaire, voleur et menteur comme le considère Louis, dans un épisode particulièrement dramatique et fondateur en quelque sort du roman : « C’est toi qui flambes, c’est toi qui meurs », comme le signale la narratrice du récit qui l’interpelle à la deuxième personne, mort morale qui coïncide par ailleurs avec l’accouchement par sa femme d’une fille, Marina, du coup vouée à une « errance perpétuelle » et qui sera désormais hantée par le fantasme de vengeance qui habite son père et qu’elle transmettra elle-même à sa propre fille. C’est en cela notamment que le roman se situe dans le registre de la tragédie.
Trois décennies plus tard, Janice, la petite-fille de Louis, désormais au centre du récit qui connaît une bifurcation importante, hantée par le désir de vengeance du grand-père qu’elle a repris à son compte, va se confronter à sa manière au descendant du fonctionnaire qui a brûlé la maison de celui-ci. Cet homme, Ulysse Le Sueur, fonctionnaire ambitieux comme son père, fera ainsi l’objet d’une tentative de séduction de la part de Janice, avec laquelle il vit une relation aussi rapide que torride dont il comprend trop tard qu’elle est un piège : celle-ci le dénonce en effet à la police, transformant son opération de séduction en viol délibérément commis par Ulysse. Or ce dernier, le lecteur le comprend alors, est le désespéré qui a tenté de se suicider dans le prologue du roman qui, de tragique, bascule ainsi dans une forme de polar.

Avant l’expropriation (c) Musée de la Gaspésie. Fonds Robert Fortin
Janice, qui est toute jeune, comprend assez rapidement, et à sa grande honte, qu’elle s’est conduite avec Ulysse de manière perverse et va revenir sur sa déclaration de viol et sur son geste qu’elle tentera d’expliquer, sinon de justifier, lors d’une rencontre assez invraisemblable avec Ulysse qui finira par lui pardonner. Elle réalise aussi bientôt qu’elle est enceinte de ce dernier, lui-même un homosexuel, qui entretient une relation avec un médecin avec lequel il se propose de faire vie commune.
La réconciliation symbolique
Ce drame trouve alors une résolution inattendue : Ulysse fait don de sa maison à Janice et à sa mère, Marina, elle-même revenue d’un long séjour de plusieurs années à Vancouver où elle s’était exilée. Elle retrouve ainsi sa fille abandonnée qui, en échange de l’héritage que lui lègue Ulysse, lui confie son enfant qu’il élèvera désormais avec Éric, dans l’une de ces familles atypiques qui caractérisent l’époque actuelle.

Après l’expropriation (c) Musée de la Gaspésie. Fonds Pierre Rastoul
Guère vraisemblable sur le plan factuel, ce troc obéit à la logique symbolique de fond du récit. Il permet de mettre un terme à l’affrontement du grand-père Louis avec les agents de l’État, incarnés ici par André Le Sueur, et de provoquer une sorte de grande réconciliation générale qui met fin à la tragédie. Le nouveau père prend en effet en charge le petit Louis, descendant de l’ancêtre rendu fou par l’expropriation brutale dont il a été la victime non consentante. Janice, pour sa part, déçue au terme de l’expérience traumatisante qu’elle a vécue, choisit tout de même de réintégrer la famille en vivant désormais avec sa mère et de demeurer dans la région, car, de toute manière, elle n’a guère le choix et espère s’y tailler une place malgré tout.
L’expropriation est-elle un « mal pour un bien » alors ? Sur le plan social et économique, si elle a été une bonne affaire pour certains et si elle a conduit à l’aménagement d’un lieu magnifique ouvert à tous, elle s’avère d’une certaine manière un « bien ». Considérée en revanche du point de vue de ses victimes, dépossédées de leurs biens, de leurs espoirs et plus profondément encore de leur mémoire, elle est pour le moins très problématique comme le sont aussi par exemple l’expropriation, contemporaine, d’une partie des Laurentides au profit de Mirabel, ou plus largement encore la déportation des Acadiens, également évoqués très explicitement dans le roman.
Dans tous ces évènements, il y a une part de tragédie et de malheur qui frappe les premiers concernés dans leur vécu et qui met en question parfois leur existence même comme c’est le cas ici de Louis, le loup, « à bercer », pour lui permettre de dépasser sa folie et de trouver un nouveau sens à une vie démolie par une décision intempestive qui ne tombe pas du ciel mais qui relève des hommes et de la manière dont ils conçoivent et construisent (ou déconstruisent) le monde. Faisant bien voir cela, le roman de Rachel Leclerc comporte une dimension historique et sociale qui est peut-être sa qualité première.