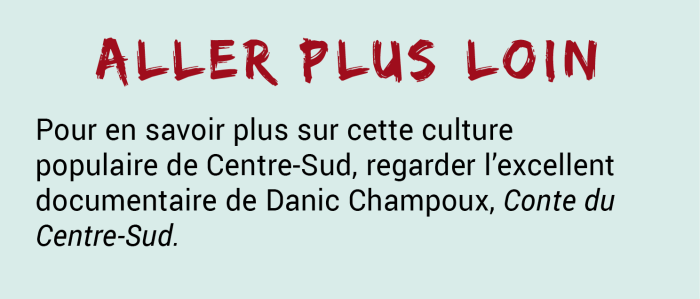Actualité
Centre-Sud. Une histoire de quartier
L’Institut économique de Montréal (IEDM) a provoqué tout un débat cet été en publiant une note vantant les mérites de la gentrification dans des quartiers comme Hochelaga-Maisonneuve. C’est à se demander ce que dénoncent les voleurs de saucisses et autres barbouilleurs de vitrines.
Selon le think tank de droite, les constructions modernes redonnent du cachet à ces secteurs délabrés et les commerces récents ouvrent de nouveaux horizons aux « individus à bas revenus ». Plus encore, le côtoiement de ménages plus fortunés aurait un effet positif sur les enfants des quartiers populaires en favorisant la mobilité sociale. Une analyse tout à l’opposé des groupes populaires et des militant·e·s qui critiquent vertement les hausses de loyer considérables provoquées par la gentrification. Mais qu’en pensent les habitant·e·s de ces quartiers en transformation, qui ont été peu consulté·e·s sur ces questions ?
Prenons-en un qui a échappé au débat : Centre-Sud. Coincé entre Hochelaga, le Plateau et le Quartier latin, l’ancien Faubourg à m’lasse témoigne toujours de son histoire ouvrière, avec des vestiges ici et là qu’on entraperçoit à travers les condominiums. Selon Gaétan Roberge, du comité logement Ville-Marie, la conversion du parc locatif à Centre-Sud s’est faite progressivement, sur une période de 20 ans, contrairement aux autres quartiers populaires où des vagues massives de construction de condos et de perte d’habitations locatives se sont observées en peu de temps. Dans Centre-Sud, ces changements se sont opérés d’une façon insidieuse, échappant ainsi aux rapports conflictuels constatés dans les autres quartiers en mutation. Un bel observatoire pour comparer ces deux discours anti et pro-gentrification.
Revitalisation urbaine
Cinq femmes ont accepté de me rencontrer, dont quatre ont aménagé dans Centre-Sud au début des années 1980 en tant qu’étudiantes de l’UQAM. Martine, elle, est née ici dans les années 1970. Elle se souvient d’ailleurs des bâtisses désuètes qui ont été restaurées par les étudiant·e·s et les jeunes professionnel·le·s. Pour M. Roberge, c’est déjà le signe d’une gentrification. Les appartements retapés seront loués de plus en plus cher : la proximité du centre-ville rend le quartier attirant pour ceux et celles qui y travaillent et les étudiant·e·s d’alors ont maintenant des professions libérales, ce qui leur permet aujourd’hui d’absorber ces hausses de loyer. La construction des condos commence dès la fin des années 1990, entraînant dans son sillage des commerces de proximité adaptés aux goûts des nouveaux résidents.
Mieux nanties que plusieurs ménages de Centre-Sud, ces anciennes étudiantes s’insurgent. Les hausses de loyer et les prix des boutiques finiront par chasser les personnes les plus défavorisées du quartier. « Dans une société, il n’y a pas juste des gens qui font des bons salaires, et c’est ça qu’on veut dans notre quartier ; on veut pas que les pauvres soient obligés de quitter », affirme Chantal. Il faut préserver cette mixité sociale, qui est vue comme le reflet d’une société diversifiée à l’échelle d’un quartier.
Ce mélange bénéfique des horizons socioéconomiques semble supporter les arguments de l’IEDM. D’autant plus que l’embourgeoisement vient aussi avec une revitalisation des aménagements urbains. Les rues se verdissent, on réaménage les parcs, l’offre d’activités sociales se diversifie. Même les épiceries solidaires arrivent après les ménages plus fortunés ! Les résidentes ne sont pourtant pas dupes : pourquoi faut-il attendre l’arrivée de populations privilégiées pour reverdir le quartier ? Ces changements sont toutefois appréciés par ces femmes.
Or, pour M. Roberge, le problème de la gentrification se trouve justement dans ces aspects positifs (revitalisation et mixité) qui rendent ce processus socialement acceptable, mais finit par conduire à une homogénéité de classe sociale, cette fois de populations aisées. « La phase finale est toujours catastrophique pour l’unicité et l’essence d’un quartier », prévient Gaétan Roberge. Si rien n’est fait pour contrôler le marché locatif, les prix exorbitants des logements auront raison de cette diversité.
Culture populaire et mixité sociale
Mais est-ce seulement une question de hausse des loyers ? Contrairement aux autres résidentes, Martine reste perplexe quant aux supposés effets positifs de la mixité sociale. Bien plus qu’une transformation du cadre bâti, la gentrification entraîne une confrontation entre deux cultures de classe qui la ramène à sa propre condition. L’offre des nouveaux commerces est trop élevée pour son budget et elle peine à comprendre l’attrait pour certains produits. Pour cette personne issue de la classe populaire, la mixité sociale se vit dans une dévaluation des normes culturelles populaires. Le nouveau bar du quartier, ouvert il y a à peine deux ans, en est un exemple type : « Même si j’avais l’argent, j’irais pas, on me regarderait de haut. » Si elle n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi – une façon de s’habiller, de s’exprimer, de se tenir ? – le sentiment d’exclusion n’en est pas moins réel. Les nouveaux commerces ne sont donc pas des environnements si inclusifs. Ouverture à de nouveaux horizons, affirmait l’IEDM ?
Dans les termes de M. Roberge, la gentrification, c’est aussi toute cette mentalité anti-pauvre insidieuse qui s’installe. Les propriétaires attendent impatiemment que leurs locataires se renouvellent en comparant les profits du propriétaire voisin qui a réussi à louer à des prix nettement supérieurs à eux. Ils finissent par ne plus faire de réparations, espérant ainsi pousser les ménages à déménager. En outre, les individus récemment établis véhiculent parfois des préjugés associés à l’idée de « BS » par des paroles à peine chuchotées et des regards en biais. Martine en fait souvent les frais. Cette dépréciation prend des formes subtiles même chez les autres résidentes interrogées qui défendent pourtant des valeurs de justice sociale. Cela se traduit par un sentiment d’insécurité vécu par ces dernières auquel il faut remédier avec des caméras de surveillance, du profilage social exercé par une présence policière accrue ou un réaménagement du matériel urbain.
Les projets citoyens, les fêtes de quartier, la disparition de la petite criminalité et le verdissement du district enchantent les femmes rencontrées. Or, parallèlement, itinérant·e·s, travailleuses·eurs du sexe, jeunes de la rue, consommateurs·trices de drogues, toutes et tous finissent par disparaître de la trame urbaine. Où sont-ils allés ? On peut douter qu’ils et elles sont maintenant bien logé·e·s dans des appartements subventionnés, avec une prise en charge efficace des services sociaux et de santé. Ces personnages hauts en couleur – un reflet des conditions socio-économiques de Centre-Sud – étaient pourtant intégrés dans le tissu social du quartier. Une autre forme de mixité.
La gentrification n’est donc pas synonyme, à terme, de cohabitation et conduit à un nettoyage social drastique des populations marginalisées. Finalement, certain·e·s habitant·e·s en viennent à se sentir étrangers dans leur propre quartier et l’envie de quitter pour un milieu où ses propres normes culturelles sont valorisées, avec des loyers abordables, conduit à la disparition de la culture populaire d’un district. Dans ce contexte, les vitrines barbouillées et les vendettas de saucisses bio expriment la rage devant l’incapacité à défendre son chez-soi et dénoncent la colonisation d’un espace populaire par une classe sociale économiquement et culturellement favorisée. Voilà pour l’analyse de la fable économique du trickle down, gracieuseté de l’Institut économique de Montréal.