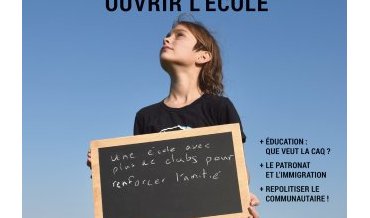« Notre relation à l’autre est indissociable de notre rapport au territoire »
Entrevue avec Émilise Lessard-Therrien, députée de Québec Solidaire de Rouyn-Noranda–Témiscamingue
,
Élue depuis moins d’un an, la jeune députée de Québec solidaire (27 ans) a pris la mesure de sa fonction. « J’arrive à bien marcher avec ces grands souliers, dit-elle. J’ai progressivement découvert le travail de députée au quotidien, en région et à l’Assemblée nationale à Québec. » Mines, environnement, agriculture, services publics, culture, relations avec les Autochtones… nous avons passé en revue avec elle les grands dossiers qui l’occupent à l’occasion de la parution d’un numéro d’À bâbord ! consacré à l’Abitibi-Témiscamingue.
Propos recueillis par Rémi Leroux.
ÀB ! : Dans le dossier des mines, comment parvenez-vous à conjuguer le discours de Québec solidaire, qui prône la mise en œuvre d’une véritable transition énergétique et le fait que vous vivez dans une région qui s’est développée et continue à se développer à partir de l’extraction des ressources naturelles ?
La région s’est construite sur l’industrie minière, oui, et de nombreux projets de développement sont encore en cours. La position de QS se situe avant tout du côté des redevances minières. On souhaiterait avoir une redevance de 5% sur le brut pour que les minières paient en partie la ressource qui nous appartient, qui appartient au peuple québécois. Le système actuel est un système d’impôt minier qui est complexe et qui est calculé sur la valeur à la tête du puits. Une fois que la minière a déduit ses coûts de production, elle va payer son impôt minier. Or, cet impôt est déductible de l’impôt ordinaire des entreprises. Donc, d’un côté, on leur demande des sous mais de l’autre on leur rend en crédit d’impôt. Ça n’a pas de sens. Ce que nous souhaitons, c’est un 5% sur la valeur brute de l’exploitation de la ressource. Si on fait la conversion avec le système actuel d’impôt minier, le montant de la taxe représenterait entre 1,5 et 3%. La moyenne canadienne se situe autour de 4,5%. Nous sommes donc encore en dessous. Avec un 5% de taxe, en 2018, nous aurions été chercher 200 millions de dollars dans les poches des minières !
ÀB ! : Comment cette position est-elle reçue par la population ? Est-ce qu’il y a une frilosité à taxer une industrie qui apporte énormément à la région ?
C’est en évolution. Cela dépend bien sûr de la façon dont on dépeint les minières. Je suis très consciente que l’industrie minière apporte une vitalité économique, des salaires intéressants, de l’expertise qui s’exporte à l’échelle mondiale. Mais en même temps, lorsqu’on explique aux gens que la taxation que l’on propose est le juste prix de la ressource, ils sont d’accord. Ils comprennent que cela n’a pas de sens que les minières ne paient pas davantage de redevances. Sans compter que l’État contribue également beaucoup au développement de l’industrie minière, par d’autres moyens, comme la formation des travailleurs, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent également que les minières sont philanthropes, qu’elles investissent dans nos milieux, financent des parcs, des arénas. Les minières financent ce qu’elles ont bien envie de financer. Avec un système de redevances efficace, nous déciderons ensemble où et comment cet argent qui nous revient collectivement doit être investi. Et cela ne sera pas forcément là où les minières, elles, pensent faire le plus de gain en terme d’acceptabilité sociale.
ÀB ! : Quels seraient les secteurs d’activité où cet argent pourrait être réinvesti ?
Ces sommes vont faire en sorte que nous pourrons nous doter de fonds de développement pour les régions. L’industrie minière représente 15 à 20 ans d’activités. Qu’est-ce que les gens feront une fois cette exploitation achevée ? Ils devront se réorienter. Si nous sommes constamment axés sur l’industrie minière, dans 15 ans, qu’est-ce qui va nous rester pour occuper notre territoire ? Nous devons nous diversifier. L’agriculture pourra en bénéficier. Le développement de l’agriculture biologique, l’agro-tourisme, l’industrie de la deuxième transformation également. La plupart de nos productions agricoles sont envoyées dans les grands centres pour être transformées. Si nous pouvions rapatrier cette étape en région, clairement, cela créerait beaucoup d’emplois. Dans une perspective environnementale, nous devons développer les filières courtes. Nous pouvons également développer d’autres secteurs qui ne sont pas spécifiquement reliés à l’extraction des matières premières. Je pense par exemple à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) qui développe une expertise en création multimédia et en création numérique.
Vendredi le 14 juin à 17h à la Microbrasserie Le Prospecteur de Val-d’Or (585, 3è avenue), venez rencontrer les créateurs du dossier et plusieurs membres de la revue ! L’événement Facebook est ici.
ÀB ! : On parle également de ressources minières sensibles, comme le lithium, présent dans le sous-sol du territoire abitibien, et largement utilisé dans la production des voitures électriques ou des appareils électroniques. Est-ce qu’on peut craindre que tous les regards se tournent vers l’Abitibi-Témiscamingue dans les prochaines années ?
Le lithium est une composante essentielle quand on parle de convertir la flotte automobile en une flotte de véhicules électriques. C’est un enjeu stratégique. Notre position, ce n’est pas de nationaliser l’exploitation du lithium mais de mettre en œuvre une reprise de contrôle par l’État de cette exploitation. L’État devrait avoir des intérêts privilégiés dans les secteurs névralgiques essentiels pour mener la transition énergétique. J’ai le cas de la mine de lithium de Sayona Mining en tête, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Les gens réclamaient un BAPE pour évaluer les impacts que cette mine pourrait avoir. Nous sommes en faveur de consultations du BAPE peu importe la taille de l’exploitation minière, afin de s’assurer de l’acceptabilité sociale et environnementale de ces projets. Et l’État devrait pouvoir s’assurer que les ressources servent, par exemple, à développer notre propre filière de fabrication de batteries pour les voitures électriques. Cela peut aussi devenir un secteur clé pour l’emploi. Mais même si l’objectif est d’améliorer le sort de la planète, il ne faut pas que l’extraction de telles ressources portent préjudice à l’environnement.
ÀB ! : Il y a également le projet de pipeline de gaz naturel de l’entreprise Gazoduq, qui passerait par l’Abitibi-Témiscamingue afin de rejoindre le Saguenay…
Le passage de ce pipeline aurait des impacts très importants sur l’environnement. Il faudrait traverser des cours d’eau, la rivière Harricana, etc. : ce que nous disons c’est que nous ne voulons clairement pas rendre le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue complice de plus d’émissions de GES dans l’atmosphère. Or, même s’il y a le mot naturel, quand on pense à l’exploitation du gaz naturel, cela n’en fait pas une énergie verte pour autant. Nous faisons un gros travail de sensibilisation auprès de la population pour défaire ce préjugé que le gaz naturel est une énergie verte. Ce n’est pas une énergie de transition. L’entreprise qui envisage de construire ce pipeline dit qu’il s’agit d’une énergie de remplacement, qui sera exportée en Asie et en Europe, vers des pays qui souhaitent réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Mais rien ne garantit aujourd’hui que cette énergie ne sera effectivement qu’une énergie de remplacement et qu’elle ne va pas plutôt s’ajouter aux bouquets des énergies fossiles disponibles au niveau mondial. Il ne faut pas oublier non plus que le pipeline pourrait se rendre jusqu’au Saguenay. Or, au cœur du Saguenay, il y a des aires marines protégées, des aires de reproduction des bélugas. Notre territoire ne peut pas être complice de plus de pression sur l’environnement.
ÀB ! : Comment percevez-vous l’évolution des relations avec les Autochtones ces dernières années, à la suite notamment de l’affaire de la police de Val-d’Or ?
Les meilleures personnes pour répondre, ce sont les peuples autochtones, c’est clair. Du côté de Val-d’Or, ce n’est pas dans mon comté et sans vouloir me défausser, je suis un peu moins au fait des derniers développements. Par contre, du côté du Témiscamingue, nous avons plusieurs communautés qui vivent sur le territoire et nous voyons naître de plus en plus de partenariats entre les communautés autochtones et non-autochtones, pour du développement économique, par exemple, mais également au niveau touristique. Je pense que les gens ont développé le réflexe d’inclure les Autochtones autour des tables de concertation, pour que le développement se fasse de concert, pour que tout le monde participe activement à la mise sur pied des projets. C’est clairement gagnant-gagnant pour toutes les parties.
ÀB ! : Dans le dossier d’À bâbord ! consacré à l’Abitibi-Témiscamingue, un article aborde une particularité culturelle : la scène métal, très vivante. Quels sont à vos yeux les grands enjeux culturels régionaux ?
Il y a de nombreuses initiatives et une formidable vitalité culturelle sur le territoire. Rouyn-Noranda s’autoproclame capitale culturelle. Il y a énormément de festivals d’envergure où on attire de grands noms de la scène musicale oui, mais pas seulement – des arts visuels et des arts de la scène également. Je pense aussi au festival international de cinéma en Abitibi-Témiscamingue. La région produit aussi de grands noms : Richard Desjardins, Raôul Duguay, Diane Tell… Cette vitalité culturelle et toutes ces initiatives contribuent à nous mettre sur la map différemment. Parce que nous sommes très associés aux ressources naturelles, aux mines, à la forêt ou encore à l’agriculture. Si on peut se démarquer autrement, j’en suis la première heureuse. Le tourisme culturel également se développe. La démarche participative Culturat qui consiste à installer des œuvres d’art partout, dans les municipalités, les MRC, les villages, contribue à faire en sorte que nous nous affichons en tant que région culturelle. Ce qui est intéressant, c’est que notre rapport à la culture est très lié au territoire. La relation avec le territoire, à la fois très intime et très identitaire, nourrit énormément les artistes et confère une aura particulière à l’Abitibi-Témiscamingue. Une aura qui donne envie d’y venir et, pourquoi pas, de s’y installer.
Samedi 15 juin à 15h, à la Brasserie artisanale Le Trèfle Noir de Rouyn-Noranda (145 avenue Principale), se tiendra une table-ronde en compagnie d’Émilie Auclair, Guy Leclerc, Marc Nantel et Ariane Turmel-Chénard. L’événement Facebook est ici.
ÀB ! : Un article de notre dossier aborde ce lien très fort au territoire mais aussi à la communauté…
La notion de repères est un élément clé. J’ai fait un court passage à Montréal pour mes études pendant un an et demi. J’ai trouvé cela extrêmement difficile parce que les repères ne sont pas du tout les mêmes. Ici, nous sommes axés sur le territoire. En ce moment [l’entrevue a été faite au mois de mai, NDLR], c’est le printemps qui s’installe. Tous nos sens sont en éveil. On voit les premiers voiliers d’outardes, les chatons apparaissent sur les arbres, quand le petit vert tendre s’installe, c’est le temps de la chasse à l’ours… Notre proximité et notre relation à l’autre sont indissociables de notre rapport au territoire. Nous sommes très dispersés et très peu nombreux également. C’est difficile d’avoir un poids dans la balance des décisions qui sont prises à Québec et je trouve qu’en Abitibi-Témiscamingue, nous avons développé une solidarité impressionnante. Je repense à 2015 quand les libéraux ont mis en place leurs mesures d’austérité, le mouvement Touche pas à ma région s’est déployé dans l’ensemble du Québec mais a pris naissance ici, à Rouyn-Noranda, où les gens se sont vraiment mobilisés. La participation citoyenne est très importante, notamment au sein des différents organismes de concertation, dont les ressources ont été coupées par les libéraux. La CAQ n’a d’ailleurs pas l’intention de ramener ces instances de concertation régionale. Pourtant, nous avions l’impression, avec la conférence régionale des élus notamment, d’avoir voix au chapitre, de participer aux décisions qui nous concernent. Le dicton « diviser pour mieux régner », c’est ce qui s’est passé avec toutes ces coupures budgétaires. Lorsque j’étais administratrice au sein du Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, nous étions quinze administrateurs et administratrices autour d’une même table pour gérer des projets pour et par les jeunes. On gérait une enveloppe de 400 000 $ dans la région. On pouvait financer des projets qui s’adressaient à la jeunesse. Nous avons perdu tout cela.
ÀB ! : Est-ce d’autant plus important de développer des réseaux de mobilisation et de solidarité peut-être plus informels ?
Oui, mais en même temps, quand nous avions la conférence régionale des élus et avant ça les conseils régionaux de développement, une centaine de personnes gravitaient autour de ces instances. Il y avait une équipe de permanents, des employé·e·s qui s’assuraient de faire la coordination entre tous ces acteurs. Actuellement, nous avons un gros problème dans la région avec la pénurie de main-d’œuvre. Elle concerne tout le monde. De nombreuses entreprises ont essayé d’attirer des gens, mais il n’y a pas de places pour les loger, mettre leurs enfants en garderie, on a de la difficulté avec nos infrastructures de loisirs également. Quand nous avions des instances de concertation, tous les représentants de ces milieux travaillaient ensemble, mettaient en place des stratégies pour trouver des solutions et attirer de la main-d’œuvre et faire pression sur les instances politiques. Aujourd’hui, les gens travaillent en silo et c’est plus difficile. Le réseau de la santé a de la difficulté à recruter, l’industrie minière a de la difficulté, le réseau de l’éducation également… À titre de députée, je rencontre toutes sortes d’acteurs mais, parfois, je me sens un peu seule à porter la voix de ma région à l’Assemblée nationale alors qu’avec ce type d’instances de concertation, je pourrais prendre le pouls sur le terrain. Je me dis que mon travail serait plus simple.
ÀB ! : Vous êtes dans un rapport de force avec les centres de décision, Québec et Montréal. Or, ce rapport de force, lorsqu’il s’agit de telles compressions budgétaires, se fait au détriment des régions…
C’est aussi une question de poids démographique. Ici, nous avons 1,6% de la population du Québec. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de défis à relever, bien au contraire. Je dois défendre des enjeux de ponts et d’infrastructures, de transports en commun, de piscines municipales, d’eau potable. J’ai une municipalité qui risque de perdre non seulement son eau potable mais aussi son réseau de distribution. Il y a 80 maisons dans le village mais, un beau matin, les habitants pourraient se retrouver sans eau potable tellement le réseau est déficient. Le refaire à neuf leur coûterait 20 millions de dollars. Donc, si nous n’avons pas un appui significatif du gouvernement, nous n’y arriverons juste pas. Mes collègues élu-e-s à Montréal n’ont pas ce genre d’enjeux à défendre. Oui, il s’agit de 80 maisons, mais si demain il n’y a plus d’eau, le risque c’est qu’il n’y ait plus non plus de village. Les gens partiront. Est-ce que c’est ce que nous voulons ? Si nous rencontrons des difficultés à faire entendre notre voix et reconnaître nos enjeux, c’est parce que nous sommes peu nombreux et qu’il est compliqué de peser dans la balance. Pourtant, c’est l’occupation du territoire qui est en jeu ici.
ÀB ! : La dynamique créée autour de votre élection peut-elle porter QS et est-ce que vous vous dites que vous pourriez remporter plus qu’une circonscription en Abitibi-Téminscamingue ?
Ah mais c’est sûr, c’est sûr ! Et défendre l’autonomie des régions comme nous le faisons, c’est un de mes chevaux de bataille. Toutes les propositions de QS s’appliquent aux régions. Quand on parle de gratuité scolaire, du milieu d’où je viens on quitte la maison à 17 ans pour aller faire des études post-secondaires, parce que les centres universitaires sont éloignés. C’est le cas dans de nombreuses régions. L’UQAT n’offre pas tous les programmes et nous n’avons pas d’autre choix que de quitter la maison. On doit prendre un appartement, payer son loyer, des factures d’hydroélectricité, d’épiceries, etc. Parce que nous sommes éloignés, notre scolarité nous coûte plus cher. Donc, la gratuité va également servir aux gens des régions. C’est un exemple parmi de nombreux autres. Quand on pense également à développer davantage une agriculture de proximité, une industrie de deuxième transformation, l’agro-tourisme également… ce sont des positions que nous portons à QS et je me fais un devoir de propager ces idées dans nos régions.
Propos recueillis par Rémi Leroux