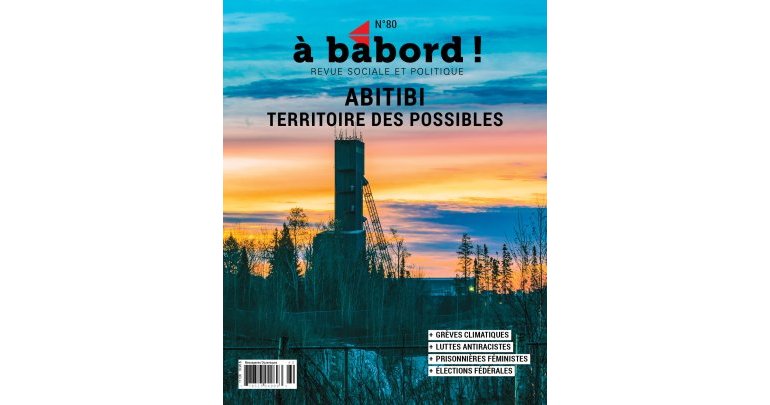Mémoire des luttes
Au coeur de la prison. Le Front de libération des femmes du Québec
En mars et avril 1971, à la prison Tanguay, les militantes du Front de libération des femmes (FLF) ont vécu avec les prisonnières de droit commun une expérience de solidarité féministe unique dans nos annales. En plus de réaliser un travail de conscientisation féministe et de défense des droits des prisonnières, elles ont tissé avec elles de profonds liens de confiance et de sororité sociale et politique. Retour sur une lutte peu ordinaire tombée dans les limbes de l’Histoire.
L’action des jurées du 1er mars 1971
Sous la Loi des mesures de guerre, sept militantes du Front de libération des femmes du Québec prennent d’assaut le banc des jurés en pleine séance de la cour au Centre de détention Parthenais, à Montréal, où se tiennent les procès reliés à la Crise d’octobre. L’objectif de cette action : mettre le nouveau féminisme sur la carte en dénonçant, d’une manière radicale, la disposition discriminatoire qui interdit aux Québécoises d’être jurées. Condamnées sur-le-champ à un et à deux mois de prison pour outrage au tribunal, les militantes sont incarcérées à Tanguay, la prison provinciale des femmes au nord de la ville.
Le 1er mars 1971, vers 10 heures du soir, nous débarquons dans la section des « condamnées » de la prison des femmes qui porte le nom de Maison Tanguay. Nous remarquons tout de suite l’ironie de l’appellation : la prison des femmes est une « maison » ! Une maison où le travail d’entretien de l’institution est réalisé gratuitement par nous, les prisonnières, alors qu’à côté, les prisonniers de Bordeaux sont payés pour accomplir ce travail ; « nous sommes toutes des prisonnières politiques ! » sera ainsi le premier slogan que nous ferons circuler en prison.
C’est à la cafétéria, le 2 mars au matin, que nous rencontrons pour la première fois nos futures compagnes dont nous percevons le regard méfiant. Elles nous apprendront plus tard que la directrice de la prison les a rassemblées ce matin-là pour leur dire de ne pas nous faire confiance et de n’avoir aucun rapport avec nous parce que nous étions de dangereuses révolutionnaires.
Militer en prison
À la fin de cette première journée où nous sommes assignées à différents travaux forcés, nous tenons notre première réunion où nous projetons de tenir un journal de prison. Nous devrons toutefois abandonner ce projet tellement la réalité à laquelle nous serons confrontées nous déstabilisera et exigera de nous une incroyable somme d’énergie physique et psychologique. C’est au fil de la découverte, jour après jour, des injustices vécues par les prisonnières que nous déciderons des gestes militants à poser. Et toujours, nous analyserons nos actions à l’aulne de la prudence pour ne pas nuire à nos compagnes après notre départ de Tanguay.
Ce qui nous frappe d’abord, c’est l’omni-présence de l’arbitraire et du non-respect des droits des détenues ainsi que l’absence totale de règles collectives. Nous sommes aussi consternées par le manque aberrant d’activités constructives, tant pour la réinsertion que pour les loisirs, alors que nos voisins de Bordeaux peuvent terminer leur scolarité et suivre des cours de métier.

Le 4 mars, nous réclamons les règlements de la prison et l’accès à la cour et au gymnase pour toutes (« prévenues » et « condamnées »), les prisonnières n’ayant pas pris l’air depuis un mois. Nous n’obtenons que l’accès au gymnase, une victoire tout de même importante, car ce gymnase encore tout neuf n’avait jamais été utilisé depuis l’ouverture du pénitencier en 1964. La sortie dans la cour ne sera obtenue que durant la troisième semaine de notre détention.
C’est dès cette première semaine que les prisonnières de droit commun nous rejoignent dans notre section, l’aile B2 nord. La direction, qui souhaitait nous isoler, avait dû accepter leurs demandes pour acheter la paix. Chaque soir, dans la salle commune, nous écoutons nos nouvelles camarades nous raconter leur vie. Elles nous dévoilent des situations d’exploitation que nous ignorions. Nous sommes émerveillées par leur lucidité et leur courage, mais révoltées par les récits de leurs parcours de vie douloureux et surtout par les motifs de leur emprisonnement. Leurs crimes ? Être nées femmes et pauvres. Leurs délits (petits vols, fraudes mineures, prostitution), responsables comme aujourd’hui de la plupart des courtes peines au provincial, étaient en relation directe avec leurs conditions de pauvreté et à leurs liens avec des hommes qui, eux, n’étaient pas inquiétés par la police.
Le 8 mars, nous envoyons une lettre à la directrice en lui demandant de nous rencontrer. Mais celle-ci ne daigne pas nous répondre et la soirée de la Fête internationale des femmes se termine dans une discussion avec nos sœurs sur les conditions de détention. Le lendemain 9 mars, nous faisons la grève en refusant de nous rendre à nos lieux de travail pour faire pression sur la directrice. Elle acceptera finalement de nous recevoir : s’ensuivra une confrontation épique où la complicité solidaire avec nos compagnes de droit commun s’exprimera dans une véritable pièce d’anthologie ! Nous présentons à la directrice la liste de nos revendications, notamment le droit effectif de parler à son avocat au besoin, un droit élémentaire dont nos compagnes étaient régulièrement privées. À partir de cette confrontation du 9 mars, nous créons un véritable rapport de force avec la direction. Nous connaissons surtout le bonheur de vivre une alliance béton avec nos sœurs de détention, qui prennent conscience non seulement de leurs droits, mais aussi de la puissance et de l’efficacité de la solidarité. Cet événement « historique » sera ébruité chez les « condamnées » des autres sections et lors du repas du soir, elles se présentent à la cafétéria avec le cri de ralliement du FLF « Québécoises debouttes ! » affiché sur leurs vêtements !
Environ une semaine plus tard, à la suite d’une annulation injustifiée de sortie dans la cour, nous récidivons avec une autre manifestation, en complicité cette fois avec l’ensemble des prisonnières de Tanguay : ce sera un bruyant sit-in lors du repas du midi. En faisant claquer joyeusement nos ustensiles sur la vaisselle, nous refusons en bloc de nous lever de table tant que l’interdiction ne sera pas supprimée. Ce sera une autre victoire percutante qui enflammera d’espoir le milieu débilitant de Tanguay.

Nos dernières manifestations de résistance collective auront lieu lors de deux événements spéciaux au cours desquels la prison ouvrait ses portes à des observateurs et des observatrices de l’extérieur. La première fois, lors de la visite d’un groupe d’inconnu-e-s derrière la vitrine de la salle commune de notre section. Et la deuxième, lors de la danse annuelle des étudiantes de criminologie. Il s’agissait de visites intrusives qui humiliaient nos compagnes : avec les moyens du bord, nous tournerons en dérision ce voyeurisme indécent.
Une lutte inachevée
C’est dans une promiscuité et une intimité quotidiennes permanentes que nous partagerons les peines et les misères de nos compagnes de droit commun. Parler du FLF et du sens libérateur de notre lutte, ce sera d’abord nous tenir au plus près du cœur et de la souffrance de nos sœurs. Dans une franche complicité, nous expérimenterons avec elles ce que signifient la sororité féministe et le fait que « le privé est politique ». Pas étonnant qu’elles voudront toutes entrer au FLF !
Nous émergerons péniblement de cette plongée douloureuse dans la réalité de la prison Tanguay ; nous en sortirons convaincues que l’enfermement est inapproprié pour ces femmes. C’est aussi le constat que formulent, 50 ans plus tard, plusieurs groupes et spécialistes qui connaissent bien les enjeux sexo-spécifiques de l’incarcération [1]. L’inhumanité scandaleuse et discriminatoire des conditions carcérales vécues actuellement par les femmes détenues à la prison Leclerc et la violation systématique de leurs droits fondamentaux n’ont fait que renforcer notre conviction : les prisons provinciales pour femmes, fausses solutions catastrophiques à des problèmes sociaux systémiques, doivent être abolies !
[1] Voir Nicole Filion et Mélanie Sarazin, « Quand l’austérité s’en prend aux détenues », À bâbord !, no 68, mars 2017 ; Arij Riahi, « Vol à l’étalage. La fabrique de criminelles », À bâbord !, no 74, mai 2018. NDLR.