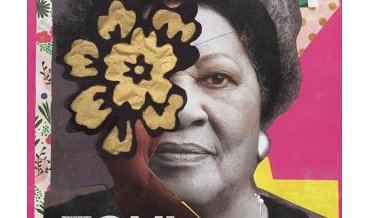Blanches
,
Autour d’une table ronde sur les femmes et la littérature.
Tu te souviens ?…
Oui, il fallait parler des conditions dans lesquelles nous publions, existons, sommes diffusées, tout en occultant l’autre question, poursuivant notre aveuglement au nom d’un universalisme. Tu étais là, avec ta certitude antiraciste, comme une chape de plomb sur tes épaules. Mais tu étais désaccordée, entre ta pensée, tes gestes, tes mots.
Si le mot « blanches » avait été écrit dans le titre de l’événement, tu n’aurais pas participé. Non, jamais. Tu n’aurais pas osé. Tu aurais eu la nausée. Tu aurais pensé immédiatement, en lisant le titre : « Non, ce n’est pas moi, ça ne s’adresse pas à moi, je ne peux pas m’associer à ça. »
S’il y avait eu le mot « blanches », dans le titre, s’il n’y avait pas eu de blanc pour l’effacer, tu aurais rougi. Tu aurais eu honte d’avoir été invitée à un tel événement. Tu aurais été heurtée, offensée, tu aurais refusé d’appartenir à cette catégorie, aux allures de suprématie, parce que tu aurais refusé d’exclure. Même si tu es blanche et que le mot, s’il avait été utilisé, aurait été le bon, tu aurais refusé de porter cette identité. Tu l’aurais niée parce qu’elle t’était renvoyée, imposée, collée sur la peau, et qu’on te forçait dès lors à te voir dans un miroir. Toi et ta mauvaise foi. Tu te serais reconnue dans l’attribut, tu aurais pensé : « Oui, je suis blanche », mais dans un même élan, tu aurais résisté. Et tu aurais dit non. Fortement. Parce que comment accepter de porter cette peau toujours innommée, cette peau invisible et aveugle à force d’être blanchie de toute responsabilité ?
Cette fois-là, il n’y avait pas le mot « blanches », et pourtant, autour de la table, toutes l’étaient, et toutes avaient été choisies, et tu en faisais partie. Et quand tu as été capable de voir, enfin, ce qui se passait, il t’est arrivé ce que Houria Bouteldja décrit dans Les Blancs, les Juifs et nous (La Fabrique, 2016) :
Vous « découvrez » que vous êtes blancs lorsque nous vous nommons « Blancs ». En fait vous ne découvrez rien. Vous répugnez juste à être nommés, situés et qu’ainsi soit dévoilée votre culpabilité et rendue vulnérable votre immunité.
Et si tu te demandais de qui tu étais l’instrument, toi la femme de personne ? Et si tu acceptais de reconnaître l’angle mort, de faire tomber les ornières et d’ouvrir les yeux ?
Tu étais depuis toujours engagée, résistante, les poings fermés, prête à bondir au nom de toutes les inégalités. Et soudain, la réalité te rattrapait, te mettait K.O. Tu allais parler « speak white » à ton grand désarroi. Tu allais exercer tes privilèges, ou les perdre en prenant la parole au nom des absentes comme si tu te faisais prendre la main dans le sac. Tu étais qui pour prétendre transformer le jeu des forces par lesquelles s’exerce le pouvoir ?
Autour de la table : des femmes, blanches, qui écrivaient, ici, maintenant. Et devant un titre qui, sans s’en rendre compte, oubliait le blanc, tu as oublié, pendant quelques instants, qui tu étais vraiment. Tu n’étais peut-être pas coupable, comme Houria Bouteldja le dit, mais tu étais certainement responsable. Et maintenant que tu as ouvert les yeux, maintenant que tu vois, tu es responsable de ne plus porter le visage de l’innocence. Tu dois te défaire du masque de l’ange. Ta peau, à toi. Parce que tu fais partie des géants, que dans ce monde où tu te bats sans cesse contre les violences faites aux femmes, petites et grandes, tu es pourtant capable d’oublier que ta peau te range du côté de l’absolu et de l’absolution.
« Si votre histoire vous a faits Blancs, rien ne vous oblige à le rester »
écrit Houria Bouteldja.
Il faut plus que des vœux pieux et une bonne conscience. Il faut accepter de se mettre en jeu. Et ça commence avec ce geste qui consiste à admettre que si l’attribut « blanches » avait été accolé au mot « femmes », tu n’y serais pas allée, et peut-être pas, malgré tout, pour les bonnes raisons. Ça commence avec l’admission que devant le mot « femmes », tout seul comme s’il incluait toutes les femmes (alors même que les noms des intervenantes ce jour-là étaient ceux de femmes blanches), tu es restée. En tenant d’abord pour acquis que la lutte des femmes représente une lutte en soi. En pensant, ensuite, que cette rencontre-là, de femmes blanches qui ne se disaient pas blanches, pouvait devenir le lieu d’une vraie discussion où on parlerait enfin de l’exclusion. Que cette rencontre pouvait être l’occasion d’une sorte de putsch.
Mais le putsch n’a pas eu lieu. Tu n’as pas eu le courage de l’imposer. Tu as fait des efforts, mais ce n’était pas assez. Le statu quo l’a emporté. Les pantoufles de la pensée. Et après, tu as eu honte.
Voilà. Tu étais devenue blanche. L’opération était réussie. Tu avais trahi ta mère, ta grand-mère en troquant leurs sempiternelles robes de deuil d’Italiennes du Sud pour la modernité, le prêt-à-porter. Tu avais trahi toutes celles que pourtant tu avais toujours cru être capable de défendre dans tes cours, dans tes écrits, dans ta vie de tous les jours. Tu ne cousais pas, tu ne brodais pas. Tu avais voulu t’affranchir, devenir une femme libre. Paradoxalement, l’éducation avait éclairci ton teint. Ce soir-là, à cette table, tu avais l’air d’une femme ordinaire. Personne ne t’a demandé d’où tu étais, si le français était ta langue maternelle. Tu étais représentée, tu n’étais pas une invitée de service, une manière de soulager les consciences, la femme qui vient rétablir l’équilibre sur un panel et donner l’impression que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce soir-là, le coq n’a pas chanté comme dans l’Évangile de saint Marc, mais le lendemain ta fille t’a rappelé avec aplomb que tu étais blanche.
« Pourquoi ne vous décidez-vous pas à porter vos valises ? »
demande Houria Bouteldja.
D’abord, te rendre compte que tu as une valise. Ensuite, l’ouvrir, déballer ce qu’il y a dedans, sortir un à un les mots, les clichés, les préjugés, les lieux communs, parce que si tu crois que tu n’en as pas, c’est qu’ils sont bien cachés. Déplier, enfin, ton assurance, la marque de ton privilège. Sortir le passeport qui te permet de circuler sans penser que tu risques de payer le prix non seulement de ton sexe, de ta sexualité, de ce corps-là avec lequel tu es née, mais le prix de ta couleur de peau, la sonorité de ton nom, la musique qui sort de ta bouche, les origines de tes parents, les gens que tu aimes, ceux avec qui tu flânes, le quartier dans lequel tu vis, les frontières que tu traverses, les villes et les pays où tu te rends.
Porter tes valises. Porter ton nom. Porter ce mot qui nomme la couleur de ta peau. Blanche. C’est la seule façon de faire ce que Houria Bouteldja nous enjoint à faire.
« Changez de panthéon. »