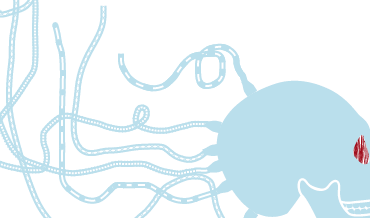Dossier : Bibliothèques. Enjeux et mutations
Pour le libre accès aux publications scientifiques
Depuis les années 1990, le monde de l’édition scientifique est en crise. On assiste en particulier à une hausse considérable du coût des revues en raison d’un nouveau modèle d’affaires : les forfaits d’abonnements ou bouquets de revues remplacent les abonnements individuels à des revues spécifiques, pratique nouvelle favorisée par la concentration des éditeurs commerciaux.
Les bibliothèques universitaires sont ainsi obligées de souscrire à des bouquets de revues comprenant de nombreux titres même si certains ne répondent pas à leurs besoins. L’arrivée d’Internet et l’évolution du Web promettaient d’élargir l’accès aux revues, mais la hausse des coûts freine cette ouverture. Pourtant, le développement des revues électroniques a permis de réduire les coûts que devaient assumer les éditeurs (impression, diffusion, etc.).
Aujourd’hui, cinq grands éditeurs à but lucratif (Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis et Sage) concentrent une grande partie de la production scientifique [1]. « En effet, alors que les cinq premiers éditeurs représentaient 15% des articles en 1995, cette valeur a atteint 66% en 2013. Encore pire, les trois éditeurs les plus importants – Reed-Elsevier, Taylor & Francis et Wiley-Blackwell – représentent près 50% de tous les documents en 2013. [2] »
Le travail scientifique devient ainsi la propriété d’éditeurs commerciaux qui le revendent très cher aux universités. Des fonds publics financent donc et la recherche et l’accès aux résultats de la recherche…
De la crise de l’édition scientifique au mouvement du libre accès
C’est dans ce contexte que le mouvement du libre accès aux publications scientifiques prend son envol. Plusieurs archives ouvertes voient le jour dans les années 1990 telles qu’ArXiv (1991), NetEc (1993) et CogPrints (1997). Elles constituent des réservoirs de documents en libre accès (articles déjà publiés ou non, thèses, etc.). En 1994, Stevan Harnad lance le premier appel à l’auto-archivage des publications scientifiques. Il s’agit d’un jalon important dans la réflexion sur la réappropriation, par les chercheurs·euses, de leurs droits sur leurs travaux et sur les possibilités qui s’offrent pour les partager. Au début des années 2000, plusieurs initiatives et déclarations structurent le mouvement du libre accès. On peut mentionner l’Initiative pour les archives ouvertes (1999), l’Initiative de Budapest en faveur de l’accès libre (2002), la Déclaration de Bethesda pour l’édition en libre accès (2003) ainsi que la Déclaration de Berlin sur le libre accès (2003). Le libre accès, par ailleurs, est défini par les signataires de l’Initiative de Budapest comme suit : « Par “accès libre” à cette littérature, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l’Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s’en servir de données pour un logiciel, ou s’en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l’accès et de l’utilisation d’Internet. La seule contrainte sur la reproduction et la distribution, et le seul rôle du copyright dans ce contexte devrait être de garantir aux auteurs un contrôle sur l’intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnus et cités. [3] »
Depuis l’Initiative de Budapest, on parle de deux voies pour le libre accès : la voie dorée, qui consiste à publier un article dans une revue en libre accès, et la voie verte, qui implique d’auto-archiver des publications scientifiques dans une archive ouverte.
Dans certaines communautés scientifiques, le libre accès a été rapidement adopté puisqu’il permet de rendre plus accessibles les travaux et les résultats de recherche. Il est donc perçu comme pouvant améliorer la productivité des scientifiques en maximisant le rayonnement et l’impact des recherches, mais aussi des universités. Dans la perspective de la société du savoir, il est également conçu comme une manière de démocratiser l’accès aux ressources scientifiques auprès de différents publics. Le libre accès est également vu par certains comme un outil de l’économie du savoir permettant de stimuler l’innovation commercialisable. Les éditeurs commerciaux ont justement vu dans le libre accès une nouvelle occasion d’affaires et l’ont adopté pour certaines revues ou pour des articles en transférant le coût des lecteurs·trices aux auteur·e·s, ce qu’on appelle le modèle auteur-payeur.
Désabonnement et boycottage
Confrontées à la hausse des prix des abonnements aux revues, les bibliothèques universitaires continuent de se désabonner, donc à couper dans l’offre. Pour faire face à cette hausse, plusieurs universités québécoises ont d’ailleurs révisé leurs abonnements, réduit les achats de livres et aboli des postes. En 2017, l’Université de Montréal annonçait le désabonnement à des milliers de titres de revues. Parallèlement à ce phénomène, des campagnes de boycottage ont été organisées telles que la campagne The Cost of Knowledge, lancée en 2012 par le mathématicien britannique Timothy Gowers contre le géant Elsevier. Gowers s’engageait notamment à ne plus publier et à ne plus évaluer d’articles chez cet éditeur. De nombreuses universités ont également menacé de boycotter les grands éditeurs commerciaux. D’autres, comme c’est le cas de plusieurs universités allemandes, ont récemment mis fin à leurs abonnements chez Elsevier. En 2015, toute l’équipe du comité de rédaction et du comité scientifique de la revue Lingua a démissionné devant le refus d’Elsevier d’adopter un modèle de libre accès autre que le modèle auteur-payeur et a créé une nouvelle revue en libre accès, Glossa.
Le rôle des bibliothécaires
Les bibliothécaires jouent depuis le tout début un rôle fondamental dans le mouvement du libre accès aux publications scientifiques. D’une part, ils ont été les premiers à tirer la sonnette d’alarme sur la crise engendrée par la hausse du coût des abonnements aux revues. D’autre part, ils ont contribué à l’élaboration de solutions. Par exemple, l’Association des bibliothèques de recherche a mis en place en 1998 la Coalition de l’édition savante et des ressources académiques (SPARC en anglais) pour trouver des solutions à la crise des périodiques, notamment par le biais du libre accès et du développement des archives ouvertes. Aujourd’hui, toutes les universités québécoises, à l’exception de HEC Montréal, ont un dépôt institutionnel. Les premiers ont été développés à partir de 2005 à l’UQAM (Archipel) et à l’Université de Montréal (Papyrus) et le dernier a été lancé en 2016 à l’Université Laval (CorpusUL). Nombre de bibliothécaires sensibilisent les chercheurs·euses et les étudiant·e·s sur ces enjeux et développent des outils pour favoriser la publication en libre accès et l’auto-archivage des publications dans les dépôts institutionnels dont ils sont responsables.
Le libre accès est-il généralisé aujourd’hui ? Non. Des résistances importantes subsistent. D’une part, les publications scientifiques composent un marché extrêmement lucratif pour les éditeurs commerciaux. D’autre part, il y a beaucoup de réticences chez les chercheurs·euses. Si plusieurs arguments favorables au libre accès sont partagés tels que la démocratisation de l’accès aux savoirs, cela se traduit peu dans les pratiques de publication et de diffusion. Les dépôts institutionnels sont encore sous-utilisés. De plus, plusieurs méconnaissent les options existantes pour conserver leurs droits sur leurs travaux comme les licences libres (par exemple, les licences Creative Commons) ou encore la pratique d’addenda au contrat. Les universités et les organismes de financement de la recherche sont pourtant de plus en plus favorables au libre accès comme le démontre la récente politique de libre accès aux publications des trois organismes fédéraux (CRSH, CRSNG, IRSC) [4].
Peut-on imaginer de relocaliser l’édition scientifique au cœur des bibliothèques universitaires pour qu’elles deviennent des lieux de publication ? Après tout, à l’ère du numérique, les articles pourraient tout simplement être évalués puis déposés sur un site web ou dans un dépôt institutionnel sans passer par les revues, comme le propose le projet Episciences. Mais à l’époque du « publier ou périr », les chercheurs·euses sont-ils prêts à délaisser le prestige et le capital symbolique conférés par les revues dans lesquelles ils publient ? Sont-ils prêts à s’intéresser davantage à la qualité des textes plutôt qu’à la revue dans laquelle ils sont publiés et à leur facteur d’impact ?
[1] On retrouve également une diversité d’éditeurs commerciaux ou sans but lucratif comme les presses universitaires et les sociétés savantes.
[2] Vincent Larivière, Stefanie Haustein et Philippe Mongeon, « L’oligopole des grands éditeurs savants », Découvrir, 2015.