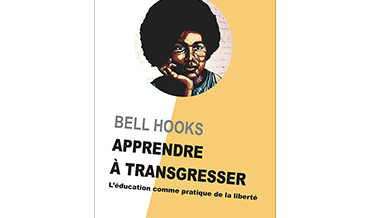Sortie des cales
Liberté académique. Quand l’État défend la liberté pour mieux l’étouffer
Déjà presque deux ans depuis la polémique entourant l’utilisation du mot en « N » à l’université d’Ottawa. Depuis, professeur·es, chroniqueur·euses et politicien·nes ne cessent de s’insurger devant de prétendues menaces à la liberté académique, toujours plus nombreuses et plus graves. Peu s’indignent toutefois des barrières systémiques, bien réelles, qui freinent le parcours universitaires des étudiant·es noir·es, autochtones et racisé·es.
Le mercredi 6 avril, la ministre responsable de l’enseignement supérieur Danielle McCann a déposé le projet de loi 32 visant à réglementer la liberté académique au sein du milieu universitaire. L’objectif est de garantir un enseignement qui puisse s’exercer sans contrainte « doctrinale, idéologique ou morale ». Velléité ronflante de rectitude morale et d’éthique, mais qui est loin d’illustrer la réalité du modèle proposé. Déjà, des critiques ont été émises sur le fait que ce projet de loi, dans sa formulation actuelle, représente plutôt un recul pour le milieu universitaire. Par exemple, plusieurs éléments importants de la définition de la liberté académique sont écartés : il y manque la reconnaissance du droit aux membres enseignant·es de critiquer publiquement l’institution à laquelle iels appartiennent. De plus, l’article 6 du projet de loi prévoit que le ministère de l’Enseignement puisse dicter la politique d’un établissement universitaire « lorsqu’il l’estime nécessaire », ce qui contrevient au principe même de la liberté académique qui vise, entre autres, à assurer l’indépendance des universités vis-à-vis du gouvernement.
En somme, ce projet de loi est un véritable nœud coulant proposé au milieu académique et des alertes sont soulevées par le corps enseignant avec raison. Par contre, ces dernier·ères ont tellement travaillé à en tresser la corde que j’ai du mal à ressentir la moindre empathie maintenant qu’on leur demande de se la passer au cou. Je m’explique : dans les débats et les critiques entourant le projet de loi, très peu prennent la peine de rappeler le contexte ayant mené à ce que le législatif s’en mêle. Je rappelle que ce projet de loi a été proposé en réaction à des situations très médiatisées sur des propos déplacés tenus en salle de classe par des membres du corps enseignant. Face aux plaintes d’étudiant·es et aux demandes d’imputabilité, le corps enseignant est massivement monté au créneau. La cacophonie qui s’ensuivit a été particulièrement assourdissante : pétition, chronique radio, interview et articles d’opinion ont fleuri dans tous les coins. Le propos global : iels sont victimes de censure. En justification ? L’impossibilité d’utiliser le mot en « N » sans conséquence ! Leurs ennemis ? Le « wokisme » !
Quel danger pour quelle liberté ?
Notez tout de même le doux paradoxe d’individus ayant accès à un maximum de plateformes médiatiques, et s’en servant ad nauseam, pour expliquer qu’iels sont les grandes victimes… de censure. On notera également dans les textes de ces pourfendeurs·euses d’injustice et ces vengeur et vengeresses de la liberté d’expression l’argument de vouloir défendre le corps étudiant. Parce qu’après tout, si iels réagissent avec autant de vergogne, c’est pour assurer à leurs étudiant·es un droit au débat et un espace où tout peut être discuté. Pour autant, si la pluralité de la pensée et des points de vue est si chère à ces professeur·es, on peut s’interroger sur leur quasi-absence de réactions, année après année, lorsque le milieu scolaire de manière globale est épinglé sur son manque de représentativité. Je rappelle qu’au Canada, seulement 2 % des professeur·es à l’université s’identifient comme noir·es. Cette même homogénéité raciale se reflète au sein du corps étudiant au fur et à mesure qu’on gravit le niveau d’étude.
Ainsi, le taux d’abandon des étudiant·es noir·es, par exemple, reste plus élevé que la moyenne de la population. Parmi les multiples facteurs menant à ce désengagement, comme la pauvreté ou le harcèlement scolaire, on note également le racisme des professeur·es ainsi que l’absence de professionnel·les noir·es au sein de l’académie. Par exemple, arrivée en doctorat, j’étais habituée à ne jamais voir d’enseignant·e, de chargé·e de cours ou même d’auxiliaire noir·e dans mon département, et à ne croiser que très peu d’autres étudiant·es noir·es.
Difficile, dans ces conditions, de ne pas prendre comme une gifle la réaction gargantuesque des professeur·es pour défendre leur droit à dire le mot en « N ». De surcroit, ces incidents surviennent à la fin 2020, une année marquée par la mort de Georges Floyd et par des manifestations massives pour la défense de la vie des Noir·es. Pour des professionnel·les si obsédé·es par la protection de leurs étudiant·es, les expériences et vécus des étudiant·es les plus marginalisé·es ne semblent pas particulièrement les émouvoir.
D’ailleurs, où se trouve cet élan de mobilisation lorsqu’il s’agit de dénoncer les multiples cas de violence et harcèlement sexuel commis en toute impunité par leurs collègues ? Ou pour dénoncer l’inaccessibilité de l’université, dont la structure capacitiste n’est plus à démontrer ? Pour lutter contre l’écrémage des étudiant·es noir·es et autochtones par de multiples systèmes de discriminations imbriqués ? S’insurger contre l’augmentation des frais de scolarité et la privatisation de l’enseignement qui ne font que maintenir à l’écart les populations les plus précaires ?
Dénoncer la violence déchainée commise envers les étudiant·es et les travailleur·euses qui osent parler de racisme systémique, enseigner la décolonisation et dénoncer la suprématie blanche dont le milieu universitaire est un outil précieux ?
Une menace montée de toute pièce
Dans ce même ordre d’idées, difficile de ne pas lire tout le mépris et la condescendance des écrits de ces mêmes professeur·es qui mélangent avec une absence de rigueur à en saigner du nez des termes qu’iels ne maîtrisent pas. « Wokisme », « pensée anti-libertaire », « racialiste », « wokisme liberticide », « dogmatisme universitaire » – et j’en passe et de meilleurs – ont été balancés de tous les côtés. Tout cela ne rendait que plus saillante leur mauvaise foi intellectuelle. Comment expliquer, sinon, la capacité d’afficher avec autant de désinvolture leur méconnaissance généralisée de décennies de recherches rigoureuses et de développement de pédagogie anti-oppressive ?
Finalement, le projet de loi 32 a été présenté comme un moyen de « mettre fin à la censure dans nos universités ». Mais qui a monté de toutes pièces cette soi-disant menace de censure, si ce n’est ces enseignant·es réactionnaires s’insurgeant à la moindre critique des rapports de pouvoir internes à l’Académie ? Qui a offert sur un plateau d’argent l’opportunité parfaite à un gouvernement profondément anti-intellectuel·les de resserrer la vis à l’université ? La liberté académique, dans sa définition, je le rappelle, a aussi une dimension de responsabilités : la responsabilité de l’individu et de la communauté universitaire des conséquences de leur travail. Pourtant, lorsque le damné a émergé comme questionneur, penseur et théoricien pour demander des comptes au corps enseignant, ce dernier a préféré travailler activement à sa perte plutôt que de se regarder en face [1]. Comme on dit : on récolte ce que l’on sème et il semble que le temps de la récolte soit venu.
[1] Nelson Maldonado-Torres, « Outline of Ten Theses on Coloniality and Decoloniality », Fondation Frantz Fanon, 2016. En ligne : https://caribbeanstudiesassociation.org