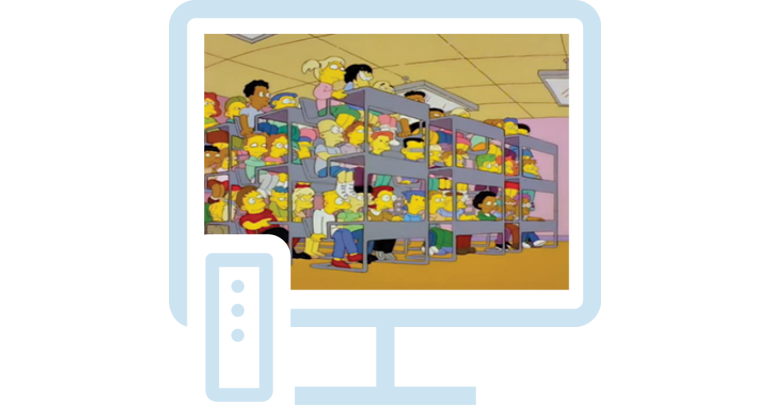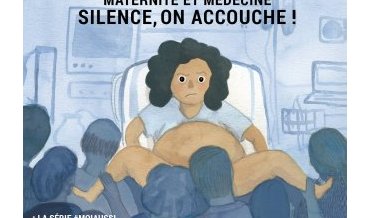Chronique Éducation
Le bourbier suédois du capitalisme scolaire
Au tournant des années 1960, accusant le modèle scolaire de l’État-providence d’être inefficace et contre-productif, Milton Friedman appelle à la dénationalisation de l’organisation scolaire. Au menu : une dérégulation favorable à la « liberté de choix » soutenue par des bons d’éducation (vouchers). La Suède s’y est employée dès les années 1990 et s’en mord aujourd’hui les doigts.
Comme dans d’autres pays occidentaux, l’État-providence suédois fait l’objet d’importantes remises en question dans les années 1980, y compris en matière d’éducation. L’école, dit-on, doit être plus diversifiée, moins rigide, plus efficace. Au tournant des années 1990, et dans le contexte d’une crise économique, les gouvernants troqueront le système centralisé pour un régime de marché scolaire.
Dès 1988, une première réforme transfert aux 290 municipalités plusieurs responsabilités, dont l’organisation scolaire et la gestion des ressources humaines, tandis que méthodes pédagogiques et horaires échoient aux établissements. L’État n’aura alors plus qu’à assurer le financement des municipalités, définir les programmes et orientations et piloter les évaluations nationales. À cette décentralisation administrative s’ajoutera rapidement une autre réforme, encore plus radicale. En 1992, le gouvernement conservateur abolit la carte scolaire et introduit les bons d’éducation (skolpeng). Désormais, chaque famille pourra inscrire son enfant dans l’école de son choix, où qu’elle se trouve, et sans sélection – la seule limite étant la place disponible. L’établissement choisi recevra le financement prévu pour chaque inscription, qu’il soit public ou, s’il répond à certaines normes, privé – on parle alors d’une « école libre » ou indépendante (friskola).
En contrepartie de la pleine subvention gouvernementale par élève (100 %), la friskola ne peut percevoir d’autres frais de scolarité. En revanche, l’entité opérant ladite école peut être à but non lucratif (école alternative, école confessionnelle, école spécialisée en adaptation scolaire) ou à but lucratif. C’est ainsi que, rapidement, ont émergé des écoles primaires et secondaires privées généralistes, entrant directement en concurrence avec les écoles publiques et proposant des modèles d’organisation scolaire axés sur la rationalisation des ressources, la performance et la rentabilité. De véritables chaînes d’écoles indépendantes dominent désormais le marché suédois, opérant des dizaines de succursales. Les principales appartiennent à des fonds d’investissement spéculatifs parmi les plus importants d’Europe et étendent leurs activités sur des marchés scolaires étrangers. Leurs bénéfices annuels se comptent en millions d’euros et leurs chiffres d’affaires en milliards. Certaines sont cotées en bourse.
Aujourd’hui, la Suède compte 1 250 friskolor [1], concentrées dans les deux tiers des communes et opérées pour plus des deux tiers par des entreprises à but lucratif. En 2018, 15 % des élèves de l’école obligatoire (7-16 ans) fréquentaient le réseau privé (contre 1 % en 1988) et 27 % au lycée (17-19 ans). À Stockholm, plus de la moitié des élèves fréquenteraient une école privée ou indépendante.
La chute de l’ange
Si certaines écoles indépendantes réussissent à tirer leur épingle du jeu en affichant de bonnes performances dans les tests nationaux, l’effet global de la compétition scolaire demeure mitigé, voire discutable. D’après plusieurs études, les écarts de résultats observés entre les réseaux public et privé en fin de parcours secondaire ne seraient pas significatifs. En 2011, l’un des think tanks les plus influents de Suède concluait même à l’échec des privatisations scolaires sur la qualité éducative. L’inflation des résultats est l’une des dimensions du problème. De fait, la concurrence aurait induit une pression à gonfler les notes des élèves pour maintenir l’image de marque des établissements privés, dès lors surfaite. À cela s’ajoute l’insuffisance de l’inspection nationale quant à la qualité de ces établissements.
Fait plus inquiétant encore, la dégringolade remarquable de la Suède dans les tests internationaux du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), depuis 2009, trahit la perte générale de qualité de son éducation. En 2015, constatant « [qu’aucun] autre pays participant à l’enquête PISA n’enregistre un tel recul », l’OCDE plaidait « l’urgence d’une réforme du système » scolaire suédois. Une réforme régulièrement débattue depuis le début de la décennie, tant sur la place publique que dans les arcanes du pouvoir, alors que rapports et comités se succèdent, mais en vain.
Après les élections législatives de septembre 2018, la question de cette réforme tant attendue reste entière, mais le problème de fond demeure : le régime de compétition scolaire est un véritable fiasco social. D’une part, il favorise la ségrégation scolaire et mine l’égalité des chances. D’autre part, il pousse à une rationalisation abusive des opérations et plombe la qualité de l’éducation.
Capitalisme scolaire et ségrégation sociale
La refragmentation du système scolaire suédois, à la faveur d’un régime fondé sur la conquête de clientèles scolaires, a généré des déséquilibres scolaires et sociaux importants. D’abord, le mouvement des friskolor s’avère davantage un phénomène urbain, les milieux ruraux étant nettement moins investis par les entreprises avides de profits. De même, la déréglementation de la carte scolaire a provoqué la mise en compétition des quartiers dans les grandes villes et accentué les disparités au sein des tissus sociaux locaux, les parents plus fortunés délocalisant leurs enfants vers les écoles qu’ils estiment plus performantes. De ce fait, les friskolor tendent à attirer à elles certains profils particuliers d’enfants et de parents, aux dépens de la mixité sociale. S’ensuit une ségrégation croissante entre des écoles privées à la clientèle socioéconomiquement plus avantagée et plus homogène, et des écoles de quartier où se concentrent des effectifs moins fortunés, issus de l’immigration ou des minorités culturelles, ainsi que les élèves en difficulté, autant de publics qui requièrent plus d’attention et de ressources.
N’étant pas tenues aux mêmes obligations alors qu’elles reçoivent le même financement que l’école publique, la plupart des écoles indépendantes font du management et de la rationalisation les pierres angulaires de leur modèle d’affaires. Pour réduire leurs frais de fonctionnement et optimiser leurs ressources, elles peuvent décloisonner leurs locaux au profit d’aires ouvertes ou les partager entre plusieurs entités, choisir de se passer d’infrastructures scolaires spécialisées (bibliothèques, laboratoires, infirmeries ou gymnases), accroître le nombre d’élèves par classe, flexibiliser les conditions de travail de leur personnel (tâche surchargée, rémunération au mérite, statut contractuel, exigences de qualification minimalistes, reddition de comptes accrue, etc.). Symbole de leur modernisme ou de leur originalité, le modèle pédagogique que certaines d’entre elles mettent de l’avant s’appuie sur une dérégulation radicale de l’organisation scolaire : méthodes d’apprentissage modulaires en ligne, infrastructures minimalistes, personnel enseignant en nombre réduit et dont la tâche se limite parfois au mentorat ou à l’accompagnement individualisé des élèves. Mais ce modèle d’affaires ne sourit pas à toutes les entreprises opérantes, qui n’ont pas toutes la même capacité face au risque. Et toutes ne s’enrichissent pas, tant s’en faut : en 2014, à peine plus de la moitié des établissements affichaient des bénéfices alors que le quart étaient déficitaires. L’année précédente, le géant JB Education, propriété d’un fonds d’investissement danois, avait subitement déclaré faillite (près de 200 M$ de dette), entraînant la fermeture ou la vente de sa trentaine d’établissements et laissant à la rue 11 000 élèves et environ 1 600 employé·e·s.
En somme, les aléas du marché ont créé d’importantes (et inquiétantes) disparités dans l’offre, la qualité et la continuité des services éducatifs, désolidarisant complètement le système scolaire de sa mission collective. C’est pourquoi plusieurs souhaiteraient faire machine arrière, rompant avec les principes de compétitivité et de rentabilité pour renouer avec ceux d’accessibilité et d’universalité.
Nul doute, le système scolaire suédois est à la croisée des chemins. Malheureusement, la crise politique à laquelle la Suède fait face depuis les élections de septembre 2018 ne permet pas d’entrevoir à court terme la réforme attendue et nécessaire. Bien qu’une certaine gauche appelle à une renationalisation du système, le débat semble se situer autour d’un encadrement plus serré des écoles indépendantes, dont la majorité des contribuables s’attendent à ce qu’elles ne puissent plus tirer profit de leurs impôts. Pour sûr, les résultats du prochain PISA, cette année, ne manqueront pas de raviver le débat.
[1] En 2018, on comptait 820 écoles indépendantes au primaire-secondaire (17 % de cet ordre d’enseignement) et 433 au lycée (33 %). S’y ajoutent 2 693 établissements indépendants au préscolaire (28 %).