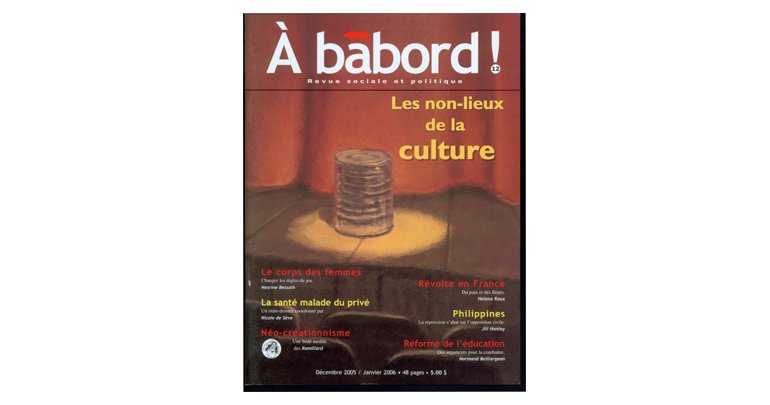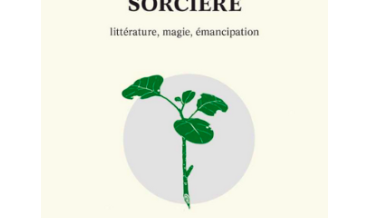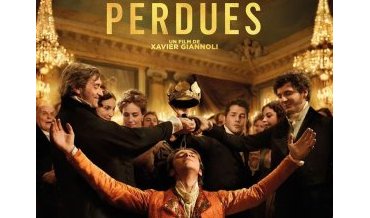Expériences limites
Une entrevue avec Olivier Rolin
« En fin de compte, tout ce que je puis dire de véridique d’Alfa (…),
c’est qu’elle m’a rendu fou : mais je plains ceux qui méprisent ce genre de folie. »
Olivier Rolin, Méroé
Il y a ceux et celles que Brel appelait Ces gens-là : ces personnes bien assises (mais là, c’est Rimbaud !) sur leurs certitudes et qui ont rejeté passions et tourments à la marge. Satisfaits, d’une certaine manière... Et puis, il y a les autres, portés par une insatisfaction « existentielle » si on peut dire, qui tentent l’expérience des limites. Expérience qui peut prendre diverses formes et dont les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous ou toutes, car quel point commun peut-on tracer entre celui qui prend les armes dans un acte révolutionnaire et l’autre la plume, celle qui sombre dans la folie et celle qui squatte ou occupe une terre ? Rien, car les risques ne sont pas comparables mais, par-delà l’absence de mesure, il y a un trait commun dans ces expériences limites, c’est le refus d’être assigné à une place. La littérature participe de cette inquiétude et de cet inassouvissement. Olivier Rolin, ancien militant de la Gauche prolétarienne en France durant les années 70 et écrivain ainsi qu’éditeur nous a donné une entrevue en septembre dernier, partageant ainsi quelques bribes de son expérience.
À Bâbord ! : Comment s’est opéré votre passage à la littérature, car durant les années 60-70, vous étiez militant politique révolutionnaire, alors comment expliquer ce changement de préoccupation ?
Olivier Rolin : Eh bien, cela n’était pas l’idéal qui avait disparu mais la croyance dans les moyens pour atteindre cet idéal. Quand le mouvement auquel j’appartenais s’est dissous, ce fut une période de désarroi très difficile, alors j’ai commencé à écrire pour, très progressivement et très timidement, réfléchir sur ces années et cette expérience historique que j’avais traversées.
ÀB ! : Ainsi, ce que vous écrivez relève beaucoup de la mémoire, la mémoire de l’histoire avec un grand et un petit H...
O.R. : J’ai été formé comme cela. Dans ma génération, il y avait encore une présence de l’Histoire qui était très forte et puis, j’étais révolutionnaire avec toute une volonté de m’inscrire dans une tradition. Enfin, il est vrai que pour moi écrire, c’est écrire sur le temps mais pas seulement la temporalité individuelle car, je le répète, cela tourne toujours autour de l’Histoire.
ÀB ! : Pour reprendre les termes de présentation d’un colloque des années 60, actuellement, que peut la littérature ?
O.R. : Je ne pense pas qu’elle puisse changer le monde et, d’ailleurs, je ne crois pas que cela soit son rôle. En revanche, je pense toujours qu’elle peut, plus que jamais, aider les gens à penser librement par eux-mêmes et à résister au système de domestication de la pensée. Les livres transmettent des expériences, cela nous permet de comprendre ce que l’on n’a pas connu et ce que nous n’avons pas été. C’est énorme mais cela ne peut aboutir à des expériences de transformation politique immédiate.
ÀB ! : Il y a un passage dans votre roman Tigre en papier qui m’a marqué, où vous écrivez que toute littérature pourrait se résumer à tourner autour du dernier mot, un peu comme la musique qui tournoie autour de la dernière note. Il y a beaucoup d’errance et de voyages dans vos romans...
O.R. : On écrit parce qu’on a pas de lieu ou, plutôt, parce qu’on ne peut se satisfaire d’où l’on est. Nous sommes sans feu ni lieu. J’écris pour cela, car aucune inscription ne me satisfait et aucun mot ne peut me satisfaire définitivement. Chaque fois qu’une phrase est faite, une autre suit pour la reprendre et la rectifier. Une fois qu’un livre est fini, il faut y revenir avec un autre livre, car il n’y a pas satiété, cela veut dire sazieted, c’est assez mais, voilà, c’est jamais assez. Il y a toujours à redire, à dire autrement. Donc, il n’y a jamais de repos.
ÀB ! : On repousse les limites ?
O.R. : Oui, c’est cela.
ÀB ! : Toujours dans votre roman Tigre en papier, autant les expériences révolutionnaires semblent « décevantes », autant les expériences amoureuses apportent leur lot de déceptions. L’amour n’est pas non plus un refuge dans le fracas de l’Histoire ?
O.R. : Cela peut l’être, je ne sais pas. Pour moi, ce ne fut pas le cas mais c’est une chose qui m’a importé et qui m’importe encore toujours ! Mais j’ai dit précédemment que j’étais un pessimiste et c’est vrai que je n’ai pas une conception et une expérience spécialement paisible ou pacifique ou rassurante de l’amour. Cela n’est pas une demeure, rien n’est une demeure. J’ai écrit une fois, je m’excuse de me citer mais j’aime bien cette formule, que les demeures, c’est pour les demeurés. L’amour n’est donc pas une demeure mais c’est une histoire, une lutte, une passion, un bonheur ou une souffrance. Mais cela n’est jamais arrêté et stable. Ce n’est pas un refuge mais, en revanche, c’est une autre grande expérience humaine.
ÀB ! : Pour conclure, après la traversée du désert des années 80-90, ne sent-on pas actuellement un souffle de changement se lever ?
O.R. : Oui, je dirais qu’il y a un retour de l’intérêt pour les autres et de l’altruisme. L’altruisme est à la base de l’énergie révolutionnaire...
ÀB ! : Comme l’internationalisme ?
O.R. : Oui, oui, il y a un retour de cela et c’est bien. Par contre, il y a aussi un retour, malheureusement, des formes les plus manichéennes et sectaires de la pensée. Il y a donc de nouvelles raisons d’espérer mais aussi de nouvelles de désespérer.
Un dossier sur Olivier Rolin sur le site Remue.net littérature