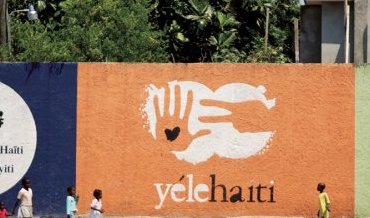Mexico 1968
Le 2 octobre ne s’oublie pas
par Laura Castellanos
Laura Castellanos, journaliste à Mexico, vient de faire paraître un livre important : México Armado. 1943-1981 (éditions Era, 2007), relatant pour la première fois l’histoire des guérillas du Mexique. Nous reproduisons ici les quelques pages portant sur les événements de 1968. Car le massacre de Tlatelolco constitue un point tournant dans l’histoire de ce pays, à la fois pour ces centaines de jeunes qui, au cours des années suivantes, se lancent dans la lutte armée estimant que toutes les autres voies de changement étaient bloquées et pour un régime autoritaire qui s’enfonce dans la violence et la répression de la « sale guerre ».
Dans son livre Marxism and Communism in Twentieth-Century Mexico, Barry Carr signale que durant les années 1960, celles du « miracle mexicain », le Mexique connait une croissance soutenue combinée à une stabilité monétaire. L’industrie manufacturière et pétrolière sont en plein essor, les salaires réels des travailleurs s’améliorent, les sommes allouées à l’éducation et à la santé augmentent et le pays commence à se définir comme une société de consommation. Toutefois, sur le plan politique, cette poussée se fait sentir avec plus de virulence. Jaramillo est assassiné en 1962 ; le mouvement de Salvador Nava à San Luis Potosí est dissous [1] ; diverses manifestations pacifiques sont réprimées dans le sang sur les places du Guerrero ; le mouvement des médecins est écrasé en 1964-1965 ; l’Université Nicolaíta, dans le Michoacán, est occupée militairement en 1966 et celle de Sonora un an plus tard. Pendant qu’on anéantit toute tentative de soulèvement armé, le Parti communiste mexicain (PCM), exsangue et sans registre électoral, continue d’être harcelé. Quelques dirigeants des cheminots, dont Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Alberto Lumbreras et Hugo Ponce de León, sont toujours détenus pour avoir lutté, une décennie auparavant, pour l’autonomie et la reconnaissance des syndicats.
Pendant que les vieux militants languissent en prison, de nouveaux visages rejoignent le militantisme social. La prolétari-sation de la campagne et la migration vers les villes, la répression des mouvements ouvrier et professoral de 1957-1959, la consolidation des institutions corporatistes et corrompues du gouvernement, la massification de la vie urbaine, l’ankylose du PCM, l’assujettissement du Parti populaire socialiste (PPS) à l’État, et le Concile Vatican II adoptant l’« option pour les pauvres » constituent autant de phénomènes qui, selon Carr, provoquent l’apparition de nouveaux protagonistes sur la scène nationale : travailleurs agricoles et paysans sans terre, bureaucrates, chrétiens radicalisés, organisations de colons avec une présence féminine majoritaire demandant logements et services urbains, ainsi qu’hommes et femmes cultivant leurs préoccupations politiques sur les campus des grandes villes.
C’est cependant la jeunesse ayant accès aux écoles normales rurales et à l’enseignement supérieur dans les grandes villes qui, au cours des années 1960, hisse le drapeau de la lutte démocratique. Les cercles étudiants mexicains ne restent pas étrangers à la rébellion juvénile de la décennie et à la libération féminine qui accroît la participation politique des femmes. Dans les milieux les plus politisés circulent les œuvres de Marx, de Lénine ou de Mao. Des milliers d’étudiants militent dans la Jeunesse communiste, le PPS, ou dans l’une des deux organisations les plus importantes au niveau national : la Centrale nationale des étudiants démocratiques (CNED) ou la Fédération des étudiants paysans socialistes du Mexique – qui réunissent les normaliens –, alors que d’autres, ayant une formation chrétienne, adhèrent à la naissante théologie de la libération.
Au moment où cette génération admire la jeunesse révolutionnaire consolidant la révolution cubaine, elle assiste au Mexique à l’épuisement du pacte de développement économique qui avait rendu possible l’ascension sociale des classes moyennes. Elle observe l’aggravation de la crise du milieu rural, les attaques implacables contre les mouvements d’opposition et l’impossibilité de réaliser des changements sociaux et économiques à travers la voie électorale. Voilà la toile de fond sur laquelle cette génération vit diverses expériences politiques et commence à discuter, notamment dans les états du Chiahuahua et du Guerrero, de la pertinence de la voie armée, avant même qu’ait lieu le massacre de 1968.
Au moment même où Génaro Vázquez et Lucio Cabañas forment leurs guérillas [2], le président Gustavo Díaz Ordaz trouve le prétexte idéal pour montrer le visage du « miracle mexicain » au monde entier : Mexico a été sélectionnée pour la tenue des XIXe Jeux Olympiques. Néanmoins, sa susceptibilité anticommuniste se convertit en paranoïa et engendre ce que Carlos Monsiváis a appelé, dans Parte de guerra, Tlatelolco 1968, la « théorie du complot » : le président est obsédé par l’idée qu’un complot communiste international ne sabote les Jeux Olympiques pour discréditer le pays. Son obsession s’incarne dans un fait divers impliquant des étudiants, qui provoque en cascade une fausse alarme, puis une intervention militaire sur des campus universitaires, un étonnant militantisme étudiant, une violence brutale exercée à son endroit et un point culminant dans la nuit tragique de Tlatelolco. Le responsable de la sécurité est alors Luis Echeverría [3].
Le 22 juillet 1968, une querelle entre des gangs de jeunes et des étudiants de la Polytechnique, qui éclate aux alentours de la Ciudadela, provoque l’incursion violente de policiers anti-émeute dans ces campus scolaires. Des étudiants de la Polytechnique et des jeunes de la CNED manifestent leur indignation durant la marche du 26 juillet commémorant l’assaut à la caserne de Moncada mené par Fidel Castro en 1953. La marche est interrompue par des nervis vandalisant les commerces avec la complicité de la police. Quatre jours plus tard, les militaires font irruption sur les campus de l’Université nationale autonome de Mexico (UNAM) et de la Polytechnique et tirent au bazooka dans une porte du Collège de San Ildefonso.
Le corps estudiantin crée alors le Conseil national de grève (CNH pour Consejo nacional de huelga [ndt]) au sein duquel convergent des représentants de diverses facultés et écoles. Des marches massives ont lieu, puis des assemblées spontanées et marathoniennes. L’assaut militaire contre la Ville universitaire et le campus de Santo Tomás, abritant respectivement l’UNAM et la Polytechnique, entraîne l’appui inconditionnel aux grévistes de Javier Barros Sierra, recteur de l’UNAM, qui démissionne pour protester contre le viol de l’autonomie universitaire par l’armée. L’assaut éveille aussi la solidarité de l’académie et des intellectuels progressistes, de mères et de pères de famille. En revanche, le gouvernement étend son contrôle sur la presque totalité des médias de communication et fait emprisonner plus d’un millier d’étudiants.
Le CNH brandit comme étendard les « six points de la plateforme de revendication » qui dépassent les questions académiques : liberté des prisonniers politiques (parmi eux, les vieux cheminots) ; destitution des généraux Luis Cueto Ramírez et Raúl Mendiola, chefs des corps de police, pour leurs attaques contre les étudiants ; dissolution du corps des policiers anti-émeute ; abrogation des lois référant au délit de « dissolution sociale » ayant été promulguées comme mesures d’urgence lors de la IIe Guerre mondiale et qui sont utilisées comme instrument juridique répressif pour emprisonner des militants d’opposition ; indemnisation des familles dont des membres ont été tués ou blessés depuis la manifestation du 26 juillet.
Les autorités font la sourde oreille et la « théorie du complot » atteint son apogée le 2 octobre 1968. La manifestation qui a lieu devant l’édifice Chihuahua de l’Unité d’habitation Nonoalco Tlatelolco rassemble quelque 5 000 personnes, surtout des étudiants et des familles solidaires, plusieurs d’entre elles habitant l’édifice. La manifestation est encerclée par des soldats et des véhicules blindés, des francs-tireurs avec des armes de haut calibre sont postés dans différents édifices et des officiers de l’État-major présidentiel sont dissimulés dans des appartements entourant la place [4]. Des officiers du bataillon Olimpia, vêtus en civil et portant un gant ou un mouchoir blanc comme signe de reconnaissance, se dissimulent dans les escaliers et les couloirs de l’entrée de l’édifice.
Deux feux de Bengale lancés d’un hélicoptère servent de signal pour qu’un franc-tireur fasse feu sur le général José Hernández Toledo, provoquant ainsi l’attaque des militaires contre la foule sans défense. La fusillade à bout portant, raconte Monsiváis, dure plus d’une demi-heure. Les corps d’enfants, de femmes, d’hommes et de personnes âgées demeurent éparpillés sur la place. Plus de 2 000 personnes sont emprisonnées [5] et, à l’exception de l’Excélsior de Julio Scherer, de la revue ¿Por qué ? de Mario Menéndez et de Siempre ! de José Pagés Llergo, tous les médias dissimulent la vérité. Dix jours plus tard, Díaz Ordaz inaugure les XIXe Jeux Olympiques. C’était Mexico 1968.
[1] Rubén Jaramillo, ancien combattant de l’Armée de libération du Sud d’Emiliano Zapata, était un leader paysan et un guérillero de l’état de Morelos ; il aurait été assassiné par ordre du président Adolfo López Mateos. Salvador Nava Castillo était à la tête d’un mouvement démocratique de défense des droits civiques. (ndt)
[2] Respectivement l’Asociación cívica nacional revolucionaria (ACNR) et le Partido de los pobres (PDLP), toutes deux actives dans l’état du Guerrero. (ndt)
[3] Alors ministre de l’Intérieur (Gobernación), il succède à Díaz Ordaz à la présidence pour le sexennat de 1970-1976. (ndt)
[4] Il s’agit de la Place des Trois cultures (référence aux cultures précolombienne, espagnole et du Mexique moderne). La Plaza de las Tres Culturas est le théâtre, en 1521, de la capitulation de Cuauhtémoc devant Hernán Cortés, lequel y fait massacrer plusieurs milliers d’indigènes. (ndt)
[5] Les autorités admettront par la suite le décès de 40 personnes. Les chercheurs estiment aujourd’hui que le Massacre de Tlatelolco a fait de 300 à 800 morts, selon les estimations. (ndt)