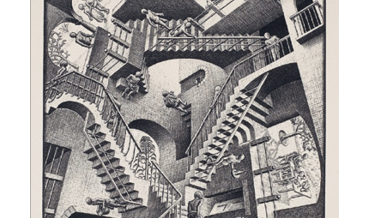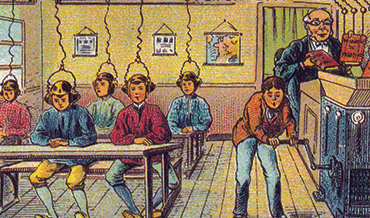Éducation
L’enseignement de l’anglais au primaire
L’autorité d’éduquer et ses responsabilités
Vu de l’extérieur, le monde de l’éducation doit parfois sembler bien étrange à ceux et celles qui n’y œuvrent pas, ne serait-ce qu’en raison des incessants et parfois abscons conflits idéologiques qui le caractérisent. Considérez celui qui domine au moment où j’écris.
Divergences de vues sur l’anglais intensif
La question débattue est l’enseignement de l’anglais au primaire, que le MELS voudrait voir se donner de manière intensive en sixième année, et ce, dès l’an prochain pour certaines écoles, puis pour toutes les écoles de la province en 2015. Les enfants feraient par exemple leur programme annuel en quelques mois, puis, durant la deuxième moitié de l’année, ils ne feraient que de l’anglais ; ou ils feraient de l’anglais, disons, tous les matins, durant toute l’année, et les autres matières les après-midis.
Cette idée, notons-le, n’a pas été sortie d’un chapeau par le Ministère. Elle résulte notamment d’engagements politiques pris par les libéraux, de recommandations de divers comités et commissions ainsi que de demandes répétées de certains groupes, dont les parents.
Pourquoi donc l’énorme dissension qu’on observe actuellement et qui fait, par exemple, que les enseignants ont quitté la table de travail sur le sujet ou que des groupes d’enseignantes et d’enseignants en appellent à la mobilisation citoyenne contre un projet jugé unilatéral et improvisé ? J’ai ma petite idée là-dessus, que je voudrais vous présenter.
Trois types d’autorité
Par-delà les luttes de pouvoir, par-delà les difficultés à concocter un programme qui satisfasse tout le monde dans un réseau scolaire à ce point diversifié et où on trouve une si grande variété d’enfants avec des besoins, des backgrounds et des aptitudes souvent fort différents, il me semble que ce que nous rencontrons ici, et qui est récurrent en éducation, c’est un problème d’autorité capable de fonder la légitimité d’une action.
On n’y pense pas assez, mais l’État, quand il entreprend d’éduquer, comme quiconque prétend éduquer, pose en cela un geste d’une grande signification – s’emparer des cerveaux des enfants, rien de moins – et qui appelle une justification. Cette justification ne peut se tirer que d’une forme ou l’autre d’autorité. Je suggère, au moins en première approximation, que trois types d’autorité convergent ou non pour fonder l’autorité d’éduquer.
La première est épistémique ; elle dit : je peux faire ce que je fais parce que je sais que c’est ainsi qu’il faut faire. J’appellerais la deuxième l’autorité technique, qui est acquise en raison du savoir-faire reconnu à une institution ; celle-ci dit : je peux faire ce que je fais parce que je fais bien, depuis toujours, ce que je fais. La troisième est l’autorité politique et philosophique ; elle dit : je peux faire ce que je fais parce que j’incarne un large consensus sur les finalités poursuivies par ce que je fais.
Retour sur le cas de l’anglais intensif au primaire
Revenons avec cela à la question de l’anglais et aux raisons qui font qu’il y a débat : on trouvera typiquement, à chaque fois, des carences d’autorité qui rendent problématique la légitimité de l’action envisagée.
En ce qui concerne l’autorité épistémique, il se trouve qu’en éducation il est bien souvent quasi impossible d’invoquer des résultats de recherche qui trancheraient une question de manière à peu près définitive. Cela arrive, certes, et certains résultats de recherche convergent vers une conclusion ; mais il arrive aussi, bien souvent, que le portrait soit nuancé, que les conclusions ne soient pas généralisables, etc. Considérez justement le cas de l’anglais.
Des expériences comme celle menée au Lac-Saint-Jean, où un programme d’anglais intensif en sixième année est à peu près suivi par tous les élèves et connaît semble-t-il un grand succès, indiqueraient que c’est la voie à prendre. Mais quand j’ai voulu me renseigner sur cette question que je ne connais pas, j’ai demandé au ministère la liste des recherches sur lesquelles il s’appuyait pour préconiser l’anglais intensif. Dans la première recherche de la liste qui m’a été transmise que j’ai consultée, j’ai lu : « Dans les écrits des sciences cognitives et dans ceux concernant l’éducation, on trouve des preuves substantielles démontrant la supériorité d’un enseignement [d’une langue seconde] distribué dans le temps plutôt qu’intensif [1] ». Oups… Dans ce qui est reconnu comme une des sources crédibles dans le domaine, la Best Evidence Encyclopedia, on résume ainsi la conclusion de ce qu’on donne comme une rare étude longitudinale sérieuse sur la question (il s’agissait d’enfants hispanophones apprenant l’anglais) : « Ces enfants apprennent aussi bien à lire en anglais par immersion que par un enseignement transitionnel bilingue. » J’ignore la portée ou la valeur de ces affirmations, que je ne donne que pour illustrer à quel point la généralisation est ici difficile et problématique.
Il y a donc manifestement place à des désaccords et ceux-ci sont encore accentués du fait que l’un invoquera (justement) des résultats de recherche où il est question d’apprendre l’espagnol en Californie pour établir une conclusion que l’autre contestera, en disant que cela ne vaut plus pour l’anglais au Québec. On devine sans doute l’ampleur du problème.
Devant ce fait s’impose une certaine prudence. L’institution responsable devrait affirmer avec force ce qu’on peut affirmer avec force savoir, quand cela est le cas (et en passant : ces résultats, qui existent, contredisent largement ce qui a été mis de l’avant dans la réforme de l’éducation) ; et reconnaître humblement que d’autres résultats sont plus ou très problématiques et peu ou guère appuyés par la recherche. Une institution qui le ferait aurait par là de l’autorité épistémique et gagnerait en autorité technique.
De ce deuxième point de vue, le MELS laisse fortement à désirer et les expériences passées ont laissé un goût amer à plusieurs : initiatives donnant l’impression d’être improvisées ; documents livrés en retard (et souvent très en retard) ; absence d’évaluation préalable sérieuse de changements aussi importants que la réforme ; et j’en passe, tout cela pointant vers une absence de prudence et de préparation.
Dans le cas présent, les parents, réunis en Fédération des comités de parents du Québec, voudraient, sagement selon moi, que la pratique de l’anglais intensif soit modulée aux besoins particuliers de chaque école plutôt que d’être uniformément appliquée partout ; et surtout qu’elle soit évaluée au bout de trois ans.
Les enseignantes et enseignants, de leur côté, qui mettent en garde contre l’improvisation, qui rappellent que nombre de questions pratiques restent dramatiquement sans réponses – quelles pratiques devront être changées ? comment et qui recrutera-t-on pour cet enseignement ? et ainsi de suite – ont bien raison de s’inquiéter. Comment se peut-il que le MELS n’ait pas prévu tout cela et donne, une fois de plus, ce désolant spectacle d’improvisation qui rogne encore plus son autorité technique d’institution ?
Reste cette autorité que j’ai appelée politique et philosophique. Est-il nécessaire de rappeler à quel point est sensible la question de la langue au Québec ? Il n’y a guère ici de consensus large entre ceux et celles qui rappellent l’importance de l’anglais (et même d’une troisième langue) et les personnes qui soulignent à quel point le français est menacé ici ; le dialogue entre ces deux parties, s’il existe, en est un de sourds.
Je pense que ces trois séries de problèmes sont récurrents en éducation chez nous et qu’ils expliquent, en partie, ces incessants et parfois obscurs conflits idéologiques qu’on y retrouve constamment. On ne peut guère agir sur le troisième : l’autorité philosophique et politique ne se commande pas. Mais on peut agir sur les deux premiers types d’autorité, les acquérir et les déployer. Ils dessinent conjointement un horizon de responsabilités qui vont avec l’autorité d’éduquer.
Je vous laisserai le soin de conclure et de déterminer ce que cela peut signifier…
[1] L. Collins et al., « Time and the Distribution of Time in L2 Instruction », Tesol Quaterly, vol. 33, no 4, hiver 1999, p. 655.